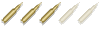Un peu de paix pour préparer la guerre ça ne mange pas de pain, de 1624 à 1627 point de combats, du moins jusqu'au 4 août 1627 où les polonais se sentent pousser des ailes et attaquent le margraviat de Brandebourg. Grossière erreur avec seulement 80000 hommes contre les 400000 de notre alliance, dont la majorité est évidemment française et de loin.
Grâce à notre colossale fortune nous organisons une révolte massive des ruthènes au profit de Kiev et envoyons directement nos troupes de Moldavie sur les provinces peuplées de polonais.
Dès novembre les premières places ennemies tombent alors que nous progressons difficilement sous la neige, mais heureusement les troupes de Moldavie sont habituées aux rigueurs de l'hiver dans l'est de l'Europe et possèdent toutes les dotations nécessaires pour combattre le froid.
Le 30 août Pierre de Chabannes déloge les polonais de Berlin sauvant la tête du margrave dans l'affaire, pour réussir pareille action il lui fallut traverser la Pologne sans prendre aucune ville supplémentaire.
Les combats vont se poursuivre plus d'un an, les places polonaises tombant les unes après les autres pour que finalement le 9 octobre 1629 le roi de Pologne reconnaissent sa défaite et renonce à de nombreuses prétentions territoriales.
C'est la fin de la 6e guerre d'agression polonaise !
Pour l'empire point de repos, dès 1630 nous attaquons l'intégrité du SERG encore une fois pour la possession de Jülich. Campagne facile qui dure moins d'un mois où l'empereur reconnait notre puissance en abandonnant Jülich et en libérant Münster.
Aux Indes les efforts de la compagnie des Indes Orientales portent une nouvelle fois leurs fruits avec l'acquisition de Bangka.

Terrible nouvelle dans les Moluques, un tremblement de terre provoquent la mort de la quasi totalité des colons de Misool n'en laissant que 371 en vie.
Mais l'empire tourne son regard vers la Hongrie et sa volonté hégémonique dans les Balkans, en Grèce et en Anatolie. Cette situation est inacceptable, la guerre débute le 13 août 1633. Elle nous opposera à la Hongrie, à l'Autriche, à la Castille et au Portugal. Les effectifs totaux tant terrestres que navals des deux alliances sont sensiblement égaux.
La première action de cette guerre est l'invasion de la Transylvanie par nos forces de Moldavie et l'envoi de 44000 hommes de plus dans les Balkans qui attaqueront à partir de l'Albanie.
Pendant e temps castillans et portugais attaquent aux Amériques nous obligeant à la défensive devant la disproportion des forces sur place.
En Transylvanie malgré les pertes infligées aux hongrois ceux-ci ne cessent d'apparaître en plus grand nombre et repoussent inexorablement nos troupes en Moldavie, arrivant même à exterminer une armée entière. Devant les difficultés et la nécessité de concentrer tous nos efforts sur la Hongrie, l'empereur ordonne une action dangereuse mais décisive : la prise de Lisbonne par la mer.
Le 8 mars 1634 près de 200 navires bombardent la ville et le port et débarquent 44000 soldats venus de Normandie, la ville tient 3 jours à l'assaut. Le roi du Portugal est finalement capturé et se trouve contraint à la paix, l'Autriche signe dans la foulée de peur de voir le retour de nos troupes à Vienne.
Le 9 avril la Castille se rend également de peur de subir le sort du Portugal après une nouvelle défaite en Navarre.
Les troupes ayant pris Lisbonne peuvent ainsi débarqué en Albanie et prendre Kastrioti sans coup férir et ouvrir un nouvel axe de progression face aux hongrois.
Le roi hongrois refuse toute discussion alors que ses armées disparaissent les unes après les autres face au flot constant de nouvelles armées française débarquant tant en Albanie qu'en Moldavie, et bientôt en Anatolie hongroise.
Le 16 mai 1636 devient date symbolique en Hongrie lorsque Buda découvre la furia francese tristement célèbre dans toute l'Europe et au-delà ! La Hongrie baisse les bras le 15 novembre 1636 et se trouve en partie dépecée car elle libère la Transylvanie, la Valaquie, cède la Bucovine pour nos vassaux moldaves, Szombathely, Pressburg et Komarom à l'empire dans une optique de vente aux autrichiens.

L'empire va connaître la paix jusqu'en 1639, durant ce laps de temps l'empereur bâtit et crée. Deux universités en mars 1637 pour 16000 ducats or en Valois et en Brie ! Le 1er janvier 1639 instauration de la Révolution Scientifique en France, dans les faits un investissement massif dans la recherche de la part de la maison impériale elle-même. Le 31 janvier début de la recherche sur la technologie des canaux pour 1000 ducats-or.
Nous arrivons ainsi en octobre 1639 où le Danemark se décida à attaquer le Holstein. Combattre l'empereur milanais nous incombe dans l'histoire, combats difficiles car le fou possède 12 régiments d'artillerie flambants neufs !
Après quelques combats nous obtenons de l'or et cessons les combats, que les danois se débrouillent.
Pendant ce temps la compagnie des Indes Orientales continue son action et nous obtient Mumbai de l'empire marathe de Khandesh le 4 février 1640. Dans la foulé elle provoque un incident frontalier aux Célèbes avec Makassar, nous donnant légitimité pour les envahir dans le futur.

La paix règne deux ans, car le 22 mars 1642 nous apprenons avec consternation que le Brandebourg quitte la foi luthérienne et rejoint les papistes ! La guerre est immédiate, Naples prend la tête des catholiques avec la Pologne et le Mecklembourg comme alliés. Le Mecklembourg tombe le 3 août et se convertit, le Brandebourg le 27 septembre. La Pologne rend les armes sans combattre rien qu'à la vue des armées françaises à la frontière et Naples fait rapidement de même à la vue de notre flotte devant Naples. Rien qu'en six petits mois, nul ne peut rien contre nous.
Nouvelle période de paix et donc de prospérité pour l'empire, donc nouvelles constructions en 1645 : manufactures d'armes en Périgord et Bourbonais, manufactures textiles dans le Maine et distillerie en Gascogne pour 20000 ducats-or.
Mais 6 mois plus tard l'empereur meurt et Philippe VII von Nassau lui succède. Exécrable diplomate mais excellent militaire, il nomme un nouveau conseiller pour mener les tractations diplomatiques avec les puissances étrangères : l'ambassadeur genevois Nicolas Flotte, qui se verra soutenu par le diplomate piémontais Charles de Chaumont à partir d'octobre 1649.