J'édite le premier post, tiens.
A toutes les gloires de la France.
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
Oui.
J'édite le premier post, tiens.
J'édite le premier post, tiens.
Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
-
Coelio
- L'Abbé voyeur
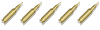
- Messages : 5470
- Enregistré le : mar. août 17, 2004 7:47 pm
- Meilleur jeu 2008 : Le Trone de Fer online
- Meilleur jeu 2009 : Le Trone de Fer online
- Localisation : Une abbaye bien entendu. Paris, sinon.
Re: A toutes les gloires de la France.
Peut-on remettre les vrais Bourbons sur le Trône ? 
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
Il y a une possibilité.Coelio a écrit :Peut-on remettre les vrais Bourbons sur le Trône ?
Mais c'est peu probable.
Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
-
GA_Thrawn
- Calimero

- Messages : 16844
- Enregistré le : mar. août 09, 2005 7:49 pm
- Localisation : De retour dans le sud
Re: A toutes les gloires de la France.
Ca me rappelle la grande époque et ton aar victoria sur la confédération! 

« Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. »
Marc Bloch
Marc Bloch
-
Elvis
- Serenissimus augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator
- Messages : 10787
- Enregistré le : ven. sept. 03, 2004 4:20 pm
- Localisation : Secret Defense
Re: A toutes les gloires de la France.
Emp_Palpatine a écrit :
Règles maisons :
- Je me réserve le droit d'utiliser la console pour corriger les bêtises de l'IA, notamment à la suite de guerres ou pendant la phase coloniale. Je n'aime pas les frontières laides ou improbables.
- Je me réserve le droit d'utiliser la console pour forcer l'IA à accepter la paix quand le score est à 100% et/ou que sa capitale est occupée;
- Pas de techniques gamey, du genre laisser volontairement des révolutions se produire ou augmenter artificiellement le militantisme pour faire ce qu'on veut avec les réformes.
- Le life rating a été augmenté en France, la démographie sera modérée par les events de natalité (pour lesquels la France a des malus.). Haters gonna hate.
- Pas de conquêtes débiles en Europe du genre des provinces en Illyrie ou je ne sais quoi. La limite d'expansion, si expansion il y a, est constituée par les frontières naturelles. Par contre, free-for-all en dehors de l'Europe;
- Dans l'idéal, les pays coloniaux sous protectorat ne seront pas annexés mais resteront satellite : ça concerne les pays nord-africains ou asiatiques aux États déjà globalement constitués.
- Je me réserve la possibilité de relâcher des vassaux coloniaux pour ne pas disperser les efforts de colonisation de peuplement.;
- Tout régime politique doit se défendre dans la mesure de ses moyens : pas de révolution volontaire hormis par event. Si révolution il doit y avoir, les rebelles doivent gagner comme des grands.
The King Rocks Da Place !!
"-À mon avis, dans la guerre, il y a une chose attractive : c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qui se passe avant. Il faudrait toucher sa prime d'engagement et défiler tout de suite. Avant que ça se gâte…"
(Michel Audiard, Un Taxi pour Tobrouk)
"-À mon avis, dans la guerre, il y a une chose attractive : c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qui se passe avant. Il faudrait toucher sa prime d'engagement et défiler tout de suite. Avant que ça se gâte…"
(Michel Audiard, Un Taxi pour Tobrouk)
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
Bon, j'ai joué deux ans et demi...
Il s'est passé des trucs sympa.
Mais je me suis rendu compte que j'ai mal réglé mon machin de screens, alors je dois recommencer!

Le premier vrai update arrivera avec quelques jours de retard donc.
Il s'est passé des trucs sympa.
Mais je me suis rendu compte que j'ai mal réglé mon machin de screens, alors je dois recommencer!
Le premier vrai update arrivera avec quelques jours de retard donc.
Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
Re: A toutes les gloires de la France.
Elle est belle, la gloire de la FranceMais je me suis rendu compte que j'ai mal réglé mon machin de screens, alors je dois recommencer!
"Cuius testiculous habes, habeas cardia et cerebellum"
Quand vous avez leur pleine attention , le coeur et l'esprit suivent.
--------------------------------------------------------------------------------
L'été n'est pas qu'une époque de l'année. L'été est un être animé qui aime descendre passer l'hiver dans le Sud.
Quand vous avez leur pleine attention , le coeur et l'esprit suivent.
--------------------------------------------------------------------------------
L'été n'est pas qu'une époque de l'année. L'été est un être animé qui aime descendre passer l'hiver dans le Sud.
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
Tu n'as pas un transsaharien à finir? 

Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
Re: A toutes les gloires de la France.
C'est déjà fait 

27 janvier 1937
C'est fait. Ce matin nous avons planté le clou en or reliant la ligne Dakar-Saint Louis et celle que nous venons de contruire. Ce fut une longue aventure mais ça y est, le transsaharien est achevé. [...]
"Cuius testiculous habes, habeas cardia et cerebellum"
Quand vous avez leur pleine attention , le coeur et l'esprit suivent.
--------------------------------------------------------------------------------
L'été n'est pas qu'une époque de l'année. L'été est un être animé qui aime descendre passer l'hiver dans le Sud.
Quand vous avez leur pleine attention , le coeur et l'esprit suivent.
--------------------------------------------------------------------------------
L'été n'est pas qu'une époque de l'année. L'été est un être animé qui aime descendre passer l'hiver dans le Sud.
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
État de la France en 1836.
I. Le gouvernement selon la Charte. État des institutions et des partis. Le cens et les électeurs. L'opinion publique face aux institutions de juillet. L'effet de l'attentat de Fieschi. Premières années de stabilité depuis la mort de Casimir Perrier. II. Prospérité de la société. Développement du commerce et de l'industrie. Progrès de l'alphabétisation grâce à la loi Guizot. Dynamisme démographique. III. Solitude de la France en Europe. Bonnes relations avec les cours continentales. Présence française en Italie. L'Afrique du Nord. L'affaire d'Espagne inquiète le gouvernement.
I
En 1836, la France est sous l'empire de la Charte d'août 1830, conséquences des événements de juillet. Nul besoin de feindre, comme l'esprit s'y plaisait alors, qu'il s'agissait d'un texte original : les institutions restaient celles établies par la Charte octroyée de 1814, organisées sous la forme d'une monarchie constitutionnelle.

Contesté dans ses premières années, le régime de Juillet survécut à plusieurs maux qui eussent pu le condamner. Le ministère Perrier en 1831- 1832 fit beaucoup pour enfin enraciner les institutions et redonner aux institutions la confiance, à la société l'ordre auquel elles aspiraient.
A la chambre des députés, le ministère s'appuyait alors sur une solide majorité de conservateurs et de doctrinaires. La monarchie, que certains avaient voulu encaserner dans des prérogatives limites telles qu'en 1791, avait regagné de son lustre et le respect nécessaire au fonctionnement sain des institutions. Ces dernières étaient combattues à droite par les Légitimistes et à gauche par les radicaux. Afin de former un ministère et gouverner le pays, seuls les conservateurs et la gauche dynastiques pouvaient alors fournir les soutiens nécessaires.
Frustrés par les événements de 1830 et hostiles à la royauté nouvelle qui, pour eux, n'était qu'une usurpation, les Légitimistes conservent un appui notable dans l'opinion et chez les électeurs. La chouanerie ratée de la duchesse de Berry fit cependant beaucoup pour renforcer la royauté de juillet.
Les conservateurs et les doctrinaires représentaient alors le parti de l'ordre, les dynastiques, les conservateurs soutenant les institutions nouvelles et souhaitant le maintien des institutions et de la prérogative royale en l'état. Après l'échec de Lafitte et, surtout, l'année du ministère Perrier et le succès de la politique de résistance (résistance face à l'agitation), le courant a le vent en poupe.
La gauche dynastique, quant à elle, était alors globalement écartée du pouvoir. Les éléments les plus radicaux, républicains et démocrates, fermaient la marche des factions politiques.

Conservateurs et doctrinaires et une partie de la gauche dynastique s'accordaient alors sur la justesse du suffrage censitaire existant dans la charte. A gauche, quelques voix appelaient à l'abaissement du cens sans grand écho pour le moment. La coïncidence entre propriété et suffrage restait perçue comme un élément stabilisateur contre l'élément démocratique et la possibilité de l'anarchie.
Paradoxalement, une alliance de fait entre Carlistes et radicaux put exister par moment sur cette question du suffrage. Les radicaux exigeaient toujours le suffrage universel, premier pas à leur yeux vers la république, tandis que pour certains légitimistes, le suffrage universel eût permis l'appel au loyalisme profond du pays et eût corrigé la faute première de 1814/15 et de 1830.
Ainsi, en 1836, les électeurs actifs sont un demi-million. Les propriétaires terrains dominent le corps électoral tandis qu'une partie de la bourgeoisie urbaine bénéficie du suffrage.*

Les électeurs actifs sont d'un conservatisme à l'image de celui qui traverse alors la société française. Les profondeurs du pays, massivement rurales, aspirent à l'ordre et à la stabilité. Sans racines profondes dans une opinion parfois tentée par le légitimisme, la royauté de juillet était cependant acceptée et finalement respectée comme garante d'ordre.

Les voyages royaux et princiers en province, après des débuts difficiles, rencontrèrent alors enfin un accueil chaleureux et à Paris le Roi était acclamé lors de son trajet vers les chambres. Suite aux premières années de la royauté nouvelle où Louis-Philippe était agoni de moqueries et de marques de mépris, l'évolution est alors notable.
L'attentat de Fieschi en 1835 fit beaucoup pour l'image de la monarchie et pour donner au sentiment dynastique l'énergie qui lui manquait alors. Louis-Philippe, lors de son discours du trône pour la session de 1836, parla même de "sacre du feu". La machine infernale, fauchant une trentaine de vies parisiennes et faisant craindre un instant la chute du trône consolida le trône qu'elle prétendit un instant abattre.

L'attentat vint mettre un terme à l'agitation endémique qui pénalisait les institutions de juillet en marginalisant définitivement l'opinion radicale et les républicains. Après l'échec des émeutes des années 1832 puis les tentatives de régicide à répétition, les Français, las de l'agitation, soutenaient le régime et la répression consciencieuse dirigée contre les éléments radicaux offrit enfin au pays les années tranquilles auxquelles il aspirait.
*En terme de gameplay : sont électeurs les pops aristocratiques et les capitalistes ainsi que "bureaucrates", artisans, officiers, religieux et clercs.
Afin de simuler le cens assez élevé à cette époque, le système est le cens pondéré : les votes des pops riches comptent double et seul 25% des votes des classes moyennes sont comptabilisés. Dans le screen concernant, il faut donc diviser par 4 le nombre d'artisans (ils sont 20% du corps électoral) et par deux les propriétaires terriens.
Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
- aheuc
- Oil Tycoon

- Messages : 9608
- Enregistré le : dim. août 22, 2004 9:32 pm
- Meilleur jeu 2008 : Mount and Blades
- Meilleur jeu 2009 : Mod Europa Barbarorum
- Meilleur jeu 2010 : HOI2 Domesday/Armageddon
- Meilleur jeu 2011 : Minecraft
- Localisation : Y grenoblois
- Contact :
Re: A toutes les gloires de la France.
"La gauche dynastique" c'est quoi/qui exactmeent ? 
En F1, il y a deux positions importantes sur la grille de départ : La première, qui est la pole position; Et la dernière, qui est la Paul Belmondo.
Murray Walker (Apocryphe)
--
Murray Walker (Apocryphe)
--
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
C'est le parti libéral en jeu.aheuc a écrit :"La gauche dynastique" c'est quoi/qui exactmeent ?
Historiquement, eh bien c'est... la gauche dynastique.
La gauche était divisée (tout comme la droite, somme-toute) entre les éléments radicaux (républicains, la plupart du temps dans l'héritage jacobin et donc assez... radicaux) et démocratiques, quelques républicains modérés ("à l'américaine" comme on disait à l'époque) et la plus grande masse des "dynastiques" qui considèrent le régime de juillet comme le leur, sont des monarchistes constitutionnels mais sont plutôt favorable à la réforme (comprendre la diminution du cens).
Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
II
L'ordre et la prospérité se nourrissaient mutuellement et formaient ensemble le mortier liant la monarchie nouvelle à la France. Le pays étant plus calme, l'ordre des choses put retrouver la dynamique qui était la sienne jusqu'en 1830. Le commerce interne était dynamique et en développement tandis que l'industrie s’accroissait.

La France est un pays riche de ses ressources naturelles et dispose d'excellents stocks permettant de nombreuses activités industrielles et le commerce international : fer, charbons, textiles, bois et produits agricoles.
Grâce à la Loi Guizot sur l'instruction publique de 1833, chaque commune est dans l'obligation d'entretenir une école primaire tandis qu'au niveau départemental se développe la formation des maîtres au travers des écoles normales elles aussi obligatoires.*
55% des conscrits sont, en 1836, considérés comme alphabétisés.
Signe de cette vigueur de l'industrie et du commerce, la décennie 1835-45 fut marquée par un dynamisme démographie inédit depuis le XVIIIè siècle, confirmant les tendances de la Restauration et venant fort heureusement combler les vides créés par la période révolutionnaire et impériale.

Cette population française était moins uniforme que nos jours. Patois et langues régionales dominaient dans de nombreuses régions bien que le français restât bien sûr la langue véhiculaire.

*En terme de gameplay : la réforme de l’éducation est sur "church", c'est à dire un système où l'instruction est souvent le fait d'institutions religieuses. La Loi Guizot rendant l'enseignement quasi-obligatoire a souvent conduit les communes à embaucher le curé local pour assurer la classe ;
Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
- Emp_Palpatine
- Eco-Citoyen

- Messages : 17898
- Enregistré le : sam. août 21, 2004 12:37 pm
- Localisation : Le XIXème (Siècle, pas arrondissement)
Re: A toutes les gloires de la France.
III
C'est en définitive sur le rang de la France en Europe que majorité ministérielle et opposition de querellaient le plus.
La France souffrait alors de deux maux : l'héritage des traités de 1815 et le discrédit de la royauté de Juillet auprès de certaines cours. Ainsi, la France restait malgré ses efforts sans alliés véritables sur le continent. Malgré les paroles chaleureuses du Roi sur les liens avec la Grande Bretagne, les relations avec l'autre grande monarchie libérale sont assez fraiches. De nombreux contentieux subsistaient : la méfiance subsiste sur la Belgique, l'affaire d'Espagne suscite jalousie et soupçons tandis que Londres goûtait fort peu la présence française en Afrique du Nord et craignait la poursuite de notre expansion. L'entente était ainsi loin d'être acquise, bien que le gouvernement y accordât un prix qui lui coûtait souvent la popularité. Patriotique et susceptible, l'opinion l'était et elle souffrait assez peu les compromis et décisions qui lui paraissait être des reculades quant à ce que devait être le rang de la France.
La Sainte Alliance, cependant, n'existait plus qu'en nom bien qu'il ne fût guère douteux alors que le moindre soubresaut français l'eût reconstituée très rapidement. Le régime de juillet souffrait d'un certain discrédit qui s'amenuisait du fait de son enracinement, du pragmatisme des cours continentales et des efforts de la diplomatie française. En Prusse, Frédéric-Guillaume III avait rapidement accepté le nouveau régime et ne lui dissimulait pas sa sympathie depuis la visite triomphale à Berlin du Duc d'Orléans en 1835. Des rumeurs d'alliance avaient même circulé mais un tel mouvement aurait mécontenté l'Autriche tout en donnant à la Prusse les coudées trop franches au sein de la Confédération Germanique.
A Vienne, l'humeur était cordiale mais distante. Metternich était reconnaissant à la France d'avoir manifesté son souhait de paix et de stabilité en Europe en ne remettant pas en cause les traités. Ce ne fut pas suffisant pour accorder au Duc d'Orléans la main d'une archiduchesse, geste considéré comme trop hasardeux considérant la jeunesse du trône des Orléans, sa fragilité et l'alliance qui en aurait résulté, là aussi.
Enfin, à Saint Petersbourg le Tsar ne cachait ni son dégoût, ni son mépris. Il n'en demeurait pas moins qu'en termes assez mauvais avec la Prusse et l'Autriche, la Russie était perçue par le gouvernement français comme un potentiel allié pouvant permettre de prendre à revers l'alliance germanique dans le cas où le besoin s'en serait fait sentir.
La France n'en restait pas moins une des grandes puissances et son influence se faisait sentir en Italie. Depuis l'affaire d'Ancône, au début du règne, les Etats Pontificaux étaient dans la sphère d'influence française tandis que le Royaume de Piémont Sardaigne restait un allié fidèle. Les Bourbons de Naples, quant à eux, eurent vite faite de vaincre la solidarité dynastique et leur répugnance en faveur d'un pragmatisme diplomatique les conduisant à se rapprocher à nouveau de la France.

Ainsi, si les Etats d'Italie centrale sont sous l'influence de Vienne, la France a avec elle les trois plus grands États de la péninsule dans un partage qui convient tant à Vienne qu'à Paris : le statut quo y est la règle première.
Parmi les affaires urgentes de 1836 figurait l'affaire d'Espagne. La reine Isabelle faisait face à l'insurrection de Don Carlos et à Paris, une partie de la Chambre soutenait l'intervention. Fallait-il remettre pied en Espagne, une fois de plus? Malgré le danger qu'aurait représenté une victoire des Carlistes, Louis-Philippe n'y tenait guère. Tant par tempérament personnel que pour ménager le Royaume-Uni et éviter une aventure militaire incertaine. Le gouvernement français se contenta donc, pour le moment, de formuler de chaleureux vœux de succès pour les forces constitutionnelles, espérant ne pas avoir à se couvrir sur les Pyrénées en cas de victoire de Don Carlos. La montée sur le trône des Carlistes pouvant avoir d'incalculables répercutions en France en revigorant l'agitation légitimiste, Paris surveillait alors très précautionneusement la situation dans la péninsule.

Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'y vous prennent pour des cons? Et vous avez raison, mais eux aussi! Parce que depuis le temps qu'y vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors puisqu'on est tous des cons et moi le premier, on va pas se battre.
- jmlo
- Prince aux sandales d'argent

- Messages : 11011
- Enregistré le : mar. août 17, 2004 7:50 pm
- Localisation : République bananière
- Contact :
Re: A toutes les gloires de la France.
Coelioaheuc a écrit :"La gauche dynastique" c'est quoi/qui exactement ?
ça fait plaisir de lire un AAR avec du texte de Palpat
Reste à avoir bon cœur et ne s'étonner de rien (Henri II)