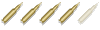Alors même que la cour impériale de Vienne encaissait la nouvelle de la sévère défaite subie par les armes impériales à Ingolstadt, une autre nouvelle vint assombrir encore l'ambiance. Il semblait que décidément la providence abandonnait le parti des tenants de la foie catholique.
A Rome, en effet, le Pape Grégoire XV rendait son dernier souffle. Aussitôt, 55 cardinaux entrèrent en conclave pour désigner son successeur. ( IRL: début du conclave le 19 juillet 1623).
Mais ce conclave débuta sous de sombres augures. La malaria, qui sévissait dans le Latium, décimât le collège curial comme si les cieux venaient châtier les représentants du Seigneur, les frappant d'infamie.
Dans une ambiance de fin du monde, le Cardinal Maffeo Barberini reçut cinquante voix, et prit le nom d'Urbain VIII. Le trouble de son élection ne retombât pas immédiatement, car Barberini reporta son intronisation au 29 septembre, en raison des fièvres qui sévissaient toujours à Rome et menaçaient la santé fragile des membres de la Curie.

Urbain VIII par Le Bernin :

Ayant une haute opinion de lui-même, Urbain VIII fit tout pour imposer son autorité à l’épiscopat catholique: il enjoignit à tous les évêques exerçant des fonctions, cardinaux compris, de respecter la résidence de leur évéchés, ordonné par le Concile de Trente. Ce faisant, il se heurta à la morale vacillante et malléable de nombreux prélats, dont l'ambition politique se voyait compromise par une telle injonction.
Cela passait d'autant moins que Urbain VIII nomma plusieurs membres de sa famille à des charges honorifique. Cela commença par son frère, nommé grand pénitencier, puis bibliothécaire du vatican, et enfin cardinal. Un neveu, Francesco Barerini, fut sacré cardinal 3 jours apres le sacre. Un autre neveu, Antonio Barberini, fut sacré cardinal au bout de quelques mois, puis nommé camerlingue et enfin commandant des troupes pontificales. Un troisième neveu enfin fut fait prince de Palestrina et Prefet de Rome.
Si la pratique du népotisme était pratiquée de toutes les élites européennes, elle n'en attirait pas moins de nombreuses critiques de ceux-la même qui espérait recevoir autant de largesses.
Ambitieux et appréciant le luxe, Urbain VIII finançait aussi de grand projets somptuaires. Il fit achever le palais Barberini par Le Bernin.
Le palais Barberini :

Il fit fortifier le chateau Saint-Ange. Il alla jusqu'à faire arracher le bronze du revêtement des poutres du portique du Panthéon pour en faire le célébrè baldaquin surplombant l'autel pontifical de la basilique Saint-Pierre, s'attirant les foudres et les sarcasme des romains, qui disaient "ce que n'ont pas fait les barbares, les Barberini l'ont fait".
Le Baldaquin, par Le Bernin :

Abusant de leur crédit, les Barberini voulurent enlever au duc de Parme, Edouardo Farnese, les duchés de Castro et Ronciglione, et firent déclarer la guerre à ce prince par les Etats de Saint-Pierre. C'en était trop, les soutiens de la famille Barberini les abandonnèrent les uns après les autres, et après d'inutiles efforts, ils durent abandonner ce projet.
De telles pratiques honteuses et dispendieuses pratiques grevaient par trop la quantité de subsides alloués à la lutte armée contre les protestants d'Allemagne. Une coterie de prélats rattachés aux Habsbourg, menés par le cardinal Borgia, reprocha bien vite la molesse d'Urbain VIII dans sa lutte contre les hérétiques.
L'affaire Galilée
De longue date, les jésuites et les extrémistes catholiques dénonçaient les thèses galiléennes.
L'amitié, de notoriété publique, qui liait Maffeo Barberini et Galilée, celui-ci ayant commandité et financé l'étude astrologique de celui-la, mettait le pape en difficulté au moment où il n'avait plus que des ennemis à la curie.
Urbain VIII, pour se sauver, fut contraint d'accepter le procès de l'astrologue.
Toujours ami du savant, et compte tenu de l'abjuration de Galilée, Urbain VIII put cependant adoucir immédiatement les conditions de détention de l'astrologue.

La famille Barberini finalement se rendit si odieuse par ses excès en tout genre, qu'à la mort d'Urbain VIII, la famille fut contrainte de se réfugier en France pour échapper aux vendettas qui les visaient de toute part.
Pour la cause impériale autrichienne, un appui moral et diplomatique important s’éclipsait sous leurs yeux à un moment critique !
Dans la situation difficile où il était, Ottavio Piccolimini fit preuve d'une énergie immense, bien décidé à sauver son armée.
Sans laisser le temps aux deux Christian (Kristian IV et Christian de Brunswick-Luneberg ) d'exploiter leur victoire d'Ingolstadt, Piccolimini mena une retraite rapide et éreintante jusqu'au fin fond de la Styrie, où il espérait recomposer ses forces, hors d'atteinte de l'ennemi, à l'abri. Il atteignit la ville ou Johannes Kepler avait enseigné 25 ans plus tot: Graz.

Pour Cordoba en revanche, nulle difficulté insurmontable ne se dressait devant lui et son armée. Les effectifs réduits de Georg Friedrich von Bade-Durlach ne représentaient pas une menace réelle pour ses tercios. Depuis Mannheim, sur les bords du Rhin, il marcha à l'ouest et reprit sans coup férir le contrôle de la Lorraine.

Round 2
Devant l'armée espagnole de Cordoba, von Bade-Durlach préférait éviter la confrontation. Il évacua la vallée du Rhin, où il savait les Espagnols encagés par d'impérieuses limites politiques ( par la ligne d'action du jeu oui !!), et en traversant la Foret-Noire, parvint à Nurenberg.
Suite à leur victoire d'Ingolstadt, les princes protestants savouraient leur victoire. Mais ils se reposèrent trop sur leur lauriers. Les affaires politiques de son royaume et les tensions avec la Suède détournèrent Kristian IV un moment de sa campagne. Les princes protestants laissèrent ainsi s'échapper l'opportunité de poursuivre Piccolimini, et peut-être de détruire son armée. Il ne serait alors resté, hormis les Tercios de Cordoba cantonnés à la vallée du Rhin, que la force réduite de Pappenheim, pour contrer les armées protestantes. Dans un accès d’exhalation contagieux, l’évêque de Brunswick se voyait déjà mettre à bas l'autorité Habsbourg et raser Vienne jusqu'aux fondations.
Kristian IV, qui avait jusque là opéré dans le nord de l'Allemagne pour son profit personnel, adhéra à l'enthousiasme de son homonyme. Briser l'autorité de l'Empereur aurait garantie l'acquisition définitive par son royaume de toutes ses conquêtes.
Cependant, Ingolstadt, insoumise, barrait toujours la route du Danube. Kristian IV n'aimait pas l'idée d'affaiblir son armée à un moment si crucial, en masquant la forteresse par un détachement de ses forces. L'armée protestante fit volte-face, remontant au nord. Pendant quelques temps on pu croire qu'elle se résignait à marauder en Allemagne centrale, mais le soulagement fut de courte durée.
A marche forcée, la coalition luthérienne progressa vers Nurenberg, puis passa en Bohème à Pilsen. De là, leur armée opta pour un axe au sud. Linz, qui fut si souvent utilisé comme point de passage sur le Danube, vit encore un déferlement de troupes se répandre dans ses campagnes et ses bourgs avant de franchir le fleuve sur le bac qui équipait la ville. Massée sur la rive gauche du fleuve, l'armée ne s'écoulait qu'au compte goutte sur l'autre rive. Christian de Brunswick, impatient, fit alors construire une flottille de barques et de radeau. Ses sapeurs et ses mercenaires abattirent à cet effet tant d'arbres dans les environs qu'il n'y eu plus ni bosquet, ni vergers, ni futaie, à des lieux à la ronde.
Pressant leur troupes, les généraux luthériens traversèrent donc l'obstacle: ils désiraient ardemment rattraper Piccolimini avant que celui-ci n'ait put se refaire une santé. Une fois le Danube franchit, l'armée luthérienne s'enfonça résolument dans les passes du Tyrol. Nulle armée protestante n'avait jamais progressé si loin au sud. Elle atteignit Salzburg.

A Graz, Piccolimini apprenait avec inquiétude les progrès de l'armée protestante, chaque étape la rapprochant de lui. Lorsque la nouvelle lui parvint que les deux Christians avaient pénétré dans la vallée de la Salzach, l'effroi et le trouble se répandirent à la cour de Vienne.
Piccolimini cependant ne chaumait pas. Il fit venir à lui nombre de régiments et de condottas alors en garnison au sud des Alpes, depuis le Milanais jusqu'à Naples. Il embaucha des mercenaires ainsi que de nouvelles recrues mal dégrossies.

Pour financer toute cette armée, il engagea sa cassette personnelle, mais mit aussi à contribution viles et bourgs, depuis la Styrie jusqu'à la Hongrie, laissant deviner les destructions que les Danois et leurs alliés ne manqueraient pas de commettre s'il ne leur barrait pas la route.
( recrutement 2 milices et un demi mercenaire).
Round 3
A mesure qu'il approchait de l'armée autrichienne, Kristian IV prenait conscience que l'avantage numérique de ses troupes s'amenuisait chaque jour, Piccolimini recrutant à tour de bras. Le roi danois tenait à s'assurer la supériorité. Grace aux estafettes envoyées par Christian de Brunswick, les deux chefs de guerre purent aisément persuader Georg Friedrich de Bade de venir renforcer leurs effectifs.
Alors que la campagne avait débuté dans l'euphorie et la certitude d'abattre l'armée Habsbourg, peu à peu Kristian IV entrevoyait des raisons de s’inquiéter. Une course contre la montre était engagée entre l'arrivée des renforts badois et l'embauche de troupes par les catholiques.
Kristian IV préféra taire son inquiétude: l’évêque de Brunswick, lui, diffusait autour de lui la vision messianique de leur armée triomphante écrasant les papistes. La troupe affichait d'ailleurs un moral de conquérant: n'était on pas en train de fouler au pied l'autorité de l'Empereur au cœur de ses possessions ancestrales ?
Lorsqu'enfin les miliciens badois firent leur jonction avec le reste de l'armée luthérienne, un immense espoir tenait lieu de détermination à l'armée !
L'armée de l'Union Evangélique marcha droit sur Graz. L'élan pour venir à la rencontre de Piccolimini donna des ailes aux protestants, qui couvrirent la distance si vite que l'armée impériale fut surprise ( et encore Surprise attack). La désorganisation entre officiers impériaux engendrait d'ailleurs un certain désordre et pas mal d’atermoiements ( command rivalry, encore !!).


Au sein de cette vallée étroite et encaissée menant de Salzburg à Graz, la place manquait pour se déployer et manœuvrer.

L'avantage serait donné aux gros bataillons, dans un engagement sans subtilité. Pourtant, l'élan protestant initial s'essouffla très vite. L'on croyait voir plier les rangs catholiques, étriqués, désespérés, aux abois. Il n'en fut rien, et le doute saisit les soldats protestants lorsque leurs pertes s'accumulèrent dans de confuses mêlées.
A la fin de la journée, les chefs protestants durent se résoudre au repli, après une journée indécise. Ils revenaient stationner à proximité de Salzbourg, sans avoir anéantie l'armée impériale !

Pendant que la principale armée protestante s’enfonçait loin au sud dans les terres impériales, Ernst von Mansfeld changea à nouveau de théâtre d'opération. Il avait jusque là prudemment et méthodiquement mis au pas le nord de l'Allemagne ( hormis la Poméranie).
Face au vide qui existait entre lui et la vallée du Danube, où semblait devoir se jouer le sort de la guerre, il n'hésita pas à revenir à Kassel. Il espérait, de là, contester la prédominance catholique sur le Bas Palatinat, mais surtout croiser le fer contre Cordoba qui reprenait peu à peu le contrôle des terres lorraines. Il lui incombait de reprendre l'avantage sur le Rhin. Le trajet de son armée traversa la Hesse et l'amena en Franconie, à Wurtzbourg. Mais pour franchir le Rhin se dressaient devant lui deux obstacles de taille: les forteresses de Heidelberg et de Mannheim...
Wurtzbourg :

Ernst von Mansfeld affiche un petit sourire. Juché sur un grand destrier, il s'est couvert d'un lourd manteau pour s'abriter du froid nocturne.
Devant lui, le flanc d'un coteau hérissé de grands pins et de châtaigniers dévale abruptement, pour s'estomper et disparaitre dans l'obscurité qui englobe le monde. Un ruban d'un noir profond, plus intense encore que le ciel, coupe le paysage dans le sens de la largueur, marquant le cours du Neckar à l'endroit où il rejoint le Rhin.
Au dela de ce trait noir, des lueurs disséminées dans le paysage trahissent l'habitat des hommes qui vivent le long du fleuve.
Comme illuminé depuis le bord d'un opaque chaudron, une cuvette emplie de toits de briques et de clochers révèle la concentration d'une ville dont seule le faite émerge de son rempart. L'oeil collé à sa lunette, Mansfeld discerne les fugaces ombres mouvantes animées par les sentinelles de faction le long des chemins de ronde, comme un trouble dans la clarté diffuse répandue par les torches et les braséros placés de loin en loin pour réchauffer et rassurer les sentinelles. Abaissant le champ de vision de sa lunette, Mansfeld cherche à deviner dans un paysage estompé la berge du Neckar la plus proche de la citadelle, mais il est impossible de distinguer quoi que ce soit dans le noir.
La vallée de la Neckar dans le soir :

Juchés sur leurs montures, plusieurs hommes entourent Mansfled, scrutant de même le paysage enténébré, ou parlant à bvoie basses, ou encore flattant l'encolure de leurs destriers dont de discrets piaffements troublent le silence.
L'homme le plus proche de Mansfeld se penche vers lui et l'apostrophe:
- Pourquoi souris tu Ernst ?
Le sourire de Mansfeld s'aggrandit.
- Tu m'a demandé comment on allait passer, Théophile, et qu'il faudrait un miracle pour éviter la forteresse. Sache que tout vien à qui sait attendre !"
S'essuyant les mains moites sur son surcot, Fritz avance d'un pas nonchalant vers l'écurie dont les appentis masquent le fond de la cour pavée. Palefrenier de son état, son trajet n'attirera l'attention de personne au sein de la garnison. Une fois dans l'écurie, progresser à l'abri des regards, entre les stales, est aisé. De temps à autre, il se retourne, surveille que les deux lascars qui lui emboitent le pas ne s'égarent pas.
Fritz rumine, une colère sourde lui ronge les entrailles. Il va enfin pouvoir se venger de tant d'humiliations. Voila 4 ans que les armées bavaroises avaient pris la place, 4 ans qu'une garnison de soldats catholique y avait pris ses quartiers, 4 ans qu'un officier avait été placé par le général Pappenheim pour commander la citadelle. Les soldats du duc de Baviere avaient évincés le personnel précédent. Maréchal-ferrant, apothicaire, valets, avaient étés recrutés au sein de la population locale loyale à la cause catholique. Mais pas Fritz. Fritz était trop simple, trop idiot pour faire du mal à une mouche, à ce qu'on disait. Incapable de distinguer la vraie foie de la foie corrompue. On pouvait lui faire adresser des prieres à la Vierge ou au Pape, bien sur ! On l'avait gardé comme palefrenier.
Mais Fritz n'avait rien oublié, rien pardonné.
Fritz, sortant de l'atelier attenant à l'écurie, marcha résolument le long du haut mur qui défendait la forteresse, le long d'un étroit passage pavé et ouvert à tout les vents. Deux soldats battaient le pavé au bout de ce couloir, l'un une pique adossée à l'épaule et le morion de guingois, l'autre les deux mains frileusement glissées sous une lourde cape de laine.

- tiens, Fritz, encore debout ? C'est tes deux cousins ? Que font-ils avec toi ici Fritz ?
Fritz serre les dents à s'en crisper la machoire. Il a déja approché ce couloir à deux reprises ces dernières semaines. La première fois, il était venu seul, en fin de journée. Il avait prétendu vouloir aider les braves soldats de faction et leur permettre de se reposer. On l'avait éconduit en lui suggérant d'aller vider les seaux de crottin, ce qu'il savait faire de mieux. A ce souvenir, les dents de Fritz grincèrent les unes contre les autres. Il était reparti si humilié !
Il avait retrouvé son mécène dans un des estaminet de la ville basse. L'homme semblait contrarié, mais pas contre lui, contre les tourmenteurs de Fritz. Il était arrivé en ville quelques jours plus tôt, négociant catholique en affaire ici pour quelques jours selon ses dires. Il avait fini par compatir au sort de Fritz, aux brimades qu'il subissait de la part des soldats de la garnison.
Il lui avait révélé que sa foie avait fluctué. Les odieux représentant du Pape avaient lachés des reitres sanguinaires sur son village, massacrants ses habitants. Quelques rares survivants, dont il avait été, durent se convertir. Peut-être Fritz désirait il l'aider à se venger, et à jouer un bon tour aux papistes qui l'employaient ? Il avait produit une bourse qu'il avait tendu à Fritz, qui avait alors pu soupeser l’intérêt que cet étranger avait à le venger de ses brimades. Fritz devait juste ouvrir la poterne nord, celle qui ouvrait sur la berge du Neckar.
Son second essai avait eu lieu 3 jours plus tôt, par un jour de pluie. Peut-être avait il mal choisi son jour ? Il avait approché la poterne toujours gardée assidument. Il avait prétendu rejoindre une galante de l'autre coté de l'enceinte. On s'était ri aux éclats de lui.
-Une galante, Fritz ? Voyons, mais avec ta tronche elle à du te poser un lapin ! Elle aurait plutôt choisi un gars comme moi. Ou même comme le gouverneur, tiens !
Grand éclat de rire des deux gardes, qui reprennent :
- Non, franchement, Fritz, vu ce qu'il tombe ce soir, ta galante serait trempée des pieds à la tête, elle du te poser un lapin. A moins que ce ne soit une putain, Fritz, à qui tu as promis un liard ou deux. Mais même les putains posent des lapins, l'ami. Elles ne voudraient pas de ta gueule dans leur giron. Allez, file !
C'était une humiliation de plus, qu'il avait rapporté à l'étranger. Celui-ci avait paru tres intéressé par son histoire. Il avait compatis à ses brimades, et lui avait suggéré la manière forte. Alors, Fritz était aller quérir ses deux cousins chaudronniers, deux malabars à la tête creuse. Les soldats de la garnison allaient voir qu'on ne devait pas se moquer de Fritz. Il avait tant de rage qu'il aurait pu mordre quiconque se serait interposé sur son chemin.
Ses deux cousins derrière lui, Fritz savourait le moment, le dernier de ses humiliations.
-T'a besoin de tes deux cousins pour ne pas trembler dans le noir de ton écurie, Fritz ?
Le rire des deux gardes s'étrangle vite. D'un claquement de doigts, Fritz a relaché ses deux cousins, qui n'attendaient que ça. Des buches faisant office de gourdin surgissent de leurs manches, sont brandies haut. Un des gardes s'écroule, mais l'autre a empoigné sa rapière, et fend l'un des cousins. Fritz n'est pas resté sans rien faire, il dégaine une dage, qu'il plante dans la gorge du garde.
Il y a désormais 3 corps affalés dans ce petit passage. Le cousin survivant de Fritz s'est agenouillé à coté de son frère, les yeux larmoyants, désemparé, cherchant à comprendre, à être rassuré. Fritz n'en a cure. Il s'approche de la poterne, et fait jouer la clenche de l'huis, laissant la lueur des torches se répandre vers l'extérieur si sombre.
Une forme apparait au milieu de nulle part, puis une dizaine sur ses talons. Des hommes, revêtus de capes noires. Aucune piece d'armure ne les trahit par un cliquetis sonore; en revanche ils ont l'épée au poing ou le pistolet en main, et plusieurs ont des mousquets à l'épaule. Le premier se présente devant Fritz, le dévisage, se glisse à coté de lui dans le passage, bientôt suivi par ses 10 comparses. Un coup d'oeil rapide à l'homme agenouillé et sanglotant à coté d'un corps allongé au sol, celui-ci ne semble pas poser de soucis.
-Fritz ? demande tout a trac celui qui semble être le chef de cette petite troupe. Mène nous à la poudrière maintenant !
D'un hochement de tête, Fritz acquiesce, puis se ravise. Il empoigne sa dague, et l'assène violemment au visage de son cousin, lachant, rageur "mais cesse donc de geindre, imbecile !". Sous le regard interloqué des hommes en armes, et sans un mot d'explication Fritz abandonne là son cousin agonisant, prenant la tête du petit groupe, en direction de l'armurerie.
Le déplacement furtif des envahisseurs leur assure la surprise. Quelques sentinelles sont réduites au silence. L'armurerie est investie, et 6 hommes armés jusqu'aux dents s'y barricadent aussitôt. Réduit à 4 assaillants, le groupe approche des baraquements de la garnison, bifurque vers un autre bâtiment, pénètre dans les appartements du gouverneur.

Devant la lourde porte close, les soldats s’agglutinent en silence. Leur chef hésite à toquer, et un moment de tension vient éprouver les nerfs de tous. Sauf Fritz, qui semble bouillir sur place et se contient difficilement pour ne pas crier. Le chef de la bande toque à la porte un code convenu. Le battant grince en s'ouvrant. Soulagement. Une jeune femme rondelette, en tenue tres négligée ne cachant quasiment rien de ses charmes, ouvre. Elle arbore un grand sourire et tend fièrement une clef de bronze devant elle.
Le chef jette un coup d'oeil derrière elle. Avachi sur une banquette, un homme en calecon ronfle, entravé au niveau des poignets par une chaine en fer, et les pieds et les coudes fagotés dans une corde. Avec un sourire espiègle, la jeune blonde rajoute " il dormait d'un mauvais vin avant même de savoir que je le ligotait !"
-Parfait, tu as tenue ton rôle. Prend cette bourse et rhabilles toi, puis file ! Je te conseille d'avoir fait tes bagages aavant le petit matin, et de détaler au loin.
Plantant un baiser sonore sur la joue du chef, la jeune délurée le rassure :" avec ce que tu viens de me payer, beau gosse, je serais tranquile et bien loin d'ici demain soir !". Elle ramasse ses effets, et sans pudeur se revet devant les soldats avant de s'esquiver dans la nuit.
Fritz lui, s'est rapproché de l'homme qui cuve. Il renifle dédaigneusement, puis lui crache dessus. Il empoigne sa dague, s'approche du poivrot. Le chef des soldats saisi son bras.
- "Que fais tu ?"
-mais, ce qu'il mérite. je vais le tourmenter comme lui et ses hommes m'ont tourmenté.
- Hors de question, nous en avons besoin !
- Il était question de ma vengeance, par Dieu !
Le ton monte, Fritz ne se controle plus, ses éclats de voix seraient bien susceptibles d'ameuter toute la garnison, et ses grands gestes avec sa dague au poing pourraient blesser quelqu'un. Deux des soldats, glissés dans le dos de Fritz depuis un moment ont le regard fixé attentivement vers leur chef. Celui-ci opine du bonnet, fugacement. Alors, tandis que l'un d'eux plaque ses mains sur la bouche de Fritz et crochète son bras droit, l'autre lui passe 10 pouces d'acier a travers le corps, et le laisse s'affaler sur le carrelage qui se couvre de sang.
Dans l'aube blème qui point, Ernst von Mansfeld commence à distinguer le paysage. Quelques maisonnées bordent le pont qu'il convoite, sur la rive orientale du Neckar. De l'autre coté de la rivière, elles s'agglutinent aux murs bastionnés de la citadelle, formant un maigre faubourg d'où s'élèvent quelques filets de fumée des cheminées. A l'extrémité de la ville, quelques toits surmontent le reste de l'agglomération: ceux de la citadelle, dont seuls les sommets de bâtiments émergent.
Mansfeld scrute à s'en faire mal aux yeux. Alors, il lache un hoquet de rire. Déployé au dessus d'un toit, un étendard blanc flotte mollement, à peine soulevé par le vent du matin.
Mansfeld vocifère ses ordres "Mettez la troupe en marche, tout le monde en route immédiatement !! La cavalerie file me prendre ce pont !'
Puis, se tournant vers son second qui l'avait apostrophé en pleine nuit, Mansfeld lache, triomphal:
"Tu m'avais dit qu'il faudrait un miracle, Théo ? Je t'offre mieux. Je t'offre la FBI ! La Forteresse Bien Incapable !"
C'est un spectacle étonnant et qui ne lasse pas d’inquiéter, qui s'offre à la garnison de Mannheim. Empruntant le pont qui franchit la Neckar juste sous les murs, une armée défile à portée de canon. D'abord prudemment, puis de plus en plus vivement, un fort parti de cavaliers est venu s'assurer du pont à l'aube, l'a franchit.

Les officiers catholiques ont réagit. Quelques coups de canon ont tonnés, et l'un d'eux a fauché 2 cavaliers en percutant le parapet de bois du pont. Le crépitement d'une arquebusade a suivi, puis s'est vite tu: les cavaliers luthériens étaient hors de portée de leurs armes. Seuls les canons de la place auraient pu les massacrer. Les canons n'avaient que quelques boulets au pied de leurs affuts, et une seule gargousse de poudre. Il fallait ouvrir l'armurerie prestement, il fallait réveiller le gouverneur de la place.
C'est alors que la garnison constata son impuissance. Sur le toit de la maison du gouverneur, un drapeau blanc pendait mollement. A l'intérieur, le gouverneur était tenu en otage par plusieurs hommes armés. L'armurerie était barricadé et tenue de même. Bien que désireux de faire leur devoir, les subalternes du gouverneur en étaient incapables.
Sur le Neckar, Mansfeld s'est faufilé au milieu des rangs de ses soldats. Juché sur son cheval, il assiste à l’atermoiement et à l'hésitation de ses cavaliers d'avant garde qui viennent d'essuyer une salve provenant de Mannheim. Mais tres vite la citadelle se tait. Il saisit l'opportunité, et encourage son armée à franchir le pont.
Impuissants, les hommes de la garnison de Mannheim contemplent les colonnes d'hommes, de chariots, de cavaliers, de canons, qui défilent à peu de distance sous leurs murs.
Enfoncer à coup de bélier la porte de l'armurerie aurait pu être rapide et aisé sans la défense des hommes embusqués derrière et foudroyant de quelques tirs précis les soldats catholiques qui cherchaient à mettre à bas cette barricade. La mort dans l'ame, la garnison ne put que laisser faire. L'armée de Mansfeld aurait-elle donné l'assaut qu'elle aurait pu se défendre un moment, à la pique et à l'arquebuse. Mais l'armée protestante se contentait de cheminer. Le verrou sur la Neckar avait été escamoté.
Mansfeld était déja loin depuis deux jours quand le parti d'hommes en arme qui avait assailli Mannheim l'évacua. Un sauf conduit signé sous la contrainte assurait la sortie de la place à cette petite troupe, qui était amoindrie de deux d'entre eux, blessés durant l'assaut sur la poudrière, et qui avaient expirés. Le gouverneur fut l'invité de ce groupe, qui sortit sous le regard furieux des soldats de la garnison, avant de détaler sur de bons chevaux. Le gouverneur fut retrouvé entravé à un arbre, en tenue d'adam, le soir même. Le honte qu'il avait subi l'incita a disparaitre, ce qui lui permit d'échapper au procès que la chancellerie bavaroise avait l'intention de lui intenter.
Le franchissement de la Neckar par Mansfeld fut un coup de tonnerre, un de ceux qui feraient date dans cette interminable guerre.
Cordoba, qui se pensait à l'abri derrière l'écran du Rhin et de ses forteresses, se retrouvait désormais menacé par un adversaire redoutable.
(bon, on s'est rendu compte bien plus tard qu'on avait oublié cette forteresse sur la route de Mansfeld, et tant de choses s'étaient passés qu'on n'est pas revenu en arrière
Alors que Mansfeld surprenait l'ennemi catholique par son coup d'éclat qui lui ouvrait les voies de la Lorraine, une autre campagne sans pitié se déroulait bien plus à l'Est.
Avisant la situation des deux Christians, qui avaient menés leurs force luthériennes au cœur des vallées de Carinthie et de Styrie, le Graf Gottfried von Pappenheim, toujours stationné en Bavière, conçut une manœuvre susceptible de perdre l'adversaire. Il vint se positionner à Linz et coupait toute voie de retraite à l'armée luthérienne qui était à Salzbourg.
On voit Pappenheim et une armée réduite à Linz, les protestant à Salzburg, et Piccolimini à Graz :

Déja résolu à se porter au contact de l'armée germano-danoise, Piccolimini n'en fut que plus motivé encore lorsque ses coursiers lui apprirent que Pappenheim lui offrait un précieux concours. Piccolimini mit son armée vers Salzburg, où l'armée de ses ennemis attendait le choc, privé échappatoire.
Salzburg :

Une vue sur la vallée de la Salz en amont de Salzburg, où les protestants attendent Piccolimini :

L'étroitesse du champ de bataille continuait à limiter les manœuvres d'approche. Les adversaires devaient compter sur leur nombre ou leur résolution. Piccolimini était confiant, son armée était plus nombreuse. Il négligea la détermination des protestants qui se savaient acculés, et opposèrent une vive résistance. ( 0 au dé catholique
Piccolimini avait pris la précaution dès le début de l'engagement d'envoyer plusieurs escadrons s'emparer des cols par où l'ennemi aurait put s'esquiver, et plaça quelques batteries sur des hauteurs d'où elles pouvaient atteindre la ville.
L'armée protestante était cantonnée dans Salzburg et ses alentours immédiats, et ne pouvait plus en sortir.
Les pourparlers s'engagèrent entre les deux partis. Privés de munition et de vivre, l'Union Evangélique ne pouvait éviter la rédition.
Kristian IV de Danemark fut contraint à signer une paix rude. Les restes de son armée pouvait rentrer au pays, mais chaque homme dut preter serment de ne plus porter les armes contre aucune des nations catholiques engagées dans le conflit. Kristian dut racheter sa liberté, et dut donner des garanties à Vienne.
Christian de Brunswick, l’évêque exalté, blessé dans la bataille, se retrouva en prison, où il finit sa vie quelques mois plus tard des suites de ses blessures.
Georg Friedrich de Bade-Durlach parvint a fuir en barque le long de la Salzbach, échappa à Pappenheim, et chercha refuge aux Provinces Unies, où il vécut dans la misère.
Charles-Bonnaventure de Longueval, comte de Bucquoy, avait participé à toute la campagne en dépit d'une santé qui déclinait. Mais ses forces l'abandonnèrent et il rendit son âme a Dieu peu de temps après, reconnaissant d'avoir vu les armes impériales victorieuses.
En dépit du fait que les armées autrichiennes opéraient dans le sud de l'Empire, les Ottomans firent le pari que quelques incursions rapides n'attireraient pas l'attention de celles-ci.

La campagne de Piccolimini avait mobilisé l'attention de l'Empereur et de l'ensemble des cours européennes. Un répit était nécessaire.
Face à la déroute de ses partisans, la Suède fournit un nouvel effort financier, mais qui ne pouvait bénéficier qu'à Mansfeld.

A Nancy, Cordoba était confronté aux pires difficultés pour nourrir et solder son armée. La peste avait durement frappé la ville, et la part des habitants survivants fut contrainte de subvenir aux besoins des Tercios. Les moyens de subsistance, trop chiches, ne pouvaient alimenter l'armée espagnole. Celle-ci perdit une part de ses effectifs par sous alimentation, maladie, ou désertion.
Cordoba, pour maintenir la discipline, eut recours à la justice militaire la plus expéditive. Les déserteurs rattrapés, où qui revenaient d'eux même en espérant sa clémence, subirent l'estrapade, servant d'exemple au reste de l'armée.