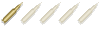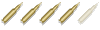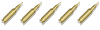Les critiques contre la politique extérieure étaient les plus vieilles que l'on faisait à la monarchie de Juillet. Depuis 1830, le malentendu régnait entre radicaux, gauche dynastique et conservateurs. Pour les têtes les plus froides, 1830 ne visait qu'à faire régner l'ordre constitutionnel et tout était accompli avec l'abdication de Charles X et la révision de la Charte. D'autres esprits souhaitaient étendre le changement de régime à la diplomatie. L'ordre de 1815 devait être abattu en Europe après avoir été abattu en France. Bien sûr, ces éléments étaient furieux que la politique modérée qui était celle de la France depuis 1830 continuât. Les critiques se multipliaient à la tribune de la Chambre et dans la presse, le moindre soubresaut extérieur étant l'occasion de reprocher au gouvernement sa soumission à l'ordre européen voire, bien pis encore, sa participation active à la politique de la Sainte Alliance.
La révolte de Norvège fut l'une de ses causes soudainement brandies en étendard. Unie à la Suède sous le régime de l'union personnelle en 1814, la Norvège n'avait accepté cette domination qu'après une résistance militaire et bien malgré elle. Fin 1843, les troubles reprirent dans la partie norvégienne du royaume et au mois de décembre, la Suède en avait perdu le contrôle. A Christiana, les nationalistes norvégiens proclamèrent leur indépendance, votèrent la déchéance des Bernadottes et adoptèrent une constitution républicaine. La Suède entama bien sûr des opérations militaires visant à rétablir l'ordre en Norvège et bientôt les deux entités furent en guerre.

A Paris, sans surprise, une bonne partie de la gauche et les radicaux s'enflammèrent pour les Norvégiens. On forma des légions de volontaires, il y eut des banquets, des collectes. Le gouvernement laissait faire, préférant voir les plus radicaux se faire tuer en Norvège plutôt qu'agitant les esprits dans les cabarets. Il fallut, cependant, répondre par la presse amie et à la tribune aux accusations, voire aux imprécations, que jetaient les "norvégiens" à la tête du ministère.
Ce dernier avait fait le choix très compréhensible de la neutralité. La France n'avait que peu d'intérêts dans cette région d'Europe et la rupture tout comme le maintien de l'union suédoise n'aurait en définitive que des conséquences minimes sur l'équilibre en Europe. Enfin, la révolution norvégienne n'avait que peu de risques de se répandre considérant l'isolement norvégien et la modération de leur révolution. La France continua donc ses relations avec la Suède et se garda de s'ingérer dans le conflit. Les envoyés que la Norvège envoyait à travers les cours libérales pour quémander de l'aide furent reçu discrètement avec politesse mais repartirent les mains vides. Si la Norvège triomphait et arrachait son indépendance, il serait bien temps d'établir des relations officielles en bonne et due forme.

La prudence paya. Après un an et demi de campagne dans les neiges et les montagnes de Norvège, les Suédois parvinrent à faire capituler leur adversaire dont les chefs s'exilèrent, qui au Nouveau Monde, qui à Londres. Un nouveau Storting fut élu, répudia les proclamations révolutionnaires comme nulles et non avenues et restaura le roi du Suède sur son trône de Norvège. A lire certains des titres de la presse libérale, on eût cru que c'était là une défaite de la France, une de plus.
Si la Norvège déclenchait la tempête dans la presse d'opposition, la Crise d'Orient formait un ouragan. Cette affaire couvait depuis les années 1830 et la première guerre ayant opposé Mehemet-Ali au sultan de Constantinople, conflit à l'issue duquel le Pacha d'Egypte avait adjoint la Syrie à son domaine. Il était depuis évident que la guerre devait reprendre un jour, la question restant ouverte tant que la question de l'hérédité du pachalik et de la possession de la Syrie ne seraient pas formellement closes. La guerre reprit en 1842 entre les deux puissances mahométanes d'Orient. De nombreux, très nombreux intérêts étaient en jeu dans cette complexe affaire. Les Russes y voyaient l'occasion, comme dans les années 1830, d'avancer vers Constantinople pour mettre la Porte sous leur protectorat. Les Autrichiens craignaient l'effondrement Ottoman, les Britanniques désiraient le statu quo afin de protéger leur domination en méditerranée orientale. Chacune des puissances allait intervenir d'une façon ou d'une autre.
La France, quant à elle, entretenait de bonnes relations avec le Pacha d’Égypte, ayant contribué à la formation de son armée. Cela justifiait-il l'intervention? Pour la gauche et même pour une partie du cabinet, oui. La France devait s'engager dans cette affaire et obtenir pour son allié l'hérédité en Égypte et en Syrie. La France aurait ainsi mis l’Égypte dans sa sphère d'influence sans tirer un coup de feu et en laissant les autres puissances régler le sort de l'Empire Ottoman. Le Roi ne souhaitait cependant pas lancer la France dans une politique aventureuse qui eût pu l'amener à la guerre. De plus, le traité de cession de la Nouvelle-Zélande avait été négocié moyennant un engagement français de neutralité en Orient. Le gouvernement dut se ranger à la solution honorable : la France avait donné sa parole à une puissance amie et n'avait pas d'engagement avec l'Egypte. Nos ambassadeurs reçurent donc comme consigne d'annoncer et de défendre la neutralité française dans cette crise et d'expliquer que la France reconnaitrait le fait accompli qui sortirait des événements en cours.

Le ministère fut-il bien inspiré? Après deux ans et demi, la guerre continuait en Orient et les puissances avaient été contraintes à l'intervention directe. Les seules puissances en état de le faire étaient l'Angleterre et la Russie. Chacune avait fait le choix d'envoyer contre l'Egypte des corps expéditionnaires conséquents qui sauvèrent in extremis l'Empire Ottoman de la défaite la plus absolue et, lentement, entreprirent la reconquête des territoires occupés par les Égyptiens puis du Levant. Au printemps 1845, les Britanniques avaient débarqué à Alexandrie et faisaient mine de vouloir y rester.

Ces rumeurs et les déclarations jingoïstes de la presse de Londres excitèrent encore plus l'opposition. Depuis le déclenchement de la crise, cette dernière était l'angle d'attaque favori de l'opposition. Elle accusait le ministère d'abandonner lâchement un ami de la France, de tenir éloigné la France du règlement de l'affaire du siècle, de ne pas saisir l'occasion pour monnayer sa neutralité contre la révision ou l'annulation des traités, d'être Judas ayant reçu au prix de sa trahison non pas 30 pièces mais deux îles. On s'affronta à la Chambre et par journaux interposés mais la position française ne changea pas d'un pouce : neutralité.
Cette politique s'avéra sage. Mieux, elle nous évita une guerre qui aurait éclaté pour des motifs secondaires loin d'être vitaux. Qu'importait à la France que le Pacha d’Égypte fût proclamé héréditaire et qu'il obtînt la Syrie? Il nous aurait fallu affronter les Britanniques, les Russes, les Autrichiens, la Porte et sans doute la Prusse. La France aurait donc mis le pied seule dans une guerre générale perdue d'avance. Quand bien même le sort des armes nous eût-il été favorable, nous n'aurions pu qu'obtenir quelques avantages en Orient et sans doute pas les révisions générales des traités dont on rêvait dans certains cercles à Paris.
De plus, en 1845, alors que le mandat de la Chambre touchait à sa fin, il était évident que l'intervention des puissances traînait en longueur. La France aurait perdu dans cette affaire beaucoup de temps, d'argent, de sang et d'énergie. On se félicitait dans les couloirs des Tuileries d'avoir évité un tel imbroglio.