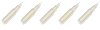à nous pondre un empire grandiose !
A.E.I.O.U.
- griffon
- Empereur Intergalactique
- Messages : 42611
- Enregistré le : mer. août 18, 2004 5:26 pm
- Localisation : Brest
Re: A.E.I.O.U.
avec une telle victoire tu devrais réussir
à nous pondre un empire grandiose !
à nous pondre un empire grandiose !
SOL INVICTVS
Au printemps, je vais quelquefois m'asseoir à la lisière d'un champ fleuri.
Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin , je ne pense guère à mon salut.
Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien
Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin , je ne pense guère à mon salut.
Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien
- Maréchal Joukov
- Domestique des Scholes
- Messages : 2861
- Enregistré le : dim. mai 13, 2007 11:37 pm
- Meilleur jeu 2008 : The Witcher Enhanced Edition
- Meilleur jeu 2009 : Dragon Age Origins
- Meilleur jeu 2010 : Mass effect 2
- Meilleur jeu 2011 : The Elder Scrolls V: Skyrim
- Localisation : Aux archives
- Contact :
Re: A.E.I.O.U.
Très bel AAR  ! Et quelle victoire
! Et quelle victoire 
Mon site d'histoire militaire: http://antredustratege.com/
Mes publications: https://orbi.uliege.be/browse?type=auth ... te+p177479
https://www.wargamer.fr/author/jeanbaptistemurez/
Mes publications: https://orbi.uliege.be/browse?type=auth ... te+p177479
https://www.wargamer.fr/author/jeanbaptistemurez/
Re: A.E.I.O.U.
Quelle culottée pour les Valois  Epoustouflant
Epoustouflant 
Re: A.E.I.O.U.
Je rejoins les commentaires de tous, j'applaudis des deux mains, c'est épique.
Re: A.E.I.O.U.
Le gigantesque conflit qui fut nommé "La Guerre de Vingt Ans" avait décidé de la proéminence en Europe Centrale. L'archiduc d'Autriche comptait d'abord intégrer culturellement et administrativement les territoires dont il venait d'acquérir la souveraineté avant de se pencher plus avant vers d'autres projets. L'archiduché avait considérablement grossi, mais la victoire n'avait pu faire taire tous les mécontents. Ces derniers se sentirent d'ailleurs le devoir de communiquer leurs doléances, maintenant qu'il n'en retournait plus d'une guerre décisive. Les hésitations à lever les armes contre Johann avaient été balayées avec le traité de paix de Paris.
 Des révoltes éclatèrent d'abord en Carinthie, où des hérétiques avaient répandus leurs dogmes impies. Puis ce fut le tour d'une poignée de Badois en mal d'attention pour des questions de vassalité seigneuriale. Vinrent des patriotes flamandes souhaitant se libérer de l'étreinte autrichienne, ainsi que des Souabes en quête d'impôts moins importants.
Des révoltes éclatèrent d'abord en Carinthie, où des hérétiques avaient répandus leurs dogmes impies. Puis ce fut le tour d'une poignée de Badois en mal d'attention pour des questions de vassalité seigneuriale. Vinrent des patriotes flamandes souhaitant se libérer de l'étreinte autrichienne, ainsi que des Souabes en quête d'impôts moins importants.
Johann Ier n'était pas homme à tolérer la rébellion de vilains. Son homme de main pour les affaires peu subtiles, le comte Tankmar de Throax, se chargea d'écraser sous les sabots de la cavalerie impériale toute vélléité de contestation. L'ordre établi affirma son pouvoir par le fer et le sang.
Pour renforcer son autorité au sein de ses acquisitions, l'Empereur forca ses nouveaux vavasseurs à prêter allégéance au Saint Empire Romain Germanique. Son prestige, troublé par l'annexion brutale des principautés du Rhin, s'en vit quelque peu redoré. La couronne impériale resterait en mains habsbourgeoises s'il venait à mourir subitement.
 Un nouvel électeur avait rejoint le collège électoral, il s'agissait là de l'évêché de Würzburg. Cette cité avait reçut l'honneur unique de pouvoir accorder un titre temporel et un autre spirituel à son souverain, dignité accordée lors de la diète d'Empire de 1168 par l'Empereur Barberousse lui-même. Ce duc-évêque soutenait encore le Prince-Électeur du Palatinat, ce qui ne saurait durer si Johann se décidait à lui accorder son amitié. À terme, ce devrait être un allié important.
Un nouvel électeur avait rejoint le collège électoral, il s'agissait là de l'évêché de Würzburg. Cette cité avait reçut l'honneur unique de pouvoir accorder un titre temporel et un autre spirituel à son souverain, dignité accordée lors de la diète d'Empire de 1168 par l'Empereur Barberousse lui-même. Ce duc-évêque soutenait encore le Prince-Électeur du Palatinat, ce qui ne saurait durer si Johann se décidait à lui accorder son amitié. À terme, ce devrait être un allié important.
La priorité immédiate d'après-guerre était toutefois de reconstituer une armée puissante, digne du nouveau pouvoir de l'Empereur. L'or arraché aux Bavarois avait été dépensé depuis longtemps, aussi les nouveaux recrutements durent-ils être menés peu à peu. Les fiefs commerciaux autrichiens devaient également être étendus, dans le but de renforcer l'indépendance de l'archiduché. Matthias Zwerger zu Mora-Dime avait rejoint l'au-delà durant la Guerre de Vingt Ans, son élève, Wolfgang Buseck von Fifirchen, était heureusement digne de lui succéder à la cour.
 Les aides pour les marchands se firent plus rares sur ordre de Johann: les plus faibles s'y ruinèrent, les plus forts y gagnèrent, c'était tout au goût de l'archiduc. Parallèlement, il eut à déplorer bientôt la perte d'un de ses plus grands généraux, Rainer-Friedrich von Stubenrauch. Visiblement épuisé par la guerre interminable, il avait succombé en ses possessions badoises durant l'été 1478. Le prince Leazow était ainsi le seul général compétent qui lui restait! Il n'était toutefois pas des moindres, surtout depuis qu'il s'était familiarisé avec l'art de la guerre autrichien à Vienne. Même le fougueux Roi des Francs ne pouvait lui tenir tête!
Les aides pour les marchands se firent plus rares sur ordre de Johann: les plus faibles s'y ruinèrent, les plus forts y gagnèrent, c'était tout au goût de l'archiduc. Parallèlement, il eut à déplorer bientôt la perte d'un de ses plus grands généraux, Rainer-Friedrich von Stubenrauch. Visiblement épuisé par la guerre interminable, il avait succombé en ses possessions badoises durant l'été 1478. Le prince Leazow était ainsi le seul général compétent qui lui restait! Il n'était toutefois pas des moindres, surtout depuis qu'il s'était familiarisé avec l'art de la guerre autrichien à Vienne. Même le fougueux Roi des Francs ne pouvait lui tenir tête!
 La réorganisation des troupes autrichiennes prit beaucoup de temps, surtout à cause de la création de nouvelles armées. Tandis que l'armée des chevaliers et l'armée des Habsbourgs (financée par la caisse privée de la dynastie) assuraient la défense des provinces mères de l'archiduché, l'armée du Rhin se chargeait de faire régner l'ordre dans l'Ouest du Saint-Empire. Finalement, l'armée impériale veillait à ce que les Flamands ne tentent pas de sottises.
La réorganisation des troupes autrichiennes prit beaucoup de temps, surtout à cause de la création de nouvelles armées. Tandis que l'armée des chevaliers et l'armée des Habsbourgs (financée par la caisse privée de la dynastie) assuraient la défense des provinces mères de l'archiduché, l'armée du Rhin se chargeait de faire régner l'ordre dans l'Ouest du Saint-Empire. Finalement, l'armée impériale veillait à ce que les Flamands ne tentent pas de sottises.
En Italie, le morcellement politique avait prit fin avec les ambitions croissantes de la Papauté, qui avait unifié toute la botte méridionale, tandis que Milan dominait le Nord, enrichi par le commerce et l'artisanat. La Sicile restait en mains musulmanes malgré un appel à la croisade. Les mahométans les plus dangereux étaient ceux d'Asie Mineure, les Ottomans. Ils avaient conquis les anciennes terres héllènes et s'avançaient dangereusement dans les Balkans. Polonais et Hongrois étaient en mesure de les repousser et Constantinople restait en mains chrétiennes, mais pour combien de temps? À terme, il se pourrait que les Ottomans viennent défier notre puissance. Une perspective peu rassurante ...


Johann Ier n'était pas homme à tolérer la rébellion de vilains. Son homme de main pour les affaires peu subtiles, le comte Tankmar de Throax, se chargea d'écraser sous les sabots de la cavalerie impériale toute vélléité de contestation. L'ordre établi affirma son pouvoir par le fer et le sang.
Pour renforcer son autorité au sein de ses acquisitions, l'Empereur forca ses nouveaux vavasseurs à prêter allégéance au Saint Empire Romain Germanique. Son prestige, troublé par l'annexion brutale des principautés du Rhin, s'en vit quelque peu redoré. La couronne impériale resterait en mains habsbourgeoises s'il venait à mourir subitement.

La priorité immédiate d'après-guerre était toutefois de reconstituer une armée puissante, digne du nouveau pouvoir de l'Empereur. L'or arraché aux Bavarois avait été dépensé depuis longtemps, aussi les nouveaux recrutements durent-ils être menés peu à peu. Les fiefs commerciaux autrichiens devaient également être étendus, dans le but de renforcer l'indépendance de l'archiduché. Matthias Zwerger zu Mora-Dime avait rejoint l'au-delà durant la Guerre de Vingt Ans, son élève, Wolfgang Buseck von Fifirchen, était heureusement digne de lui succéder à la cour.


En Italie, le morcellement politique avait prit fin avec les ambitions croissantes de la Papauté, qui avait unifié toute la botte méridionale, tandis que Milan dominait le Nord, enrichi par le commerce et l'artisanat. La Sicile restait en mains musulmanes malgré un appel à la croisade. Les mahométans les plus dangereux étaient ceux d'Asie Mineure, les Ottomans. Ils avaient conquis les anciennes terres héllènes et s'avançaient dangereusement dans les Balkans. Polonais et Hongrois étaient en mesure de les repousser et Constantinople restait en mains chrétiennes, mais pour combien de temps? À terme, il se pourrait que les Ottomans viennent défier notre puissance. Une perspective peu rassurante ...

- Maréchal Joukov
- Domestique des Scholes
- Messages : 2861
- Enregistré le : dim. mai 13, 2007 11:37 pm
- Meilleur jeu 2008 : The Witcher Enhanced Edition
- Meilleur jeu 2009 : Dragon Age Origins
- Meilleur jeu 2010 : Mass effect 2
- Meilleur jeu 2011 : The Elder Scrolls V: Skyrim
- Localisation : Aux archives
- Contact :
Re: A.E.I.O.U.
Constantinople défie encore le grand Turc  !
!
Mon site d'histoire militaire: http://antredustratege.com/
Mes publications: https://orbi.uliege.be/browse?type=auth ... te+p177479
https://www.wargamer.fr/author/jeanbaptistemurez/
Mes publications: https://orbi.uliege.be/browse?type=auth ... te+p177479
https://www.wargamer.fr/author/jeanbaptistemurez/
Re: A.E.I.O.U.
Ou peut-être qu'elle n'est plus qu'un bête vassal 
Re: A.E.I.O.U.
Toujours d'aplomb en effetMaréchal Joukov a écrit :Constantinople défie encore le grand Turc!
Non je ne crois pas, les Ottomans n'ont pas l'air de considérer la prise de cette ville comme prioritaire, va comprendreLocke a écrit :Ou peut-être qu'elle n'est plus qu'un bête vassal
-
necroproject
- Foudre de Guerre
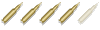
- Messages : 1686
- Enregistré le : mar. sept. 25, 2007 11:28 am
Re: A.E.I.O.U.
C'est parce qu'ils ont peur, moi je dis.  Ils savent que derrière la Porte d'Or, une immense armée s'accumule. Tel Sauron rassemblant ses armées, le basileus prépare l'ultime guerre d'extermination qui refoulera le turban par delà le cosmos et le disque monde.
Ils savent que derrière la Porte d'Or, une immense armée s'accumule. Tel Sauron rassemblant ses armées, le basileus prépare l'ultime guerre d'extermination qui refoulera le turban par delà le cosmos et le disque monde.
NB : ah et , du coup, je boycotte pas l'AAR
NB : ah et , du coup, je boycotte pas l'AAR
"Donnez-moi des Hommes décidés à se faire casser la gueule, et je vous ferai de la bonne tactique."
Général Dragomiroff
AAR HOI1 Götterdammerung 100% "Numbers Cruncher", AAR CMBB Dans la neige contre le sieur Boudi, AAR CMBB Dans la gadoue contre Jägermeister, La version pdf téléchargeable de mon guide tactique Combat Mission (à compléter)
Général Dragomiroff
AAR HOI1 Götterdammerung 100% "Numbers Cruncher", AAR CMBB Dans la neige contre le sieur Boudi, AAR CMBB Dans la gadoue contre Jägermeister, La version pdf téléchargeable de mon guide tactique Combat Mission (à compléter)
- Maréchal Joukov
- Domestique des Scholes
- Messages : 2861
- Enregistré le : dim. mai 13, 2007 11:37 pm
- Meilleur jeu 2008 : The Witcher Enhanced Edition
- Meilleur jeu 2009 : Dragon Age Origins
- Meilleur jeu 2010 : Mass effect 2
- Meilleur jeu 2011 : The Elder Scrolls V: Skyrim
- Localisation : Aux archives
- Contact :
Re: A.E.I.O.U.
necroproject a écrit :C'est parce qu'ils ont peur, moi je dis.Ils savent que derrière la Porte d'Or, une immense armée s'accumule. Tel Sauron rassemblant ses armées, le basileus prépare l'ultime guerre d'extermination qui refoulera le turban par delà le cosmos et le disque monde.
NB : ah et , du coup, je boycotte pas l'AAR
Et je vois bien une armée des morts menée par Constantin, histoire d'enfoncer le clou
Mon site d'histoire militaire: http://antredustratege.com/
Mes publications: https://orbi.uliege.be/browse?type=auth ... te+p177479
https://www.wargamer.fr/author/jeanbaptistemurez/
Mes publications: https://orbi.uliege.be/browse?type=auth ... te+p177479
https://www.wargamer.fr/author/jeanbaptistemurez/
Re: A.E.I.O.U.
Chapitre IX: 1480-1490
Malgré les douloureuses saignées de la Guerre de Vingt Ans, l'archiduc d'Autriche restait le souverain le plus riche de ce monde. Il pouvait compter sur 89 200 Gulden d'impôts par mois, complétés par d'importantes taxes commerciales annuelles. C'était là tant d'argent que les revenus du roi d'Angleterre et du sultan ottoman réunis ne pouvaient tenir la comparaison!
François III percevait à peu près 56 000 Gulden par mois, celà ne l'empêchait pas de ruminer une vengeance contre les Autrichiens qu'il haïssait plus que tout. Il mit sa fierté de côté un instant et repassa en revue les causes de la défaite française qu'il avait tant déplorée. L'excellent entraînement dont bénéficiaient les soldats autrichiens lui apparut comme la cause évidente de diverses défaites. Il se résolut à acheter les services de capitaines mercenaires traitres pour pouvoir obtenir des informations de première main. Une fois qu'il sut ce qu'il voulait, il appliqua les mêmes méthodes à l'infanterie et la cavalerie françaises. N'ayant pas suffisament d'autorité pour s'imposer à la fois face à ses généraux et à ses nobles, il dut en contrepartie renoncer à instaurer une administration plus efficace: le pays restait en proie à la corruption et aux malversations en tous genres.
L'Empereur eut à peine le temps d'initier quelques contre-mesures, comme la création de nouveaux régiments, que la mort le rattrapa durant une revue de troupes. Pris d'une faiblesse subite, il tomba à genoux dans la neige et succomba dans les instants qui suivirent, comme frappé par la foudre. Son fils Alexander reprit les rênes du pays sur-le-champ. Profitant de cette opportunité, il intégra le comté de Thuringe à l'archiduché et éleva les terres prises à l'archévêché d'Aquileia au rang de comté. Les électeurs du Saint-Empire le réélirent avec joie, car ils étaient toujours bien pourvus en cadeaux autrichiens et pouvaient compter sur une assistance militaire de premier rang. Les principautés plus modestes étaient elles bien mécontentes de la disparition de nombreux états indépendants au sein des frontières de l'Empire, et attribuaient une part importante de la responsabilité aux Habsbourgs. En conséquence, l'acclamation traditionnelle du nouvel Empereur à Mayence après le couronnement et l'onction fut glaciale. Alexander de Habsbourg était sourd à ces avertissements: jamais aucun des siens n'avait eut pouvoir plus grand!
 Il accompagna en premier lieu la reconquête des marchés vénitiens, mais fut bien vite rappellé à des affaires plus pressantes lorsqu'il eut vent de la remise sur pied des armées des Francs. Des espions avaient rapporté que des villages entiers s'étaient vus rafler leurs hommes pour servir dans la milice, et que le Roi de France était très occupé à parcourir le pays pour rappeller à ses vassaux leurs obligations. Comment François III avait-il pu réunir en aussi peu de temps les moyens financiers pour parachever la reconstruction de ses armées, pourtant intégralement annihilées durant la Guerre de Vingt Ans? La réponse était aussi simple que déroutante: il avait fait diminuer par paliers la valeur des monnaies ayant cours en ses terres, faisant baisser le taux de métaux précieux contenus dans chaque pièce, non sans omettre de d'abord payer ses dettes avec, comme s'il s'agissait de l'ancienne monnaie, bien plus précieuse. Ce jeu dangereux pouvait déséquilibrer toute l'économie rurale: les riches paysans n'étaient pas au fait de tels changements aussi rapidement que les bourgeois et encouraient le risque d'être payés dans une monnaie quasiment obsolète pour des biens eux bien réels. François III avait misé et hypothéqué l'avenir de son royaume. Le fait était pourtant là: la France montrait à nouveau ses dents.
Il accompagna en premier lieu la reconquête des marchés vénitiens, mais fut bien vite rappellé à des affaires plus pressantes lorsqu'il eut vent de la remise sur pied des armées des Francs. Des espions avaient rapporté que des villages entiers s'étaient vus rafler leurs hommes pour servir dans la milice, et que le Roi de France était très occupé à parcourir le pays pour rappeller à ses vassaux leurs obligations. Comment François III avait-il pu réunir en aussi peu de temps les moyens financiers pour parachever la reconstruction de ses armées, pourtant intégralement annihilées durant la Guerre de Vingt Ans? La réponse était aussi simple que déroutante: il avait fait diminuer par paliers la valeur des monnaies ayant cours en ses terres, faisant baisser le taux de métaux précieux contenus dans chaque pièce, non sans omettre de d'abord payer ses dettes avec, comme s'il s'agissait de l'ancienne monnaie, bien plus précieuse. Ce jeu dangereux pouvait déséquilibrer toute l'économie rurale: les riches paysans n'étaient pas au fait de tels changements aussi rapidement que les bourgeois et encouraient le risque d'être payés dans une monnaie quasiment obsolète pour des biens eux bien réels. François III avait misé et hypothéqué l'avenir de son royaume. Le fait était pourtant là: la France montrait à nouveau ses dents.
Les troupes autrichiennes furent occupées bien plus loin à l'Est. La Reine de Castille réclamait une déclaration de guerre envers les émirats zaporogues, comme le stipulaient les articles du traité d'alliance. Ferdinand Sulerzycki Leazow emmena un corps expéditionnaire vers les terres hostiles de Crimée et du Caucase pour protéger les chrétiens oppressés par les successeurs de la Horde d'Or. Il accomplit sa mission vite et bien, la coalition ne mit que quelques mois pour forcer ses ennemis à se soumettre à sa volonté. En décembre 1483, l'Autriche se vit verser un tribut de 100 000 Gulden et garantir la protection des croyants.
 Une excommunication du comté de Milan fit resurgir un court instant l'idée d'une guerre en Italie, mais Alexander se refusait à mettre en jeu le dense tissu de relations dynastiques qu'il s'était éfforcé de créer à la mort de son père. Il voulait apaiser les dignitaires de l'Empire, un vaste projet qui ne pouvait souffrir une provocation telle qu'une nouvelle expansion autrichienne.
Une excommunication du comté de Milan fit resurgir un court instant l'idée d'une guerre en Italie, mais Alexander se refusait à mettre en jeu le dense tissu de relations dynastiques qu'il s'était éfforcé de créer à la mort de son père. Il voulait apaiser les dignitaires de l'Empire, un vaste projet qui ne pouvait souffrir une provocation telle qu'une nouvelle expansion autrichienne.
 Les efforts de paix furent bien vite enterrés. François III le furieux avait remis à l'épreuve l'allégéance des Habsbourgs et lâchement attaqué le comté de Frise! Les pantins du roi se pressèrent de suivre le mouvement: bientôt l'Orléanais, la Lorraine et la Provence avaient imité leur maître. Courageuse fut Mayence, qui refusa d'entrer en guerre, opportuniste la Suisse, qui se joignit à celui qu'elle combattait il y a encore 5 ans. Oldenburg soutint son voisin vacillant par les armes. Alexander Ier n'avait pas vraiment le choix, il réitéra son voeu de protéger les membres de l'Empire, se signa et envoya une missive aux Francs, leur signalant l'état de guerre.
Les efforts de paix furent bien vite enterrés. François III le furieux avait remis à l'épreuve l'allégéance des Habsbourgs et lâchement attaqué le comté de Frise! Les pantins du roi se pressèrent de suivre le mouvement: bientôt l'Orléanais, la Lorraine et la Provence avaient imité leur maître. Courageuse fut Mayence, qui refusa d'entrer en guerre, opportuniste la Suisse, qui se joignit à celui qu'elle combattait il y a encore 5 ans. Oldenburg soutint son voisin vacillant par les armes. Alexander Ier n'avait pas vraiment le choix, il réitéra son voeu de protéger les membres de l'Empire, se signa et envoya une missive aux Francs, leur signalant l'état de guerre.
 L'archiduc se trouvait en Flandres Autrichiennes et mis en pièce un maigre corps franc qui s'avisait d'assiéger Anvers. Le reste des armées devait se regrouper sur le Rhin et se placer sous le commandement du prince Leazow. Pour vaincre les plus grandes armées françaises, il faudra sans aucun doute rassembler un nombre de troupiers encore jamais vu! Près de 100 000 ennemis grouillaient aux frontières de l'Empire ...
L'archiduc se trouvait en Flandres Autrichiennes et mis en pièce un maigre corps franc qui s'avisait d'assiéger Anvers. Le reste des armées devait se regrouper sur le Rhin et se placer sous le commandement du prince Leazow. Pour vaincre les plus grandes armées françaises, il faudra sans aucun doute rassembler un nombre de troupiers encore jamais vu! Près de 100 000 ennemis grouillaient aux frontières de l'Empire ...
Après quelques démêlés courts et sanglants, l'Autriche semblait déjà prendre l'ascendant. 7 000 épéistes et archers avaient trouvé la mort en tentant de franchir le Rhin. La première bataille décisive eut cependant lieu en Flandres, près de la localité d'Hazebrouck. François III y infligea une rude défaite à l'armée impériale d'Alexander, massacrant presque 8 000 lanciers de Souabe au détour d'une embuscade manquée. L'Empereur était forcé à la retraite. Apprenant ceci, le Landgrave de Hesse se joignit aux ignobles Francs, trahissant l'Empire en temps difficiles!
 A priori, le Landgrave de Hesse voulait s'approprier les possessions autrichiennes de Thuringe. Prises de court, les armées autrichiennes ne pouvaient se permettre un détour chez leurs nouveaux ennemis, car les sièges des cités d'Allemagne Centrale s'annoncaient longs et difficiles. Alexander Ier tentait de sauver sa troupe et s'enfuyait par la Zélande vers les contingents du prince Leazow. Ce dernier avait déjà rassemblé une bonne part des régiments impériaux dans l'armée du Rhin, et fonça à la rencontre du général François du Fournay à Cologne. Les lourds cuirassiers brisèrent en un rien de temps les carrés d'infanterie francs, semant la pagaille parmis un corps de bataille visiblement dépassé par les évènements. Les maigres forces montées que du Fournay pouvait jetter dans la brèche ne suffirent pas à endiguer les cavaliers fous furieux, déjà proches des chariots de ravitaillement. Les régiments de miliciens sombrèrent bientôt dans un chaos indescriptible, que les Croates mirent à profit pour disperser ce qui restait de soldats en face. La victoire fut totale, 15 régiments français y restèrent.
A priori, le Landgrave de Hesse voulait s'approprier les possessions autrichiennes de Thuringe. Prises de court, les armées autrichiennes ne pouvaient se permettre un détour chez leurs nouveaux ennemis, car les sièges des cités d'Allemagne Centrale s'annoncaient longs et difficiles. Alexander Ier tentait de sauver sa troupe et s'enfuyait par la Zélande vers les contingents du prince Leazow. Ce dernier avait déjà rassemblé une bonne part des régiments impériaux dans l'armée du Rhin, et fonça à la rencontre du général François du Fournay à Cologne. Les lourds cuirassiers brisèrent en un rien de temps les carrés d'infanterie francs, semant la pagaille parmis un corps de bataille visiblement dépassé par les évènements. Les maigres forces montées que du Fournay pouvait jetter dans la brèche ne suffirent pas à endiguer les cavaliers fous furieux, déjà proches des chariots de ravitaillement. Les régiments de miliciens sombrèrent bientôt dans un chaos indescriptible, que les Croates mirent à profit pour disperser ce qui restait de soldats en face. La victoire fut totale, 15 régiments français y restèrent.
 Tandis que le prince polonais fanfaronnait encore et organisait des banquets en masse, le prince-électeur du Palatinat montra son véritable visage et nous déclara la guerre! Le Brabant refusa de suivre son allié, tandis que la Castille renouvela nos voeux d'alliance. L'armée palatine était dans un misérable état, ainsi Ferdinand Sulerzyicki Leazow put chercher la bataille immédiatement après l'entrée en guerre, battant à platte couture Franz Ludwig Ier en ses terres. Un corps entreprit d'assiéger les forteresses de Landau et Kandel, tandis que l'armée du Rhin repartait colmater des brèches à la frontière française.
Tandis que le prince polonais fanfaronnait encore et organisait des banquets en masse, le prince-électeur du Palatinat montra son véritable visage et nous déclara la guerre! Le Brabant refusa de suivre son allié, tandis que la Castille renouvela nos voeux d'alliance. L'armée palatine était dans un misérable état, ainsi Ferdinand Sulerzyicki Leazow put chercher la bataille immédiatement après l'entrée en guerre, battant à platte couture Franz Ludwig Ier en ses terres. Un corps entreprit d'assiéger les forteresses de Landau et Kandel, tandis que l'armée du Rhin repartait colmater des brèches à la frontière française.
Ces évènements et d'autres mirent gravement en danger la suprématie des Habsbourgs dans l'Empire. Seul le duc-évêque de Würzburg était encore prêt à voter pour le futur archiduc en cas de mort prématurée d'Alexander ...
 Les forces restantes du duc palatin furent détruites par l'armée des Habsbourgs, revenue d'une courte campagne en Suisse où elle avait soumis le canton de Schwyz. Tout le Palatinat fut occupé en un tour de main, et son souverain forcé à payer 775 000 Gulden à l'Autriche pour garantir une paix immédiate. Sans armée, Franz Ludwig ne pouvait plus rien faire!
Les forces restantes du duc palatin furent détruites par l'armée des Habsbourgs, revenue d'une courte campagne en Suisse où elle avait soumis le canton de Schwyz. Tout le Palatinat fut occupé en un tour de main, et son souverain forcé à payer 775 000 Gulden à l'Autriche pour garantir une paix immédiate. Sans armée, Franz Ludwig ne pouvait plus rien faire!
Alexander Ier n'avait finalement pas rejoint le prince Leazow, qui avait beaucoup de mal à nourrir toute sa troupe et ne souhaitait pas de renforts. Il assiéga donc les terres hessoises de Westphalie, tablant sur une paix tout aussi rapide qu'avec le Palatinat. Malheureusement, le prince Leazow fut battu à platte couture par le Roi des Francs à Trèves, ouvrant ainsi la porte à une invasion des territoires rhénans.
 Les armées amies se désagrégeaient à un rythme inquiétant. Leur intervention était nécessaire partout et elles menaçaient de céder sous la force du nombre. Aucune aide directe ne pouvait être apportée à la Frise, qui fut annexée en décembre 1485 par l'impitoyable François. Incapables de repousser les Francs sur le Rhin, Alexander et Leazow choisirent de soumettre la Hesse avant de défier à nouveau la suprématie française. Le petit territoire du Landgravat de Hesse était un avantage décisif pour une opération pareille. Après l'occupation de Kassel et de la Westphalie, le landgrave était prêt à de grandes concessions.
Les armées amies se désagrégeaient à un rythme inquiétant. Leur intervention était nécessaire partout et elles menaçaient de céder sous la force du nombre. Aucune aide directe ne pouvait être apportée à la Frise, qui fut annexée en décembre 1485 par l'impitoyable François. Incapables de repousser les Francs sur le Rhin, Alexander et Leazow choisirent de soumettre la Hesse avant de défier à nouveau la suprématie française. Le petit territoire du Landgravat de Hesse était un avantage décisif pour une opération pareille. Après l'occupation de Kassel et de la Westphalie, le landgrave était prêt à de grandes concessions.
 La ville de Cologne reprit de ses droits et fut reformée comme royaume. Alexander s'empressa de lier les deux dynasties par un mariage. La campagne de Hesse avait donné l'occasion à l'armée du Rhin de se refaire une santé. Des révoltes de tout bord avaient ralenti la progression française, une incursion pouvait s'avérer juteuse.
La ville de Cologne reprit de ses droits et fut reformée comme royaume. Alexander s'empressa de lier les deux dynasties par un mariage. La campagne de Hesse avait donné l'occasion à l'armée du Rhin de se refaire une santé. Des révoltes de tout bord avaient ralenti la progression française, une incursion pouvait s'avérer juteuse.
Les Flandres Autrichiennes, la ville de Koblenz et l'archévêché d'Alsace étaient tombés, mais le prix de ces conquêtes était l'épuisement de la troupe. Les Lorrains furent bousculés à Fribourg, sauvant de justesse la ville à bout de souffle après un long siège. Le margravat de Bade fut libéré de ses 2 000 occupants, et en février 1486, François III souffrit une violente défaite à Durlach, où il perdit un tiers de son armée.
 Une fois l'armée royale forcée à se retirer, Alexander et son armée impériale purent reprendre le contrôle de la situation. Les cités rhénanes préféraient de loin sa tutelle que celle du cruel roi franc. La reconquête de Koblenz et de Worms fut une véritable promenade, les bourgeois assassinèrent les quelques gardes francs et présentèrent les clés de la ville à leur empereur.
Une fois l'armée royale forcée à se retirer, Alexander et son armée impériale purent reprendre le contrôle de la situation. Les cités rhénanes préféraient de loin sa tutelle que celle du cruel roi franc. La reconquête de Koblenz et de Worms fut une véritable promenade, les bourgeois assassinèrent les quelques gardes francs et présentèrent les clés de la ville à leur empereur.
Les Helvètes accourus au secours de leurs alliés furent repoussés avant autant d'aise que François III, revenu à la charge. La guerre pouvait à nouveau être portée en terres ennemies! La Lorraine connut la première le sort peu enviable d'être la cible des pilleurs autrichiens. Trois armées échouèrent à libérer le pays de ce fléau.
En ce qui concernait les terres héréditaires autrichiennes, une garde impériale avait été levée à Vienne en vue de battre l'un après l'autre les régiments épars qui avaient transité par mer et terre vers les possessions méridionales de l'Autriche.
 Les mercenaires de Charles III de Lorraine purent être contrés à Fribourg, ôtant à l'impétueux duc ses dernières troupes. Une série de victoire empêcha toute initiative française, jusqu'a ce que l'armée impériale dut battre en retraite face au roi ennemi en Champagne, incapable de détruire les restes des régiments vaincus auparavant en raison de renforts massifs venus d'Île-de-France. Le rapport de force devenait cependant plus favorable à l'archiduc: 66 000 Francs s'opposaient à 52 000 soldats venus des quatre coins de l'Empire.
Les mercenaires de Charles III de Lorraine purent être contrés à Fribourg, ôtant à l'impétueux duc ses dernières troupes. Une série de victoire empêcha toute initiative française, jusqu'a ce que l'armée impériale dut battre en retraite face au roi ennemi en Champagne, incapable de détruire les restes des régiments vaincus auparavant en raison de renforts massifs venus d'Île-de-France. Le rapport de force devenait cependant plus favorable à l'archiduc: 66 000 Francs s'opposaient à 52 000 soldats venus des quatre coins de l'Empire.
Les membres du Saint-Empire avaient d'ailleurs de bonnes raisons de haïr derechef François en cette année 1486: il s'était permis l'insolence incomparable d'annexer le vénérable comté d'Oldenburg! L'allié de la Frise avait payé cher sa loyauté. L'Empereur se devait de les venger.
Les efforts pour fournir une armée de premier rang à l'archiduc se multipliaient alors que la situation était indécise sur le Rhin. Une bureaucratie professionnelle et plus libérée de considérations népotistes améliora nettement le revenu des impôts. L'argent était une ressource fort prisée, il fallait offrir des primes à l'engagement de plus en plus fortes pour attirer les jeunes hommes dans le métier des armes. La gigantesque bataille de Trèves coûta à elle seule plus de 15 000 hommes à l'Empereur!
 Les combats restaient rudes, les généraux Philippe de Beaugency et François du Fournay arrivaient avec des régiments frais et mettaient à mal l'armée du Rhin et l'armée impériale. Après d'innombrables batailles, le status quo put être rétabli, non sans obliger les bélligérents à se ressourcer dans des quartiers d'hivers situés dans des villes amies.
Les combats restaient rudes, les généraux Philippe de Beaugency et François du Fournay arrivaient avec des régiments frais et mettaient à mal l'armée du Rhin et l'armée impériale. Après d'innombrables batailles, le status quo put être rétabli, non sans obliger les bélligérents à se ressourcer dans des quartiers d'hivers situés dans des villes amies.
Les années 1487-1488 n'apportèrent pas plus d'évènements décisifs. 27 batailles et d'innombrables escarmouches ne firent que confirmer que les deux adversaires se valaient. L'Autriche tirait son épingle du jeu en détruisant bien plus de régiments isolés, à peu de frais. La France gardait en otage les Flandres Autrichiennes, Oldenburg, la Frise et une à deux villes rhénanes. Quelques révoltés osèrent s'interposer entre les deux feux et furent broyés sans plus de considérations.
Le mois de juin 1488 vit la ville de Worms changer trois fois de mains! En septembre, les Francs semblaient très affaiblis après la perte d'une douzaine de régiments engagés dans des opérations mineures. À Trèves, le prince Leazow écrasa la plus grande armée française, capturant près de 8 000 hommes. L'Orléanais avait particulièrement souffert lors de cette bataille et n'était plus en mesure d'envoyer de nouvelles troupes pour soutenir la France. Philippe de Beaugency dut concéder sa défaite à Metz en octobre, mais François renversa la situation en arrivant à la tête d'une armée de chevaliers. Encore une fois, la guerre se prolongeait sans résultats.
Ce ne fut que grâce au génie de l'Empereur que François III put être acculé aux sauvages forêts du Luxembourg en plein hiver et être forcé à la reddition. Abandonnant ses hommes, il s'enfuya vers Liège pour lever une nouvelle armée. Les troupes fraichement recrutées furent néanmoins interceptées par le prince Leazow, qui fit en peu de temps une dizaine de milliers de prisonniers. Le siège des forteresses du Brabant put être mené à bien grâce à ces diversions. La balance recommençait à pencher en faveur de l'Autriche.

Malgré les douloureuses saignées de la Guerre de Vingt Ans, l'archiduc d'Autriche restait le souverain le plus riche de ce monde. Il pouvait compter sur 89 200 Gulden d'impôts par mois, complétés par d'importantes taxes commerciales annuelles. C'était là tant d'argent que les revenus du roi d'Angleterre et du sultan ottoman réunis ne pouvaient tenir la comparaison!
François III percevait à peu près 56 000 Gulden par mois, celà ne l'empêchait pas de ruminer une vengeance contre les Autrichiens qu'il haïssait plus que tout. Il mit sa fierté de côté un instant et repassa en revue les causes de la défaite française qu'il avait tant déplorée. L'excellent entraînement dont bénéficiaient les soldats autrichiens lui apparut comme la cause évidente de diverses défaites. Il se résolut à acheter les services de capitaines mercenaires traitres pour pouvoir obtenir des informations de première main. Une fois qu'il sut ce qu'il voulait, il appliqua les mêmes méthodes à l'infanterie et la cavalerie françaises. N'ayant pas suffisament d'autorité pour s'imposer à la fois face à ses généraux et à ses nobles, il dut en contrepartie renoncer à instaurer une administration plus efficace: le pays restait en proie à la corruption et aux malversations en tous genres.
L'Empereur eut à peine le temps d'initier quelques contre-mesures, comme la création de nouveaux régiments, que la mort le rattrapa durant une revue de troupes. Pris d'une faiblesse subite, il tomba à genoux dans la neige et succomba dans les instants qui suivirent, comme frappé par la foudre. Son fils Alexander reprit les rênes du pays sur-le-champ. Profitant de cette opportunité, il intégra le comté de Thuringe à l'archiduché et éleva les terres prises à l'archévêché d'Aquileia au rang de comté. Les électeurs du Saint-Empire le réélirent avec joie, car ils étaient toujours bien pourvus en cadeaux autrichiens et pouvaient compter sur une assistance militaire de premier rang. Les principautés plus modestes étaient elles bien mécontentes de la disparition de nombreux états indépendants au sein des frontières de l'Empire, et attribuaient une part importante de la responsabilité aux Habsbourgs. En conséquence, l'acclamation traditionnelle du nouvel Empereur à Mayence après le couronnement et l'onction fut glaciale. Alexander de Habsbourg était sourd à ces avertissements: jamais aucun des siens n'avait eut pouvoir plus grand!

Les troupes autrichiennes furent occupées bien plus loin à l'Est. La Reine de Castille réclamait une déclaration de guerre envers les émirats zaporogues, comme le stipulaient les articles du traité d'alliance. Ferdinand Sulerzycki Leazow emmena un corps expéditionnaire vers les terres hostiles de Crimée et du Caucase pour protéger les chrétiens oppressés par les successeurs de la Horde d'Or. Il accomplit sa mission vite et bien, la coalition ne mit que quelques mois pour forcer ses ennemis à se soumettre à sa volonté. En décembre 1483, l'Autriche se vit verser un tribut de 100 000 Gulden et garantir la protection des croyants.



Après quelques démêlés courts et sanglants, l'Autriche semblait déjà prendre l'ascendant. 7 000 épéistes et archers avaient trouvé la mort en tentant de franchir le Rhin. La première bataille décisive eut cependant lieu en Flandres, près de la localité d'Hazebrouck. François III y infligea une rude défaite à l'armée impériale d'Alexander, massacrant presque 8 000 lanciers de Souabe au détour d'une embuscade manquée. L'Empereur était forcé à la retraite. Apprenant ceci, le Landgrave de Hesse se joignit aux ignobles Francs, trahissant l'Empire en temps difficiles!


Ces évènements et d'autres mirent gravement en danger la suprématie des Habsbourgs dans l'Empire. Seul le duc-évêque de Würzburg était encore prêt à voter pour le futur archiduc en cas de mort prématurée d'Alexander ...

Alexander Ier n'avait finalement pas rejoint le prince Leazow, qui avait beaucoup de mal à nourrir toute sa troupe et ne souhaitait pas de renforts. Il assiéga donc les terres hessoises de Westphalie, tablant sur une paix tout aussi rapide qu'avec le Palatinat. Malheureusement, le prince Leazow fut battu à platte couture par le Roi des Francs à Trèves, ouvrant ainsi la porte à une invasion des territoires rhénans.


Les Flandres Autrichiennes, la ville de Koblenz et l'archévêché d'Alsace étaient tombés, mais le prix de ces conquêtes était l'épuisement de la troupe. Les Lorrains furent bousculés à Fribourg, sauvant de justesse la ville à bout de souffle après un long siège. Le margravat de Bade fut libéré de ses 2 000 occupants, et en février 1486, François III souffrit une violente défaite à Durlach, où il perdit un tiers de son armée.

Les Helvètes accourus au secours de leurs alliés furent repoussés avant autant d'aise que François III, revenu à la charge. La guerre pouvait à nouveau être portée en terres ennemies! La Lorraine connut la première le sort peu enviable d'être la cible des pilleurs autrichiens. Trois armées échouèrent à libérer le pays de ce fléau.
En ce qui concernait les terres héréditaires autrichiennes, une garde impériale avait été levée à Vienne en vue de battre l'un après l'autre les régiments épars qui avaient transité par mer et terre vers les possessions méridionales de l'Autriche.

Les membres du Saint-Empire avaient d'ailleurs de bonnes raisons de haïr derechef François en cette année 1486: il s'était permis l'insolence incomparable d'annexer le vénérable comté d'Oldenburg! L'allié de la Frise avait payé cher sa loyauté. L'Empereur se devait de les venger.
Les efforts pour fournir une armée de premier rang à l'archiduc se multipliaient alors que la situation était indécise sur le Rhin. Une bureaucratie professionnelle et plus libérée de considérations népotistes améliora nettement le revenu des impôts. L'argent était une ressource fort prisée, il fallait offrir des primes à l'engagement de plus en plus fortes pour attirer les jeunes hommes dans le métier des armes. La gigantesque bataille de Trèves coûta à elle seule plus de 15 000 hommes à l'Empereur!

Les années 1487-1488 n'apportèrent pas plus d'évènements décisifs. 27 batailles et d'innombrables escarmouches ne firent que confirmer que les deux adversaires se valaient. L'Autriche tirait son épingle du jeu en détruisant bien plus de régiments isolés, à peu de frais. La France gardait en otage les Flandres Autrichiennes, Oldenburg, la Frise et une à deux villes rhénanes. Quelques révoltés osèrent s'interposer entre les deux feux et furent broyés sans plus de considérations.
Le mois de juin 1488 vit la ville de Worms changer trois fois de mains! En septembre, les Francs semblaient très affaiblis après la perte d'une douzaine de régiments engagés dans des opérations mineures. À Trèves, le prince Leazow écrasa la plus grande armée française, capturant près de 8 000 hommes. L'Orléanais avait particulièrement souffert lors de cette bataille et n'était plus en mesure d'envoyer de nouvelles troupes pour soutenir la France. Philippe de Beaugency dut concéder sa défaite à Metz en octobre, mais François renversa la situation en arrivant à la tête d'une armée de chevaliers. Encore une fois, la guerre se prolongeait sans résultats.
Ce ne fut que grâce au génie de l'Empereur que François III put être acculé aux sauvages forêts du Luxembourg en plein hiver et être forcé à la reddition. Abandonnant ses hommes, il s'enfuya vers Liège pour lever une nouvelle armée. Les troupes fraichement recrutées furent néanmoins interceptées par le prince Leazow, qui fit en peu de temps une dizaine de milliers de prisonniers. Le siège des forteresses du Brabant put être mené à bien grâce à ces diversions. La balance recommençait à pencher en faveur de l'Autriche.

- griffon
- Empereur Intergalactique
- Messages : 42611
- Enregistré le : mer. août 18, 2004 5:26 pm
- Localisation : Brest
Re: A.E.I.O.U.
Mein Gott ! 

ca remue dans cet AAR !
ca remue dans cet AAR !
SOL INVICTVS
Au printemps, je vais quelquefois m'asseoir à la lisière d'un champ fleuri.
Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin , je ne pense guère à mon salut.
Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien
Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin , je ne pense guère à mon salut.
Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien
- griffon
- Empereur Intergalactique
- Messages : 42611
- Enregistré le : mer. août 18, 2004 5:26 pm
- Localisation : Brest
Re: A.E.I.O.U.
t'as recruté des mercenaires Ecossais ?
(Galloglaigh infantry)
(Galloglaigh infantry)
SOL INVICTVS
Au printemps, je vais quelquefois m'asseoir à la lisière d'un champ fleuri.
Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin , je ne pense guère à mon salut.
Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien
Lorsqu'une belle jeune fille m'apporte une coupe de vin , je ne pense guère à mon salut.
Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien
Re: A.E.I.O.U.
Faut biengriffon a écrit :Mein Gott !

ca remue dans cet AAR !
Non c'est la meilleure infanterie à mon niveau technologique, c'est un peu couillon mais l'art de la guerre nordique est ce qui se fait de mieux en ces tempsgriffon a écrit :t'as recruté des mercenaires Ecossais ?
(Galloglaigh infantry)
Re: A.E.I.O.U.
Chapitre X: 1490-1500
Quelques groupements hérétiques retardèrent l'avancée d'Alexander en France. Lombards comme Tyroliens était attirés par diverses sectes, heureusement l'Empereur veillait et fit soumettre les prêtres rénégats. L'apogée de ces soulèvement se vit à Trévise, où 8 000 brebis égarées s'armèrent contre leur suzerain.
Maintenant que plus aucune armée française de taille n'était en vue, le recrutement de mercenaires semblait prometteur à l'archiduc. La médiocre discipline régnant chez ces gens était un inconvénient inacceptable sur le champ de bataille, mais suffisait à organiser des sièges dans des contrées où l'ennemi brillait par son absence. Ainsi, des compagnies suédoises assiégèrent les villes de Hollande, tandis que des Lituaniens s'occupaient de la Frise.
Profitant au maximum de l'inactivité des Francs, Alexander libéra les Flandres Autrichiennes ainsi que toutes les forteresses encore en mains ennemies à l'intérieur de ses frontiéres. Fin 1490, Metz était tombée aussi et une petite armée de renforts français détruite à Waldrach, dans les environs de l'antique ville de Trèves.
Le feu comté d'Oldenburg n'avait lui pu être libéré du joug français. Un petit noble avait assailli les mercenaires de Novgorod qui se préparaient à attaquer la garnison. Son geste irréfléchi priva sa terre natale d'une protection autrement plus bienveillante que celle des Valois ...
 Ignorant une proposition de Venise d'attaquer Milan à cause du manque évident de moyens pour mener une telle opération, Alexander continua sa poussée vers le Sud, dégageant un chemin vers Paris, gage d'un traité de paix avantageux. Calais et la Lorraine étaient prises à partie par des mercenaires polonais, tandis qu'il alternait sièges rapides et détours par les Flandres Autrichiennes pour percevoir des renforts.
Ignorant une proposition de Venise d'attaquer Milan à cause du manque évident de moyens pour mener une telle opération, Alexander continua sa poussée vers le Sud, dégageant un chemin vers Paris, gage d'un traité de paix avantageux. Calais et la Lorraine étaient prises à partie par des mercenaires polonais, tandis qu'il alternait sièges rapides et détours par les Flandres Autrichiennes pour percevoir des renforts.
À l'été 1491 c'était le Pays Barrois qui était forcé d'accueillir les troupes autrichiennes en ses places fortes, en novembre Calais. L'avancée était irrésistible, même une sanglante révolte bogomiliste à Vienne ne put ralentir vraiment la progression autrichienne en France. Quelques sursauts de la part du duc de Provence eurent les mêmes résultats.
Les armées françaises étaient tout juste capables de repousser irrégulièrement des mercenaires un peu trop téméraires. Dès que l'armée du Rhin ou l'armée impériale surgissaient, les régiments se volatilisaient sous le choc de la cavalerie. L'espoir de finir cette guerre victorieusement devenait de plus en plus mince pour François III. Le Hainaut et la Lorraine entrèrent dans le giron autrichien en 1492, Cambrai tomba au printemps 1493.
 Le coup de grâce vint le 13 mai 1493, avec l'occupation de Paris et la mort du roi François III, assassiné par ses gardes lors de sa retraite hâtive vers la Normandie. Son successeur Louis XI était un flagorneur de la pire espèce, une vipère qui tenta de faire croire à l'archiduc qu'il regrettait profondément l'invasion des comtés de Frise et d'Oldenburg, et qu'il serait ravi de faire la paix avec un souverain aussi talentueux que lui.
Le coup de grâce vint le 13 mai 1493, avec l'occupation de Paris et la mort du roi François III, assassiné par ses gardes lors de sa retraite hâtive vers la Normandie. Son successeur Louis XI était un flagorneur de la pire espèce, une vipère qui tenta de faire croire à l'archiduc qu'il regrettait profondément l'invasion des comtés de Frise et d'Oldenburg, et qu'il serait ravi de faire la paix avec un souverain aussi talentueux que lui.
Fi de tout celà! Ces chiens proposaient une paix blanche, alors qu'ils devraient ramper devant l'Empereur? Alexander sombra dans une colère noire et fit mettre en chaîne tous les émissaires francs, l'écrit odieux du roi livré aux flammes. Il se jura de ne plus recevoir aucun ennemi jusqu'a ce que la France soit prise à la gorge comme jamais encore.
La Picardie tomba en juillet 1493, la Bourgogne en août, une armée de secours de Philippe de Beaugency fut éradiquée à Caux peu après. Le 23 septembre, la Grande-Bretagne déclara la guerre à la France. À partir du duché de Bretagne, ses troupes conquirent toute la côte armoricaine ainsi que la Vendée. Les états du Pape, soutenus par la Hongrie et la Pologne, entrèrent dans la danse aussi.
Louis XI ne désespéra pas et rassembla plusieurs milliers de fidèles et de mercenaires dans l'Orléanais. Il parvint à infliger une rude défaite à l'Empereur à Paris, en infiltrant la ville et défiant la cavalerie impériale dans les rues, où les bourgeois s'empressèrent de bombarder les Autrichiens avec les objets les plus lourds qu'ils purent trouver. Alexander laissa plus de 8 000 hommes sur le terrain et se retira en Flandres Autrichiennes.
 Une petite consolation se présenta quand même pour l'Empereur. Un des érudits les plus réputés de toute l'Europe, Maximilian Byszynski Drussdaran, venait de rejoindre sa cour et oeuvrait à une réforme administrative d'importance.
Une petite consolation se présenta quand même pour l'Empereur. Un des érudits les plus réputés de toute l'Europe, Maximilian Byszynski Drussdaran, venait de rejoindre sa cour et oeuvrait à une réforme administrative d'importance.
 Sa victoire à Paris ne permit pas à Louis XI d'inverser la tendance générale. Incapable de prendre le Louvre avec ses troupes épuisées, il ne put empêcher les Autrichiens de s'emparer de la Champagne, de la Normandie et de la Franche-Comté les mois suivants. Pressé de toutes parts, il fut finalement battu par l'Empereur en personne à Cambrai, le 2 juillet 1494.
Sa victoire à Paris ne permit pas à Louis XI d'inverser la tendance générale. Incapable de prendre le Louvre avec ses troupes épuisées, il ne put empêcher les Autrichiens de s'emparer de la Champagne, de la Normandie et de la Franche-Comté les mois suivants. Pressé de toutes parts, il fut finalement battu par l'Empereur en personne à Cambrai, le 2 juillet 1494.
La Grande-Bretagne s'empressa d'annexer l'Armor et la Vendée, la France était à bout. Louis XI dut se plier aux exigences autrichiennes: l'annexion des dernières provinces flamandes en mains françaises, de l'ancien archevêché de Trèves, ainsi que la libération de la Frise. Le comté d'Oldenbourg se libéra lui tout seul.
 La France était une nouvelle fois humiliée et affaiblie. Elle avait maintenant perdu toute son influence sur les affaires du Saint-Empire, ne gardant que le duché de Lorraine, autrefois domaine impérial, sous sa tutelle. La ceinture autrichienne qui protégeait l'accès par l'Ouest au Saint-Empire était désormais complète et bien plus solide qu'au début de la guerre. Des garnisons importantes y prirent place.
La France était une nouvelle fois humiliée et affaiblie. Elle avait maintenant perdu toute son influence sur les affaires du Saint-Empire, ne gardant que le duché de Lorraine, autrefois domaine impérial, sous sa tutelle. La ceinture autrichienne qui protégeait l'accès par l'Ouest au Saint-Empire était désormais complète et bien plus solide qu'au début de la guerre. Des garnisons importantes y prirent place.
La faiblesse des Valois était évidente. Au contraire de la Guerre de Vingt Ans, l'archiduché d'Autriche était venu seul à bout du colosse franc, et ce en un laps de temps bien plus court.
 Pour administrer cet énorme territoire, les plus grands érudits des universités d'Erfurt et de Malines furent convoqués à Vienne pour soumettre à l'archiduc des idées novatrices. Après de longues délibérations, proposition fut faite de créer une nouvelle entité administrative, le Royaume d'Autriche. Il comprendrait toutes les possessions actuelles de l'archiduc d'Autriche, en réduisant toutefois le nombre de titres cumulés par un seul souverain. Le Roi d'Autriche serait automatiquement archiduc des terres héréditaires habsbourgeoises, mais à ses côtés existeront des comtes, ducs, margraves et landgraves jouissant d'une certaine autonomie.
Pour administrer cet énorme territoire, les plus grands érudits des universités d'Erfurt et de Malines furent convoqués à Vienne pour soumettre à l'archiduc des idées novatrices. Après de longues délibérations, proposition fut faite de créer une nouvelle entité administrative, le Royaume d'Autriche. Il comprendrait toutes les possessions actuelles de l'archiduc d'Autriche, en réduisant toutefois le nombre de titres cumulés par un seul souverain. Le Roi d'Autriche serait automatiquement archiduc des terres héréditaires habsbourgeoises, mais à ses côtés existeront des comtes, ducs, margraves et landgraves jouissant d'une certaine autonomie.
 Alexander de Habsbourg s'éprit de cette réforme territoriale majeure. Il signa un édit implémentant ces changements pas la force de sa légitimité de suzerain et entreprit de distribuer les nouveaux titres de noblesse à ses fidèles:
Alexander de Habsbourg s'éprit de cette réforme territoriale majeure. Il signa un édit implémentant ces changements pas la force de sa légitimité de suzerain et entreprit de distribuer les nouveaux titres de noblesse à ses fidèles:
- la maison de Throax garda le comté de Croatie
- la maison de Fifirchen reçut l'archevêché de Cologne
- la maison de Zoelie reçut l'archevêché de Trèves
- la maison de Greiffenau reçut le margravat de Bade
- la maison Sulerzycki reçut le comté de Thuringe
- la maison von Stubenrauch reçut la principauté de Hollande
- la maison de Karaiska reçut le protectorat des Flandres
Les grands banquets qui s'ensuivirent furent si magnifiques et arrosés qu'Alexander ne se releva plus après le dixième matin de fête. Son fils Franz Ludwig n'était pas encore en âge de prendre sa succession, le duché de Clèves s'empara de la couronne impériale. La création du Royaume d'Autriche fut moins heureuse que prévue ...


Quelques groupements hérétiques retardèrent l'avancée d'Alexander en France. Lombards comme Tyroliens était attirés par diverses sectes, heureusement l'Empereur veillait et fit soumettre les prêtres rénégats. L'apogée de ces soulèvement se vit à Trévise, où 8 000 brebis égarées s'armèrent contre leur suzerain.
Maintenant que plus aucune armée française de taille n'était en vue, le recrutement de mercenaires semblait prometteur à l'archiduc. La médiocre discipline régnant chez ces gens était un inconvénient inacceptable sur le champ de bataille, mais suffisait à organiser des sièges dans des contrées où l'ennemi brillait par son absence. Ainsi, des compagnies suédoises assiégèrent les villes de Hollande, tandis que des Lituaniens s'occupaient de la Frise.
Profitant au maximum de l'inactivité des Francs, Alexander libéra les Flandres Autrichiennes ainsi que toutes les forteresses encore en mains ennemies à l'intérieur de ses frontiéres. Fin 1490, Metz était tombée aussi et une petite armée de renforts français détruite à Waldrach, dans les environs de l'antique ville de Trèves.
Le feu comté d'Oldenburg n'avait lui pu être libéré du joug français. Un petit noble avait assailli les mercenaires de Novgorod qui se préparaient à attaquer la garnison. Son geste irréfléchi priva sa terre natale d'une protection autrement plus bienveillante que celle des Valois ...

À l'été 1491 c'était le Pays Barrois qui était forcé d'accueillir les troupes autrichiennes en ses places fortes, en novembre Calais. L'avancée était irrésistible, même une sanglante révolte bogomiliste à Vienne ne put ralentir vraiment la progression autrichienne en France. Quelques sursauts de la part du duc de Provence eurent les mêmes résultats.
Les armées françaises étaient tout juste capables de repousser irrégulièrement des mercenaires un peu trop téméraires. Dès que l'armée du Rhin ou l'armée impériale surgissaient, les régiments se volatilisaient sous le choc de la cavalerie. L'espoir de finir cette guerre victorieusement devenait de plus en plus mince pour François III. Le Hainaut et la Lorraine entrèrent dans le giron autrichien en 1492, Cambrai tomba au printemps 1493.

Fi de tout celà! Ces chiens proposaient une paix blanche, alors qu'ils devraient ramper devant l'Empereur? Alexander sombra dans une colère noire et fit mettre en chaîne tous les émissaires francs, l'écrit odieux du roi livré aux flammes. Il se jura de ne plus recevoir aucun ennemi jusqu'a ce que la France soit prise à la gorge comme jamais encore.
La Picardie tomba en juillet 1493, la Bourgogne en août, une armée de secours de Philippe de Beaugency fut éradiquée à Caux peu après. Le 23 septembre, la Grande-Bretagne déclara la guerre à la France. À partir du duché de Bretagne, ses troupes conquirent toute la côte armoricaine ainsi que la Vendée. Les états du Pape, soutenus par la Hongrie et la Pologne, entrèrent dans la danse aussi.
Louis XI ne désespéra pas et rassembla plusieurs milliers de fidèles et de mercenaires dans l'Orléanais. Il parvint à infliger une rude défaite à l'Empereur à Paris, en infiltrant la ville et défiant la cavalerie impériale dans les rues, où les bourgeois s'empressèrent de bombarder les Autrichiens avec les objets les plus lourds qu'ils purent trouver. Alexander laissa plus de 8 000 hommes sur le terrain et se retira en Flandres Autrichiennes.


La Grande-Bretagne s'empressa d'annexer l'Armor et la Vendée, la France était à bout. Louis XI dut se plier aux exigences autrichiennes: l'annexion des dernières provinces flamandes en mains françaises, de l'ancien archevêché de Trèves, ainsi que la libération de la Frise. Le comté d'Oldenbourg se libéra lui tout seul.

La faiblesse des Valois était évidente. Au contraire de la Guerre de Vingt Ans, l'archiduché d'Autriche était venu seul à bout du colosse franc, et ce en un laps de temps bien plus court.


- la maison de Throax garda le comté de Croatie
- la maison de Fifirchen reçut l'archevêché de Cologne
- la maison de Zoelie reçut l'archevêché de Trèves
- la maison de Greiffenau reçut le margravat de Bade
- la maison Sulerzycki reçut le comté de Thuringe
- la maison von Stubenrauch reçut la principauté de Hollande
- la maison de Karaiska reçut le protectorat des Flandres
Les grands banquets qui s'ensuivirent furent si magnifiques et arrosés qu'Alexander ne se releva plus après le dixième matin de fête. Son fils Franz Ludwig n'était pas encore en âge de prendre sa succession, le duché de Clèves s'empara de la couronne impériale. La création du Royaume d'Autriche fut moins heureuse que prévue ...