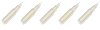Chroniques de Russie
un AAR-test sur Victoria 2, patch 1.1
difficulté normal/normal – première partie sur le jeu
1836
Depuis que l'on a vu des cosaques camper sur le Champ-de-Mars, accompagnés d'officiers chamarrés et d'une armée colossale et efficace, le monde tremble devant l'Empire Russe. D'un état en bordure du monde civilisé, rongé par les affrontements internes et tenu en échec par des puissances mineures, la Russie s'est élevée au rang de Grande Puissance, respectée et crainte.
Sa gigantesque superficie, inégalée, sa démographie solide, la richesse de son sol et la puissance de ses armées n'ont cessé d'impressionner les observateurs d'Europe. C'est avec une crainte notable qu'ont été enregistrés les réformes de l'éducation mises en oeuvre par Alexandre Ier. De nouvelles universités, de nouveaux domaines d'études (en premier lieu le droit), des plans d'études plus laxistes, la Russie à la pointe de la modernité!

C'est ce qui aurait pu être, ce qui aurait du être. Et pourtant, malgré plus de 60 millions de sujets s'agenouillant devant le sceptre du Tsar, l'Empire Russe reste un géant aux pieds d'argile. Seules la haute noblesse, une partie de la petite noblesse et la haute bourgeoisie ont profité d'une éducation satisfaisante, le taux général d'alphabétisation stagne lui à de lamentables 13%. Nicolas Ier a renforcé le contrôle de la police et des ministères sur les universités, il est devenu pratiquement impossible d'obtenir un passeport pour à l'étranger, serait-ce pour un voyage de villégiature.

L'armée qui jadis chassa le tyran Napoléon et lui fit payer cher la mise à sac des plus saintes villes de la Russie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les chiffres sont trompeurs, ses 70 brigades font miroiter une armée de terre de premier rang. Hélas! Les tactiques de l'ère napoléonienne sont toujours appliquées à la lettre, le système de recrutement archaïque est toujours en place, les sous-officiers des bons à rien incapables de lire des ordres, les officiers des nobliaux qui se pavanent sans maîtriser autre chose que leur propre sabre.

La pire des choses, c'est l'économie russe. Le servage handicape sévèrement l'artisanat, empêchant la plupart des paysans de se réorienter ou de vivre dans les villes. L'infrastructure est dans un état désastreux, les nombreux villages du pays ne sont souvent pas reliés entre eux, et quand ils le sont, c'est par des chemins de terre battue, vulnérables aux péripéties du temps. Personne ne souhaite acheter des produits russes, 95% des exports de l'Empire Russe sont au compte d'entreprises étrangères. Seule once de lumière dans ce sombre tableau, l'agriculture. Le blé d'Ukraine et de Courlande se vendent très bien dans les ports de la Baltique, de même les bovins élevés en Russie Blanche. Les chiffres pourraient être bien meilleurs, car la productivité des paysans est désastreuse. Arrivant à subvenir tant bien que mal à ses besoins les plus élémentaires, le paysan russe n'a aucune envie de tester de nouvelles méthodes qui pourraient signifier la famine en cas d'échec. Il faut aussi noter que les matières premières se vendent assez bien, les gigantesques forêts russes fournissent du bois aux arsenaux de toute l'Europe, et les mines de charbon crachent leurs fournées noires à intervalles réguliers.

Une économie primitive donc, qu'il convient de moderniser à toute vitesse si l'Empire Russe veut conserver son importance. Pour cela, une longue période de paix est nécessaire. Seuls les frères orthodoxes de Serbie, de Grèce et du Monténégro bénéficient de la protection directe du Tsar. Une alliance avec la Belgique est conclue suite à une opportunité unique au terme d'une partie de chasse des familles royales respectives. La Belgique, armée jusqu'aux dents, doit servir de tête de pont aux intérêts russes en Europe Occidentale. Des actions offensives sont tout à fait prohibées, car la situation fiscale est dramatique.

Le budget des armées est sabré sans pitié ni remords. Les dépôts sont vidés peu à peu de leurs armes et des réserves de nourriture. La troupe n'obtient que le nécessaire absolu, son niveau de préparation sombre en conséquence. Les impôts sur le sel et les alcools sont augmentés, ils toucheront principalement les pauvres du pays, mais sont les plus lucratifs. La spirale infernale des dettes est brisée, le budget impérial équilibré. Le surplus permet même d'ouvrir quelques rares écoles ainsi que d'engager une poignée de fonctionnaires chargés d'un meilleur contrôle fiscal. La situation reste tendue, et les riches de ce pays ne semblent pas capables d'industrialiser la Russie de leur propre force. Ils se perdent dans une foule de projets qui sont chacun à des années-lumières de rassembler le capital de départ nécessaire.

Le ministère de l'éducation se donne de la peine pour faire fructifier des talents locaux parmi les minorités ethniques qui parsèment le pays. Le ministère de l'intérieur, dirigé par un des conservateurs les plus sévères à la cour de Petergof, lui impose cependant des limites claires. La Lithuanie par exemple est considéré comme chasse gardée de la police secrète. La politique d'assimilation y est des plus dures, le Tsar souhaite la russification de la région. Un oukaze expédié au gouverneur doit accélérer le processus.

Alors que l'économie russe affiche de modestes progrès, la guerre éclate au printemps 1837 entre le Royaume de Belgique et les Royaume des Pays-Bas. L'alliance avec la Belgique est honorée, mais les navires de la flotte baltique resteront aux ports. Ils sont dans un état tellement désastreux que l'envoi en mer pour une période prolongée représente un sérieux risque. Sans parler des boulets ennemis ... L'Empire de Russie ne peut donc offrir que son soutien diplomatique. Ce n'est pas bien grave, car la Belgique se débrouille très bien toute seule.
Après avoir écrasé l'armée néerlandaise lors de la bataille de Middelburg, le général de Trooz put se consacrer à l'occupation des provinces de Gueldre. Une contre-attaque opérée par des contingents largement inférieurs en nombre fut balayée en peu de temps. L'intervention du Grand-Duché du Luxembourg ne changea rien au cours de la guerre.
Le conflit avait l'avantage de masquer des avances diplomatiques dans les Balkans. Les liens étroits qui unissaient jadis Slaves et orthodoxes se devaient d'être ravivés, au nez et à la barbe de l'Empire Ottoman. La Suède comme voisin direct de la Russie était également soumise à une offensive de courtoisie.
L'économie toujours vacillante de l'Empire Russe nécessitait des mesures radicales. Une commission spéciale développa plusieurs propositions pour enfin enclencher un processus d'industrialisation, les suivantes furent adoptées: suppression des impôts pour les classes supérieures et moyennes afin de libérer un capital de départ, divers avantages financiers pour la construction d'usines en Ingrie et garantie de subventions étatiques pour la production de matériaux industriels.
Les cercles libéraux de Pétersbourg ne furent guère enchantés par ce programme draconien, mais ce n'était là qu'une mouvance à l'influence limitée. La gangrène anticonservatrice qui secouait toute l'Europe n'avait pas encore atteint la Russie.
Le ministère du commerce avait décidé de régulations plus laxistes concernant les voies de commerce internes et externes, supprimant une bonne partie des pénibles contrôles qui handicapaient toute activité dans le secteur. Cette mesure provoqua une véritable explosion des ventes de charbon et de produits agricoles. Le flux de taxes qui en résulta fut investi dans l'éducation, la charge d'impôts pour le peuple quelque peu allégée.

La guerre aux Pays-Bas s'éternisait, le gouvernement néerlandais se refusait à céder aux exigences belges, à savoir l'annexion pure et simple des provinces de Gueldre. Le Tsar refusa de mettre fin à la guerre en échange de possessions coloniales pour la Russie, car l'affront diplomatique aurait été énorme pour le Roi des Belges. Une fois Amsterdam assiégée, le sort de la Gueldre était scellé, les Néerlandais ne pouvaient plus espérer de compromis. La Belgique tira grand profit de cette guerre, déchirant l'unité territoriale de ce qui fut jadis une grande puissance.

Il se trouve que cette agression caractérisée par de vieux ressentiments et des intérêts économiques évidents fit perdre beaucoup de retenue aux pays européens avides de conquêtes et de vengeance. Ainsi la France s'aventura à régler le fer à la main les problèmes internes espagnols, occasion qui fut immédiatement mise à profit par la Prusse, qui lorgnait sur l'Alsace-Moselle. Ce chaos ne put être déclenché qu'en raison des troubles de succession au Royaume-Uni, car autrement les Anglais eurent mis fin bien rapidement à ces vétustes bagarres.
Au courant de l'année 1840, les premières usines modernes ouvrirent en Russie. Parallèlement, une première ligne de chemin de fer fut construite ... par des investisseurs américains. L'industrialisation ne se fit pas sans heurts. La production n'était pas au point et malgré de colossaux subsides, les usines ne dégageaient que par trop rarement un profit.
Encouragés par l'aide massive de l'état, les investisseurs finirent cependant par se présenter de plus en plus nombreux aux portes de l'Empire. Le réseau de chemins de fer s'étendait à une vitesse vertigineuse, tandis que de nouvelles usines ouvraient à travers tout le pays. Le manque de rentabilité de ces projets pesait terriblement sur le budget impérial, qui les subventionnait à bras ouverts. Les dépenses montèrent jusqu'à 250 000 roubles-or par jour, un niveau qui n'aurait jamais pu être tenu sans une nouvelle expansion très importante de l'extraction de charbon, ceci grâce à des innovations technologiques.

Les succès étaient plus présents dans le domaine de la diplomatie. Malgré des revers en Vallachie et en Perse, jalousement gardés sous tutelle par l'Empire Ottoman, l'influence russe connut une croissance en Serbie, en Suède, en Grèce et au Monténégro, étendant ainsi la sphère d'influence économique et politique du Tsar. L'amélioration des relations avec la Chine promettait elle aussi de beaux lendemains.
Et pourtant les libéraux gagnaient du terrain! Leurs agitations irréfléchies contribuaient déjà à perdre les esprits les moins loyaux. Une révolte à l'est de l'Oural et des activités subversives en Arménie en étaient les conséquences directes. La police secrète avait beaucoup à faire en ces temps.