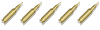AAR Quand l'heure du Brabant sonne...
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
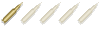
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
AAR Quand l'heure du Brabant sonne...
Extraits de "Histoire révisée de la Belgique, Royaume d'entre les Royaumes", par Jules Michelet :
1419-1430 : les saisons du bonheur
"L'histoire glorieuse de ce phare des nations commence réellement le 1er janvier 1419, quand le sage duc Jean IV fait entrer à son conseil un obscur baronnet, le chevalier du Taudis. Celui-ci ne tarde pas à gérer les affaires d'une main ferme, mais juste, et sera le premier des grands hommes qui marqueront l'histoire du Brabant.
Le chevalier du Taudis, dans sa conduite des affaires intérieures, étatit aidé par les caractéristiques même du duché : un territoire limité, dont l'opinion facile à modeler garantissait une stabilité relative. La trésorerie ducale, riche de 1200 écus, permettait une politique de réformes hardies. Enfin, le duché était vassal de l'insatiable et puissant Jean sans Peur, duc de Bourgogne, dont la politique hardie dissimulait mal son ambition de pouvoir.
Paradoxalement, les avantages du Brabant desservait le chevalier du Taudis sur bien des points : les revenus annuels ne couvraient pas les inévitables dépenses et limitaient le développement économique. Le chevalier s'occuperait de changer cela.
Sa première action - révolutionnaire pour l'époque - fut de congédier les forces armées : limiter les dépenses quelles qu'elles fussent était la clé de sa politique économique. Il fallait pour cela parier sur l'absence de conflits et de révoltes : une abstention de toute alliance militaire et la sage politique du bien-aimé ducsuffirait à cela - du moins, le chevalier l'espérait-il.
De même, le chevalier entreprit d'orienter le duché vers les joies du libre-échange commercial, dans le but avoué de flatter les ambitions des négociants brabançons ; les prises de position résolument catholiques favoriseraient des relations amicales sans cesse croissantes avec les autres pays européens. La fiscalité fut améliorée grâce à l'institution de la charge de bailli.
Le danger viendrait un jour de la puissante France, de l'ambitieuse Bourgogne et de la traîtreuse Albion. Le chevalier du Taudis en était conscient, mais il ne pouvait, à cette date, qu'assister en spectateur impuissant aux vagues politiques toujours plus fortes qui remodelaient dans leur fureur les rivages européens.
Les années 1420-1425 voyaient en effet plusieurs changements majeurs dans la carte politique avoisinante : l'océan de la guerre et des manoeuvres politiques engloutit des nations et vit sombrer des indépendances millénaires. Quand le flux décrut, il laissa une Angleterre agrandie de la Frise et de l'Orléanais, et une Bourgogne amputée de la Franche-Comté, désormais Lorraine. La France s'était agrandie de l'Artois et développait ses réseaux diplomatiques.
Pendant ce temps, la sage politique économique du chevalier avait porté ses fruits : les marchands brabançons ne connaissaient pas de rivaux en Europe, et leur but était désormais de prendre le contrôle du marché flamand, en tenant d'en obtenir le monopole, qui leur assurerait la prospérité. Il faudra cependant plusieurs décennies pour y parvenir.
La rapace Angleterre, ayant satisfait son appétit dans le Nord, se tournait maintenant vers des contrées plus chatoyantes : engagée dans plusieurs conflits, elle conquit Gibraltar et imposa sa loi à l'Aragon désormais son vassal.
Les nations du levant exhalèrent leur sauvagerie guerrière : la Bavière augmentait sa puissance, la Lorraine conquérrait le canton de Berne.
En 1427, la Frise se révoltait. La contagion gagnait la Hollande. A Bruxelles, on s'entregardait dans la crainte : les hordes de croquant mettraient-elles le siège devant Bruxelles, mal gardée et sans forces armées pour la défendre. Le chevalier renforça les forteresses, et le nouveau duc lui confia la garde du duché, en l'honorant du titre de vicomte.
1430 vit l'avénement de la grosse duchesse Jacqueline de Bavière, piètre dirigeante, dont l'incompétence allait desservir le Brabant durant près d'un demi-siècle. Les investissements en pâtiraient pour longtemps, et l'indépendance du duché faillit être remise en cause l'année suivante. La Bourgogne avait en effet eu l'outrecuidance, en 1431, de faire valoir ses droits sur le duché : Philippe le Hardi proposait en effet, ni plus ni moins, d'annexer le Brabant à ses territoires. La grosse Jacqueline fut sur le point de céder, mais le vicomte du Taudis sut infléchir la volonté du conseil et préserver l'indépendance du duché. Les partisans de la grosse et incompétente Jacqueline fomentèrent une révolte : Bruxelles tomba aux mains des factieux, le conseil fut chassé. La grosse se retrouva seule et compris l'étendue de son incapacité : elle rappela le vicomte du Taudis.
La Bourgogne proposa alors une alliance militaire. Le matois vicomte devinait les conséquences possibles d'une telle entreprise. Il entrevit la ruine du pays, le commerce paralysé, la trésorerie toujours chancelante complètement pillée. Néanmoins, la France ne cachait pas ses ambitions guerrières : Bruxelles était à une longue portée d'arc de l'Artois. Le vicomte ratifia le Traité d'Alliance.
Ce fut un piège bourguignon.
Il ne fallut pas attendre un mois pour que le Hardi déclarât la guerre à ses voisins : Cologne, Clèves et la Gueldre. Les mariages en cours furent brisés. Bien plus, les derniers partisans de Jacqueline trahirent leur pays, s'aiilant aux puissances étrangères. Le duché sombrait dans le chaos.
Le vicomte s'activait, tentant d'apaiser le duché : les troubles ne permettaient pas une levée d'hommes, et six mille hommes à pied seuelement purent être réunis afin de veiller à la sauvegarde de la nation. Mesure illusoire : ce corps hâtivement constitué ne permettrait pas de repousser une attaque bien menée. L'argent ne rentrait plus. Bruxelles vivait dans la peur d'une offensive ou d'un soulèvement.
La peur passa. La paix fut signée. Bruxelles était épargnée.
L'argent ne le fut pas : les caisses étaient vides, le pays ruiné. La Bourgogne infidèle avait accompli sa vengeance et abaissé son trop fier vassal. Les marchans avaient déserté les foires flamandes, la trésorerie ne comptait plus que quelques écus. Le vicomte perdait son titre et se retrouvait baronnet.
Le fragile édifice économique s'était effondré sous la tempête bourguignonne. Tout était à refaire.
1431-1476 : le temps du redressement
La Bourgogne elle-même ne conservait plus, en-dehors de France que les Flandres et la Zélande. Son affaiblissement pourrait profiter, peut-être, un jour, au Brabant.
L'année 1434 fut à nouveau celle des troubles : la France avait arrêté son regard prédateur sur le Luxembourg. Philippe le Hardi, craignant pour son héritage, déclarait la guerre à la Lorraine, et par-là même à la France.
Le chevalier du Taudis eut la sagesse de quitter l'alliance : désormais la Bourgogne était un adversaire et non plus un protecteur bienveillant. Les espoirs du Brabant reposaient sur l'action française : que le Roi des Lys dépeçât les territoires bourguignons n'était pas pour lui déplaire. Hélas, la trêve fut rapide : la Bourgogne ne perdait rien, la France gagnait le Luxembourg. L'Autriche, de son côté, déployait les ailes de son aigle vers l'ouest et annexait l'Alsace. Autour du duché solitaire, les grandes nations convergeaient.
Dix ans se passèrent paisiblement. On fit une petite fête en 1438, quand la trésorerie se garnissait de 100 écus. Le chevalier eut cette parole historique : "C'est bien, le Brabant, mais c'est barbant."
La France augmentait toujours sa puissance : elle s'alliait à la Lorraine, la Provence, la Savoie, la Bretagne, le Bourbonnais, l'Auvergne et même la Castille. Assurée de sa puissance, elle déclara la guerre à la Ligue rhénane (Hesse, Gueldre, Clèves, Cologne, Oldenbourg, Saxe). La perfide Albion se jeta dans le conflit, déclarant la guerre à la Ligue, suivie par l'Aragon, la Navarre, la Hollande et la Bourgogne.
1444 voit l'influence du chevalier grandir : tous les pays voisins étaient ravagés par la guerre. Le duché seul était épargné, tentant de rebâtir son économie et de soutenir ses négociants, toujours plus nombreux, du fait des orientations politiques hardies du Brabant. Le chevalier rentra définitivement en grâce et retrouva son titre de vicomte. Le Brabant entrait dans le "G7" des nations mondiales.
Les évenements se précipitaient à ses frontières : l'Angleterre annexait perfidement l'Oldenbourg et prenait le contrôle de la Hollande. La France fit main basse sur Clèves et sur le Palatinat. La Bavière elle-même croissait et annexait Mayence et le Wurzburg. Hanovre passait dans le giron de Munster, la Gueldre devenait aragonnaise.
Un peu plus loin, la donne politique était redistribuée également : le Bourbonnais prenait contrôle du Maine, et la France confisquait l'Armor à la Bretagne, avant de tourner ses regards vers l'Auvergne et la Svoie, qu'elle annexa également. Elle gagnait ainsi la province savoyarde du Milanais et dirigeait ses ambitions vers l'Italie.
Le duché, épargné par les conflits, voyait ses voisins disparâitre peu à peu. L'Angleterre avait conquis, par les armes ou les négociations, la Hollande, la Frise et l'Oldenbourg. Le Luxembourg, Cologne, Clèves étaient français, la Hesse et Mayance, bavarois.
La principale menace provenait de la belliqueuse France, désormais occupée à ravager Modène. Un mariage royal garantissait à peu près une tranquilité au Brabant, mais ce mariage expirait en 1459, et les relations détériorées au fil des ans ne permettaient pas la reconduction de ce type d'alliance. La trésorerie n'aurait pas suffit à améliorer de beaucoup les relations de mauvais voisinages entretenues avec le puissant voisin méridional. D'autant plus que la grosse Jacqueline - toujours au pouvoir, hélas - se révélait une piètre diplomate. Le vicomte fit néanmoins parvenir à la France une lettre d'introduction, espérant qu'elle suffît pour retarder les ardeurs guerrières de Charles VII.
Les décennies suivantes alternaient soulèvements, indépendances et reconquêtes : la Bretagne et la Guyenne soulevaient le joug anglais, la Frise et la Hollande retrouvaient leur indépendance. Mais tous les regards se tournaient vers la France : qui pourrait arrêter l'appétit insatiable de la couronne des Lys ? Certainement pas le Brabant...
En 1469, un pays osa relever le défi : l'Autriche envahit le sol français. La guerre dura sept ans ans, sur fond de conquêtes et de reconquêtes et se termina à l'avantage des deux belligérants : l'Autriche, déjà maîtresse de l'Alsace, de Bade et du Wurtemberg, annexa le canton de Schwyz et la Franche-Comté ; la France vassalisait la Lorraine, faisant ainsi main basse sur le canton de Berne. Elle conservait la Savoie, le Piémont, la Lombardie et Modène : la route de l'Italie lui restait ouverte. Une guerre rapide avec l'Aragon lui avait permis de prendre contrôle du Morbihan et du Roussillon.
1476-1482 : la fourberie autrichienne
1476 fut l'année des renversements : la Bourgogne, disparaissait, partagée entre la France et l'Autriche, désormais maîtres des Flandres et de la Zélande. Un mariage unissait le Brabant et l'Autriche, les relations étaient bonnes, et le vicomte pensa qu'il n'avait pas de sujet d'inquiétude : les ambitions autrichiennes devaient être ailleurs. Il recruta néanmoins une garde armée afin de signaler avec force sa volonté d'indépendance.
La France avait joué de jolis coups, étendant son territoire de façon ahurissante. Elle était néanmoin isolée. La guerre revint : le Bourbonnais, la Bretagne, l'Espagne l'attaquaient de toutes parts.
Le vicomte du Taudis suivait les événements avec intérêt, pérjugeant des pertes possibles de son trop puissant voisin.
Une missive le tira de ses réflexions, le 21 juin 1477 : l'Autriche décidait de rompre le mariage en cours, et par la même occasion, déclarait la guerre au Brabant ! C'était le moment où l'avenir se jouerait, le combat du jour et de la nuit.
Les circonstances plaidaient en défaveur du Brabant : un trésor épuisé, peu d'armées recrutables, face à une Autriche conquérante, et capable d'amener rapîdement des troupes de Vienne jusqu'à la mer du Nord, à travers les territoires imépriaux.
Deux éléments penchaient dans la balance : l'Autriche n'avait guère de troupes en Flandre et en Zéalnde ; elle s'occupait seulement d'en recruter. Bien plus, la Bavière, à juste titre révoltée par la déclaration de guerre, quittait l'alliance autrichienne, dans laquelle ne demeurait plus que Cuma, Sienne et l'Ulster. Ce qui est peu, convenons-en, pour effrayer la vaillance brabançonne.
La grosse Jacqueline fut enfin utile, et n'eut pas de peine à persuader son cousin de Bavière à se ranger à nos côtés. Les troupes bavaroises se chargeraient utilement de briser, ou du moins de ralentir, la percée autrichienne.
Bien plus, les procédés disgracieux de Frédéric V suscitaient l'indignation dans son propre pays, et surtout dans ses fraîches conquêtes. L'instabilité gagnait l'Autriche, paraysant le recrutement et détournant l'attention de l'aigle en plein envol. Le vicomte allait mettre ces paramètres à profit.
Pour cela, il fallait attaquer le premier. A prix d'or, et à coups d'emprunts, des troupes de mercenaires furent levées, qui firent grossir le contingent armé déjà recruté. Ces troupes assiégèrent rapidement la Zélande et les Flandres. La capacité d'emprunt fut portée au maximum, afin de soutenir l'effort de guerre.
Les jeunes recrues autrichiennes, levées à la hâte dans les provinces flamandes, se débandèrent à la première attaque. Elles surent hélas infliger de lourdes pertes aux armées brabançonnes, alors même que chaque homme comptait.
L'Autriche trouvait de nouveaux alliés : Hanovre et la Poméranie s'engageait à ses côtés dans le conflit. Le duché vivait d'emprunts successifs, et ses troupes ne parvenaient pas à assiéger correctement les villes flamandes.
Heureusement, la Bavière n'oubliait pas ses alliés : une troupe de trente mille hommes se joignit aux armées cnatonnées en Zélande. De leur côté, les armées autrichiennes demeuraient invisibles, excepté quelques bandes errantes composées d'à peine deux mille homems. Les sièges continuaient.
Mais les événements empirèrent. En août 1479, la Bavière obtenait une paix avec l'Autriche, en échange d'indemnités conséquentes. Ses troupes quittaient la Zélande.
Bien plus, les fonds manquaient. Les emprunts ne purent être remboursés, et la banqueroute frappa le Brabant. La période des troubles commençaient. Une tentative de paix blanche fut repoussée par l'Autriche.
Un instructeur en armement vint proposer ses services à prix d'or. Le vicomte l'embaucha, recourant une fois de plus au subterfuge de l'emprunt. La situation financière était catastrophique : l'argent déposé dans les caisses s'envolait le mois suivant.
Enfin, en mai 1480, la Zélande tomba. Les forces brabançonnes convergèrent vers la Flandre. L'Autrichien demeurait toujours invisible, trop occupé à éteindre les révoltes qu'il avait lui-même allumées dans son empire.
Le vicomte du Taudis dirigea lui-même les opérations en Flandre : il y gagna le titre de Duc. Les emprunts nourrisaient l'effort de guerre, à l'exclusion de toute autre activité. Les risques de révoltes s'amoindrirent. Hélas, la situation financière désastreuse se traduisit à nouveau par une banqueroute, le 1er janvier 1481.
Le Brabant entrait dans un cercle vicieux, vivant à crédit. On dût à nouveau emprunter pour payer les troupes et en recruter de nouvelles.
Les efforts payèrent : la Flandre capitula en mars.
Alors que le Duc se demandait comment monnayer ses conquêtes (l'Autriche ne céderait jamais la Zélande et la Flandre), l'Helvétie secoua le joug autrichien. L'alliance autrichienne se disloqua. Affolé, Frédéric V voulut la paix à tout prix : il la proposa en échange de la Flandre et de la Zélande. Le Duc fut tout heureux d'accepter et s'empressa de signer la paix avant que l'Autriche ne se ravise.
Le territoire branbaçon avait triplé. Frédéric V de son côté, avait les mains libres pour mater les turbulents Helvètes.
1482-1489 : un nouvel espoir
Le 1er janvier 1482, la grosse Jacqueline, hélas toujours en vie, pouvait faire son entrée dans ses bonnes villes flamandes et zélandaises, débarrassées du joug autrichien.
Vers la même époque, les courageux Helvètes redevenaient autrichiens, mais personne ne s'en souçiat : le vent de la liberté soufflait ailleurs, et la Hollande puis la Frise se détachèrent à nouveau de l'emprise anglaise.
L'Autriche se trouva une occupation en se frottant à la Hongire. La France se battait contre l'Espagne, l'Angleterre contre n'importe qui.
La stabilité revenait doucement en Brabant, les marchands revindrent et reprirent leurs activités. Le Brabant possédait désormais un accès à la mer, et contrôlait le centre de commerce flamand, mais il avait payé cher ses conquêtes. L'inflation, qui n'avait jamais dépassé la barre des 0,2% était maintenant de 20% et ralentissait l'activité.
Tous, en Brabant, attendaient désormais la mort de l'incomptéente et grosse Jacqueline. Il se murmurait que le Duc du Taudis, l'artisan de la victoire, le père du peuple, pourrait un jour devenir régent...
1419-1430 : les saisons du bonheur
"L'histoire glorieuse de ce phare des nations commence réellement le 1er janvier 1419, quand le sage duc Jean IV fait entrer à son conseil un obscur baronnet, le chevalier du Taudis. Celui-ci ne tarde pas à gérer les affaires d'une main ferme, mais juste, et sera le premier des grands hommes qui marqueront l'histoire du Brabant.
Le chevalier du Taudis, dans sa conduite des affaires intérieures, étatit aidé par les caractéristiques même du duché : un territoire limité, dont l'opinion facile à modeler garantissait une stabilité relative. La trésorerie ducale, riche de 1200 écus, permettait une politique de réformes hardies. Enfin, le duché était vassal de l'insatiable et puissant Jean sans Peur, duc de Bourgogne, dont la politique hardie dissimulait mal son ambition de pouvoir.
Paradoxalement, les avantages du Brabant desservait le chevalier du Taudis sur bien des points : les revenus annuels ne couvraient pas les inévitables dépenses et limitaient le développement économique. Le chevalier s'occuperait de changer cela.
Sa première action - révolutionnaire pour l'époque - fut de congédier les forces armées : limiter les dépenses quelles qu'elles fussent était la clé de sa politique économique. Il fallait pour cela parier sur l'absence de conflits et de révoltes : une abstention de toute alliance militaire et la sage politique du bien-aimé ducsuffirait à cela - du moins, le chevalier l'espérait-il.
De même, le chevalier entreprit d'orienter le duché vers les joies du libre-échange commercial, dans le but avoué de flatter les ambitions des négociants brabançons ; les prises de position résolument catholiques favoriseraient des relations amicales sans cesse croissantes avec les autres pays européens. La fiscalité fut améliorée grâce à l'institution de la charge de bailli.
Le danger viendrait un jour de la puissante France, de l'ambitieuse Bourgogne et de la traîtreuse Albion. Le chevalier du Taudis en était conscient, mais il ne pouvait, à cette date, qu'assister en spectateur impuissant aux vagues politiques toujours plus fortes qui remodelaient dans leur fureur les rivages européens.
Les années 1420-1425 voyaient en effet plusieurs changements majeurs dans la carte politique avoisinante : l'océan de la guerre et des manoeuvres politiques engloutit des nations et vit sombrer des indépendances millénaires. Quand le flux décrut, il laissa une Angleterre agrandie de la Frise et de l'Orléanais, et une Bourgogne amputée de la Franche-Comté, désormais Lorraine. La France s'était agrandie de l'Artois et développait ses réseaux diplomatiques.
Pendant ce temps, la sage politique économique du chevalier avait porté ses fruits : les marchands brabançons ne connaissaient pas de rivaux en Europe, et leur but était désormais de prendre le contrôle du marché flamand, en tenant d'en obtenir le monopole, qui leur assurerait la prospérité. Il faudra cependant plusieurs décennies pour y parvenir.
La rapace Angleterre, ayant satisfait son appétit dans le Nord, se tournait maintenant vers des contrées plus chatoyantes : engagée dans plusieurs conflits, elle conquit Gibraltar et imposa sa loi à l'Aragon désormais son vassal.
Les nations du levant exhalèrent leur sauvagerie guerrière : la Bavière augmentait sa puissance, la Lorraine conquérrait le canton de Berne.
En 1427, la Frise se révoltait. La contagion gagnait la Hollande. A Bruxelles, on s'entregardait dans la crainte : les hordes de croquant mettraient-elles le siège devant Bruxelles, mal gardée et sans forces armées pour la défendre. Le chevalier renforça les forteresses, et le nouveau duc lui confia la garde du duché, en l'honorant du titre de vicomte.
1430 vit l'avénement de la grosse duchesse Jacqueline de Bavière, piètre dirigeante, dont l'incompétence allait desservir le Brabant durant près d'un demi-siècle. Les investissements en pâtiraient pour longtemps, et l'indépendance du duché faillit être remise en cause l'année suivante. La Bourgogne avait en effet eu l'outrecuidance, en 1431, de faire valoir ses droits sur le duché : Philippe le Hardi proposait en effet, ni plus ni moins, d'annexer le Brabant à ses territoires. La grosse Jacqueline fut sur le point de céder, mais le vicomte du Taudis sut infléchir la volonté du conseil et préserver l'indépendance du duché. Les partisans de la grosse et incompétente Jacqueline fomentèrent une révolte : Bruxelles tomba aux mains des factieux, le conseil fut chassé. La grosse se retrouva seule et compris l'étendue de son incapacité : elle rappela le vicomte du Taudis.
La Bourgogne proposa alors une alliance militaire. Le matois vicomte devinait les conséquences possibles d'une telle entreprise. Il entrevit la ruine du pays, le commerce paralysé, la trésorerie toujours chancelante complètement pillée. Néanmoins, la France ne cachait pas ses ambitions guerrières : Bruxelles était à une longue portée d'arc de l'Artois. Le vicomte ratifia le Traité d'Alliance.
Ce fut un piège bourguignon.
Il ne fallut pas attendre un mois pour que le Hardi déclarât la guerre à ses voisins : Cologne, Clèves et la Gueldre. Les mariages en cours furent brisés. Bien plus, les derniers partisans de Jacqueline trahirent leur pays, s'aiilant aux puissances étrangères. Le duché sombrait dans le chaos.
Le vicomte s'activait, tentant d'apaiser le duché : les troubles ne permettaient pas une levée d'hommes, et six mille hommes à pied seuelement purent être réunis afin de veiller à la sauvegarde de la nation. Mesure illusoire : ce corps hâtivement constitué ne permettrait pas de repousser une attaque bien menée. L'argent ne rentrait plus. Bruxelles vivait dans la peur d'une offensive ou d'un soulèvement.
La peur passa. La paix fut signée. Bruxelles était épargnée.
L'argent ne le fut pas : les caisses étaient vides, le pays ruiné. La Bourgogne infidèle avait accompli sa vengeance et abaissé son trop fier vassal. Les marchans avaient déserté les foires flamandes, la trésorerie ne comptait plus que quelques écus. Le vicomte perdait son titre et se retrouvait baronnet.
Le fragile édifice économique s'était effondré sous la tempête bourguignonne. Tout était à refaire.
1431-1476 : le temps du redressement
La Bourgogne elle-même ne conservait plus, en-dehors de France que les Flandres et la Zélande. Son affaiblissement pourrait profiter, peut-être, un jour, au Brabant.
L'année 1434 fut à nouveau celle des troubles : la France avait arrêté son regard prédateur sur le Luxembourg. Philippe le Hardi, craignant pour son héritage, déclarait la guerre à la Lorraine, et par-là même à la France.
Le chevalier du Taudis eut la sagesse de quitter l'alliance : désormais la Bourgogne était un adversaire et non plus un protecteur bienveillant. Les espoirs du Brabant reposaient sur l'action française : que le Roi des Lys dépeçât les territoires bourguignons n'était pas pour lui déplaire. Hélas, la trêve fut rapide : la Bourgogne ne perdait rien, la France gagnait le Luxembourg. L'Autriche, de son côté, déployait les ailes de son aigle vers l'ouest et annexait l'Alsace. Autour du duché solitaire, les grandes nations convergeaient.
Dix ans se passèrent paisiblement. On fit une petite fête en 1438, quand la trésorerie se garnissait de 100 écus. Le chevalier eut cette parole historique : "C'est bien, le Brabant, mais c'est barbant."
La France augmentait toujours sa puissance : elle s'alliait à la Lorraine, la Provence, la Savoie, la Bretagne, le Bourbonnais, l'Auvergne et même la Castille. Assurée de sa puissance, elle déclara la guerre à la Ligue rhénane (Hesse, Gueldre, Clèves, Cologne, Oldenbourg, Saxe). La perfide Albion se jeta dans le conflit, déclarant la guerre à la Ligue, suivie par l'Aragon, la Navarre, la Hollande et la Bourgogne.
1444 voit l'influence du chevalier grandir : tous les pays voisins étaient ravagés par la guerre. Le duché seul était épargné, tentant de rebâtir son économie et de soutenir ses négociants, toujours plus nombreux, du fait des orientations politiques hardies du Brabant. Le chevalier rentra définitivement en grâce et retrouva son titre de vicomte. Le Brabant entrait dans le "G7" des nations mondiales.
Les évenements se précipitaient à ses frontières : l'Angleterre annexait perfidement l'Oldenbourg et prenait le contrôle de la Hollande. La France fit main basse sur Clèves et sur le Palatinat. La Bavière elle-même croissait et annexait Mayence et le Wurzburg. Hanovre passait dans le giron de Munster, la Gueldre devenait aragonnaise.
Un peu plus loin, la donne politique était redistribuée également : le Bourbonnais prenait contrôle du Maine, et la France confisquait l'Armor à la Bretagne, avant de tourner ses regards vers l'Auvergne et la Svoie, qu'elle annexa également. Elle gagnait ainsi la province savoyarde du Milanais et dirigeait ses ambitions vers l'Italie.
Le duché, épargné par les conflits, voyait ses voisins disparâitre peu à peu. L'Angleterre avait conquis, par les armes ou les négociations, la Hollande, la Frise et l'Oldenbourg. Le Luxembourg, Cologne, Clèves étaient français, la Hesse et Mayance, bavarois.
La principale menace provenait de la belliqueuse France, désormais occupée à ravager Modène. Un mariage royal garantissait à peu près une tranquilité au Brabant, mais ce mariage expirait en 1459, et les relations détériorées au fil des ans ne permettaient pas la reconduction de ce type d'alliance. La trésorerie n'aurait pas suffit à améliorer de beaucoup les relations de mauvais voisinages entretenues avec le puissant voisin méridional. D'autant plus que la grosse Jacqueline - toujours au pouvoir, hélas - se révélait une piètre diplomate. Le vicomte fit néanmoins parvenir à la France une lettre d'introduction, espérant qu'elle suffît pour retarder les ardeurs guerrières de Charles VII.
Les décennies suivantes alternaient soulèvements, indépendances et reconquêtes : la Bretagne et la Guyenne soulevaient le joug anglais, la Frise et la Hollande retrouvaient leur indépendance. Mais tous les regards se tournaient vers la France : qui pourrait arrêter l'appétit insatiable de la couronne des Lys ? Certainement pas le Brabant...
En 1469, un pays osa relever le défi : l'Autriche envahit le sol français. La guerre dura sept ans ans, sur fond de conquêtes et de reconquêtes et se termina à l'avantage des deux belligérants : l'Autriche, déjà maîtresse de l'Alsace, de Bade et du Wurtemberg, annexa le canton de Schwyz et la Franche-Comté ; la France vassalisait la Lorraine, faisant ainsi main basse sur le canton de Berne. Elle conservait la Savoie, le Piémont, la Lombardie et Modène : la route de l'Italie lui restait ouverte. Une guerre rapide avec l'Aragon lui avait permis de prendre contrôle du Morbihan et du Roussillon.
1476-1482 : la fourberie autrichienne
1476 fut l'année des renversements : la Bourgogne, disparaissait, partagée entre la France et l'Autriche, désormais maîtres des Flandres et de la Zélande. Un mariage unissait le Brabant et l'Autriche, les relations étaient bonnes, et le vicomte pensa qu'il n'avait pas de sujet d'inquiétude : les ambitions autrichiennes devaient être ailleurs. Il recruta néanmoins une garde armée afin de signaler avec force sa volonté d'indépendance.
La France avait joué de jolis coups, étendant son territoire de façon ahurissante. Elle était néanmoin isolée. La guerre revint : le Bourbonnais, la Bretagne, l'Espagne l'attaquaient de toutes parts.
Le vicomte du Taudis suivait les événements avec intérêt, pérjugeant des pertes possibles de son trop puissant voisin.
Une missive le tira de ses réflexions, le 21 juin 1477 : l'Autriche décidait de rompre le mariage en cours, et par la même occasion, déclarait la guerre au Brabant ! C'était le moment où l'avenir se jouerait, le combat du jour et de la nuit.
Les circonstances plaidaient en défaveur du Brabant : un trésor épuisé, peu d'armées recrutables, face à une Autriche conquérante, et capable d'amener rapîdement des troupes de Vienne jusqu'à la mer du Nord, à travers les territoires imépriaux.
Deux éléments penchaient dans la balance : l'Autriche n'avait guère de troupes en Flandre et en Zéalnde ; elle s'occupait seulement d'en recruter. Bien plus, la Bavière, à juste titre révoltée par la déclaration de guerre, quittait l'alliance autrichienne, dans laquelle ne demeurait plus que Cuma, Sienne et l'Ulster. Ce qui est peu, convenons-en, pour effrayer la vaillance brabançonne.
La grosse Jacqueline fut enfin utile, et n'eut pas de peine à persuader son cousin de Bavière à se ranger à nos côtés. Les troupes bavaroises se chargeraient utilement de briser, ou du moins de ralentir, la percée autrichienne.
Bien plus, les procédés disgracieux de Frédéric V suscitaient l'indignation dans son propre pays, et surtout dans ses fraîches conquêtes. L'instabilité gagnait l'Autriche, paraysant le recrutement et détournant l'attention de l'aigle en plein envol. Le vicomte allait mettre ces paramètres à profit.
Pour cela, il fallait attaquer le premier. A prix d'or, et à coups d'emprunts, des troupes de mercenaires furent levées, qui firent grossir le contingent armé déjà recruté. Ces troupes assiégèrent rapidement la Zélande et les Flandres. La capacité d'emprunt fut portée au maximum, afin de soutenir l'effort de guerre.
Les jeunes recrues autrichiennes, levées à la hâte dans les provinces flamandes, se débandèrent à la première attaque. Elles surent hélas infliger de lourdes pertes aux armées brabançonnes, alors même que chaque homme comptait.
L'Autriche trouvait de nouveaux alliés : Hanovre et la Poméranie s'engageait à ses côtés dans le conflit. Le duché vivait d'emprunts successifs, et ses troupes ne parvenaient pas à assiéger correctement les villes flamandes.
Heureusement, la Bavière n'oubliait pas ses alliés : une troupe de trente mille hommes se joignit aux armées cnatonnées en Zélande. De leur côté, les armées autrichiennes demeuraient invisibles, excepté quelques bandes errantes composées d'à peine deux mille homems. Les sièges continuaient.
Mais les événements empirèrent. En août 1479, la Bavière obtenait une paix avec l'Autriche, en échange d'indemnités conséquentes. Ses troupes quittaient la Zélande.
Bien plus, les fonds manquaient. Les emprunts ne purent être remboursés, et la banqueroute frappa le Brabant. La période des troubles commençaient. Une tentative de paix blanche fut repoussée par l'Autriche.
Un instructeur en armement vint proposer ses services à prix d'or. Le vicomte l'embaucha, recourant une fois de plus au subterfuge de l'emprunt. La situation financière était catastrophique : l'argent déposé dans les caisses s'envolait le mois suivant.
Enfin, en mai 1480, la Zélande tomba. Les forces brabançonnes convergèrent vers la Flandre. L'Autrichien demeurait toujours invisible, trop occupé à éteindre les révoltes qu'il avait lui-même allumées dans son empire.
Le vicomte du Taudis dirigea lui-même les opérations en Flandre : il y gagna le titre de Duc. Les emprunts nourrisaient l'effort de guerre, à l'exclusion de toute autre activité. Les risques de révoltes s'amoindrirent. Hélas, la situation financière désastreuse se traduisit à nouveau par une banqueroute, le 1er janvier 1481.
Le Brabant entrait dans un cercle vicieux, vivant à crédit. On dût à nouveau emprunter pour payer les troupes et en recruter de nouvelles.
Les efforts payèrent : la Flandre capitula en mars.
Alors que le Duc se demandait comment monnayer ses conquêtes (l'Autriche ne céderait jamais la Zélande et la Flandre), l'Helvétie secoua le joug autrichien. L'alliance autrichienne se disloqua. Affolé, Frédéric V voulut la paix à tout prix : il la proposa en échange de la Flandre et de la Zélande. Le Duc fut tout heureux d'accepter et s'empressa de signer la paix avant que l'Autriche ne se ravise.
Le territoire branbaçon avait triplé. Frédéric V de son côté, avait les mains libres pour mater les turbulents Helvètes.
1482-1489 : un nouvel espoir
Le 1er janvier 1482, la grosse Jacqueline, hélas toujours en vie, pouvait faire son entrée dans ses bonnes villes flamandes et zélandaises, débarrassées du joug autrichien.
Vers la même époque, les courageux Helvètes redevenaient autrichiens, mais personne ne s'en souçiat : le vent de la liberté soufflait ailleurs, et la Hollande puis la Frise se détachèrent à nouveau de l'emprise anglaise.
L'Autriche se trouva une occupation en se frottant à la Hongire. La France se battait contre l'Espagne, l'Angleterre contre n'importe qui.
La stabilité revenait doucement en Brabant, les marchands revindrent et reprirent leurs activités. Le Brabant possédait désormais un accès à la mer, et contrôlait le centre de commerce flamand, mais il avait payé cher ses conquêtes. L'inflation, qui n'avait jamais dépassé la barre des 0,2% était maintenant de 20% et ralentissait l'activité.
Tous, en Brabant, attendaient désormais la mort de l'incomptéente et grosse Jacqueline. Il se murmurait que le Duc du Taudis, l'artisan de la victoire, le père du peuple, pourrait un jour devenir régent...
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
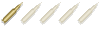
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
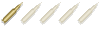
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
1488-1490 : la campagne de France
Le duché sortait agrandi de l'épreuve autrichienne. Pendant que la grosse Jacqueline s'épuisait en fêtes ruineuses et insensées, le bon Duc se trouvait face à une épineuse situation : comment parvenir à redresser l'économie moribonde du duché ? Une autre menace survolait de son aile ténébreuse les riantes terres flamandes : la soif de conquête des grandes nations ne pouvait ignorer très longtemps les joyeuses citées branbançonnes, terres de libertés narguant les orgueils impérialistes. L'Autriche mise à genoux, la France se dressait toujours plus grande, son talon de fer menaçant toujours davantage les terres du Nord.
Le Duc occupa les années de paix à restaurer la puissance commerciale du duché. L'inflation grevait lourdement les investissements, et les fonds de la trésorerie parvenaient à peine à financer le placement de marchands. Perdu pour perdu, le Duc laissa (intelligement) filer l'inflation, qui augmenta rapidement, et concentra ses efforts sur la conquête du marché flamand. Son idée principale était toujours liée à celle d'un monopole sur le centre de commerce anversois.
Hélas, les investissements en tous genre, qui se faisaient rapidement aux heures de gloire du début du siècle, étaient désormais ralentis par l'inflation et l'incompétence de la grosse duchesse. Les armées et la marine stagnaient dans leur équipements médiévaux. L'infrastructure progressait à peine, et l'argent manquait pour promouvoir les baillis. Les efforts se focalisaient de toutes façons sur le développement commercial : les bourgeois brugeois firent don de 5 galères à la duchesse. Le Duc les fit couler dans l'heure, estimant que les frais d'entretien de navires inacapables d'affronter l'océan étaient superflus.
Le duché remontait doucement la pente, à la suite de l'inflation qui elle aussi grimpait très rapidement.
L'heure viendrait un jour de mettre au pas de trop puissants voisins.
L'Autriche, engagée dans une guerre contre la Hongrie, la Pologne et la Bohême voyait ses marches de l'Est ravagées. Ses conquêtes occidentales se soulevaient régulièrement, détournant pour le moment l'Empereur d'une revanche brabançonne.
En 1486 eut lieu "l'Affaire de Bretagne" : l'Armor se souleva contre la domination française et rejoignit la Bretagne. Le roi de France coupa court à toute tentative diplomatique et déclara la guerre aux Bretons.
Mal lui en pris.
La France était en effet isolée dans le jeu européen ; ses conquêtes rapides l'avaient fait haïr de bien des nations. Elle dut affronter une alliance solide, composée de l'Espagne, de la Guyenne, du Portugal, du Bourbonnais de Brême et de l'Aragon.
L'occasion s'offrait de rogner les pétales du lys français.
Le Duc s'oocupa de recuter des troupes vaillantes, et attendit que la guerre eût suffisament épuisé l'arrogance française. Et, de fait, la situation de Charles VIII n'était guère brillante : il avait certes annexé la Guyenne (s'attirant davantage les foudres de l'Europe), mais ses provinces étaient ravagées et occupées par les troupes étrangères.
Le Duc jugea la situation en France à sa convenance, et fit parvenir sa déclaration de guerre à Paris. La Bavière lui emboîta le pas. En juillet 1488, les troupes brabançonnes déferlèrent sur l'Artois.
Charles VIII tenta d'obtenir uen victoire diplomatique, et y réussit : la Bretagne acceptait une succession française, cessa les hostilités, et le Duc de Bretagne prêta hommage au Roi de France.
La guerre n'était pas finie pour autant, Ibères et Bourbonnais tenant toujours les principales villes françaises. L'Ecosse entra elle aussi en guerre contre Charles VIII, suivie des Gênois et des Toscans. Les armées pontificales les réjoignirent. La Hollande suivit le mouvement.

L'automne 1489 fut décisif : alors que les troupes françaises mettaient le siège devant Bruxelles, les armées ducales enlevèrent enfin les places-fortes de l'Artois et marchèrent sur Paris. Leurs alliés bavarois combattaient vaillamment autour du Rhin et vinrent soutenir les troupes cantonnées en Ile-de-France. Les parisiens tentèrent plusieurs sorties et furent systématiquement massacrés. Bruxelles, de son côté, tenanit bon.
A l'hiver 1489, la Bavière considéra que la guerre avait assez duré, et obtint son retarit des hostilités en échange de deux provinces rhénanes : Clèves et le Palatinat. L'envol français vers l'Est était brisé.
Bruxelles tenait bon, et Paris tomba. L'orgueilleux Charles VIII rejeta les pourtant modérées prétentions du Duc (l'Artois en gage de paix). Le Duc vit virevolter son armée, qui hélas se fit pitoyablement écraser devant les murs de Bruxelles. Au moins, les Français décimés ne pouvaient plus soutenir le siège.
Finalement, Charles VIII vit la partie perdue : il offrit de lui-même l'Artois et une indemnité (bienvenue) de 100 écus. Encore une fois, le Duc signa rapidement une paix trop généreuse. L'Artois devint brabançon.

1490-1502 : la France amputée
Une cérémonie grandiose se déroula en la cathédrale d'Arras, le 1er juin 1490. Le Duc y était pour l'occasion promu officiellement Régent du Brabant.
Il ne lui fallut cependant pas longtemps pour mesurer l'étendue de la faute stratégique qu'il venait de commettre : l'Artois était certes brabançon, mais restait dans son coeur et dans son âme bien français. Cette province serait désormais le prétexte facile d'un futur Roi de France à une guerre qui risquait à tout moment d'emporter dans son flot sauvage les ambitions brabançonnes. Comme le rapportait un chroniqueur de l'époque :
Ce fut grand dommage que le très éclairé Régent ne s'en fusse pris au Luxembourg, qui point n'était françois et qui point ne pouvait susciter l'ire des Rois de Fance.
Le Régent ne pouvait se satisfaire de cette épée de Damoclès : il ne pouvait y avoir de repos en Brabant tant que la France serait puissante. Ses efforts seraient désormais tournés vers la guerre larvée. Un contemporain, en ce rude hiver 1490 qui voyait les vignes geler sur pied inventa le terme de "guerre froide".
La guerre, justement, qu'en était-il sur le sol français ? Charles VIII avait signé une paix humiliante, et qui avait coûté très cher en écus. Il y gagnait pourtant la Guyenne et l'alliance de la Bretagne, prompte aux volte-faces. Les années de guerre avaient apporté le trouble dans les provinces : la Savoie réclama son indépendance, et l'obtint. La guerre, sitôt éteinte, reprenait.
Le turbulent duc de Bourbon profita d'une situation confuse, et déclara la guerre à la Bretagne. A nouveau, les armées espagnoles et aragonaises déferleraient sur le sol français.
Pendant ce temps, en Brabant, la vie continuait à l'odinaire : emprunts à rembourser, révoltes à mater, offres de service d'un peintre déclinées faute d'argent. L'Autriche, à nouveau, s'engageait dans une guerre hongro-polonaise qui boutait le feu à tout l'Empire.
La France, derechef, pactisa à coups d'indemnités, et tenta de réorganiser ce qui pouvait l'être dans ces terres ravagées. Quelques années de paix contribueraient sans doute à restaurer le prestige des lys.
Mais la Bavière veillait : elle déclarait en août 1495 la guerre à la France. Il était décidément écrit que le règne de Charles VIII serait celui des guerres.
Le Régent du Brabant hésita quelques temps à respecter les termes de l'alliance bavaroise. Une nouvelle guerre ébranlerait le fragile édifice économique, sans cesse mis à bas et sans cesse reconstruit.
Le Régent finit par se jeter dans la guerre. Et les choses tournèrent mal. La France occupa l'Artois. Des armées furent recrutées à Bruxelles, mais ne parvinrent pas à déloger l'occupant. Les mois qui suivirent furent ceux des défaites. La France, sûre de son fait, et attachée à la reconquête de l'Artois, rejetait des propositions de paix aux indemnités pourtant de plus en plus importantes. Le Régent mena alors ses troupes ravager les terres françaises et obtint quelques victoires sans prestige sur des troupes mal préparées.
Une lueur d'espoir vint quand l'Italie s'embrasa, quand Gênes, Sienne, la Toscane entrèrent à leur tour dans le conflit. Mais l'expérience servait les armées françaises, et elle ne relâchaient guère leur pression sur l'Artois. Le Régent tenta une manoeuvre et lança toutes ses forces sur les armées assiégeantes. Les armées brabançonnes se firent défaire lamentablement devant Arras. Au moins, il ne faudrait plus payer les morts.
La solution du conflit ne pouvait venir que de la Bavière : celle-ci tenait les provinces françaises de l'Est et assiégeait Paris. Le Régent s'occupa des affaires courantes du Duché, laissant Arras brûler. Au pire, si les choses tournaient vraiment mal, il rétrocèderait l'Artois à la France.
Il ne dut pas passer par là. En septembre 1498, la Bavière signait une paix éclatante avec le nouveau roi, Louis XII : celui-ci abandonnait ses prétentions sur Cologne, la Lorraine et le Luxembourg. En dix ans, la France perdait ses conquêtes orientales.
Encore une fois, le Régent consacra ses efforts à la reconstruction du duché. Encore une fois, la partie semblait mal engagé pour ses principaux ennemis : la Souabe déclarait son indépendance vis-à-vis de l'Autriche. La Savoie en quittait l'alliance, pour se tourner vers Gênes et s'engagea à ses côtés dans la guerre en France.
L'Europe embrasée permettrait enfin aux marchands brabançons d'atteindre la domination du marché flamand. Hélas, le monopole rêvé était encore loin...
On fit une petite sauterie la même année au palais ducal de Bruxelles : la grosse Jacqueline célébrait ses 75 ans de règne, et tous désespéraient de voir un jour disparaître l'incompétente duchesse...
Les années passèrent dans la tranquilité. L'Autriche reconquérait la province de Bade et la Souabe prêta hommage à l'Empereur. Gênes enfin, en 1502, brisait les ambitions d'expansion française en obtenant en gage de paix le Milanais et l'Emilie.
1503-1535 : Quand un Roi perd la France
Les années de paix avaient rétabli la prospérité. La prospérité permettait désormais de penser à la guerre. Aux yeux du régent, la France avait certes plié, encore fallait-il qu'elle rompît. Pour ce faire, le Brabant avait besoin de nouveaux alliés. Quand la Hongrie attaqua la jeune Croatie devenue indépendante, son alliance se bisa. Le régent se hâta de récupérer à son profit l'amitié de la Bretagne et de la Savoie. Cette alliance entourait désormais la France comme un carcan. Il restait à attendre le moment favorable pour frapper...
De son côté, le Bourbonnais ne restait pas inactif et constituait une alliance avec l'Aragon, la navarre et les Etats du Pape. Un autre étau pressait les génitoires françaises.
Vers la même époque, le Maine, autrefois bourbonnais, devint breton. Le hasard des conflits et des soulèvements avait auparavant dévolu la province de l'Armor au Bourbonnais. Le Régent espérait secrètement que cette situation et cet entrecroisement des deux duchés ne seraient pas la source d'un conflit qui épuiserait les deux alliances antifrançaises.
En 1503, la situation était propice à un nouveau raid en France : le royaume se relevait à peine de perpétuelles années de guerre. Les troupes brabançonnes, à nouveau, assiégèrent Paris.
La même année, les tristes pressentiments du régent s'avérèrent : le Bourbonnais déclarait la guerre à la Bretagne. Deux alliances, dont les intérêts étaient pourtant les mêmes, s'affrontèrent en une lutte fratricide. Le régent, résigné, respecta l'Alliance. La Savoie n'eut pas cette délicatesse et préféra joindre son destin à celui de l'Ecosse et de l'Ulster ("Et pourquoi pas à celui des Iroquois ?" railla secrètement le Régent, pressentant dans une fulgurance géniale que, quelques dizaines d'années plus tard, la fortune des nations se déciderait dans ces lointaines et nouvelles contrées).
La France était ravagée de révoltes, ses armées se recrutaient avec peine. Paris tomba dans l'indifférence. Le Régent fit assaut de bravoure et conquit aisément la Champagne, tenue par quelques rebelles qui furent pendus au fronton de la cathédrale de Reims.
Le lion brabançon passa la frontière et assiégea le Nivernais, province bourbonnaise, qui finit par tomber. Le Régent passa la Noël de 1505 à nevers, fraîchement libérée.
Tout n'allait pas aussi bien dans le Nord, cependant : la Zélande se soulevait, l'Aragon assiégeait la Flandre. Le régent décida cependant de se concentrer sur la guerre en Bourbonnais. A moins, d'un soulèvement, la France ne pouvait guère lui poser de problèmes au nord de la Loire, et il espérait que les cités flamandes tiendraient devant la furie aragonaise et la racaille zélandaise.
La Bourgogne tomba à son tour. Le jour même, le Bourbonnais signait une paix de compromis avec la Bretagne. Les armées brabançonnes refluèrent vers le Nord pour soulager les villes zélandaises de leurs sièges.
La France refusait toujours la paix que le Régent proposait. Elle s'y résolut enfin et la Champagne devint province brabançonne en 1507. Dans l'intervalle, le duc de Bourbon, considérant enfin ses véritables intérêts, déclara la guerre à une France moribonde et en proie aux soulèvements rebelles.
Le Brabant comprenanit désormais la Zélande, la Flandre, l'Artois et la Champagne. La Bavière tenanit d'une main de fer les provinces outre-rhin de Lorraine et du Luxembourg, ainsi que Clèves, Cologne et le Palatinat. Le Bourbonnais était maître du Nivernais et de la Bourgogne. Au nord de la Loire, il ne restait à la France que la Picardie et l'Ile-de-France. Ses dernières provinces au sud étaient ravagées par les guerres de rebellion. Le constat n'était pas si mauvais..
La Provence déclara son indépendance, dans la région du Languedoc. L'Ecosse, désouevrée, déclara la guerre à la France, décidément conspuée dans le concert des nations. La Savoie rompit une nouvelle fois l'alliance, et une nouvelle fois, le Régent lui proposa son amitié. L'Ancienne Alliance était rconstituée.
Soulèvements badois, alsaciens, reconquêtes, guerre à l'Est... l'Autriche avait bien de l'ouvrage.
Mecklembourg, Brême, le Danemark se joignant à l'Ecosse ; l'Aragon et le Bourbonnais assiégeant ses villes ; les factions rebelles continuant leurs exactions... la France elle aussi avait de quoi s'occuper...
Pendant ce temps, à Bruxelles, on avait fêté le centenaire de Jacqueline de Bavière (toujours bon pied bon oeil malgré son grand âge), et on se résolvait à préparer les cérémonies du centenaire de son règne (le plus long de l'histoire européenne).
1510 fut une très bonne année : la Hollande secoua le joug de la Bavière et, avide de liberté, rejoignit le Duché de Brabant. De son côté, la France signait une paix blanche avec la Provence, reconnaissant ainsi son indépendance.

En 1511, banqueroute aidant, l'Angleterre éprouvait de plus en plus de difficulté à maintenir son joug sur ses possessions continentales : l'Orléanais y gagnait son indépendance. Le régent dépâcha au nouveau duc d'Orléans une ambassade chargée de transmettre une proposition d'alliance. Le duc d'Orléans refusa. On se passerait de lui.
La France eut davantage ses faveurs. Mais le traité d'alliance qu'elle signa incluait une déclaration de guerre à l'Angleterre. Louis XII, décidément, ne connaîtrait pas plus la paix que ne l'avait connue Charles VIII.
La fortune samblait bouder les ennemis du Brabant : Orélans accepta de devenir vassal de l'Angleterre, et rompit le traité d'alliance français avant même que l'encre eut le temps d'y sécher. L'Angleterre remporta une deuxième victoie diplomatique en vassalisant la Frise. Il faudrait un jour se méfier de cette île trop ambitieuse sur le continent...
Louis XII, usé par les guerres, s'éteignit, signant avant sa mort le traité de paix qui laissait au Danemark le contrôle du comté de Provence. La France n'avait plus d'accès à la Méditerranée.
François Ier cherchait la paix à tout prix : il paya une indemnité de guerre à Brême, renfloua les caisses du royaume d'Aragon, qui y gagna aussi la Guyenne.
La paix était signée avec quelques belliégrants, mais d'autres survenaient, rapaces cherchant à dépecer une proie facile. Le Régent, occupé aux affaires bourguignonnes eut presque pitié.
Le Bourbonnais quittait l'arène avec les honneurs, et la guerre enrichi du Dauphiné, du Limousin et des Cévennes. Le jour même, la Provence, suivie du Danemark, déclarait à nouveau la guerre à la France. La malédiction de Mars ne semblait pas vouloir quitter les terres françaises...
En 1519, enfin, François Ier eut quelque répit : une paix blanche mettait fin à la guerre contre Orléans et la Provence, qui devenait vassale du Danemark. Ce fut la première trace de l'influence des gros rustauds nordiques sur la Côte-d'Azur.
La tranquillité béate du duché brabançon fut rompue en 1526 quand deux nouvelles coup sur coup parvinrent à Bruxelles : l'Autriche héritait de la Bohême, accroissant son empire de façon drastique ; la Provence déclanchait les hostilités contre la France. La paix de François Ier aura duré cinq ans.
L'année suivante, la Bavière elle aussi s'emporta contre le Royaume des Lys et déclara la guerre. Le Régent suivit. A nouveau, on vit espagnols, portugais, écossais, provençaux, bavarois, brabançons, bretons, savoyards se jeter sur les terres françaises. Le duc d'Orléans ne voulut pas être en reste.
La Bavière avait-elle préjugé de l'inertie autrichienne ? Peut-être : l'Autriche, bien qu'engagée dans la croisade contre les ottomans, lui déclara la guerre. Le régent s'accorda trois mois de réflexion, puis, voyant que les armées autrichiennes ne semblaient guère se précipiter vers l'ouest, etq ue le siège de Paris était bien entamé, accepta d'honorer son alliance.
Le coup de sang de l'Autriche avait dissous son alliance : seule la lointaine Lithuanie lui demeurait fidèle. Le Régent choisit donc de ne pas choisir et guiderait ses armées ou bon lui semblerait : le sort de l'Autriche (comme celui de la Bavière) lui était indifférent, du moment que nulle troupe ne revageât les possessions brabançonnes.
Paris tomba. La France signa des deux mains une paix généreuse qui n'exigeait que quelques centaines d'écus. Le Régent tourna ses regards à l'Est et vit que les forces bavaroises et autrichiennes s'annihilaient mutuellement. Il vit que cela était mal et se décida à y mettre un peu d'ordre.
Les trois mois de l'automne 1528 suffirent à capturer l'Alsace. Bade était la prochaine étape. Le projet du Régent se dessinait peu à peu : conquérir Bade et l'Alsace et les délivrer du joug autrichien en leur rendant leur indépendance, en en faisant des vassaux du Brabant. Pour cela, il faudrait pousser vers Vienne.
Les états financiers ne permettaient pas de folie, mais autorisaient le recrutement d'armées supplémentaires. Que l'inflation soit de 30% ou de 35%, quelle différence ? on la laissa filer.
Bade tomba en janvier 1529. La route de Vienne était ouverte. Un an plus tard, le canton de Schwyz tombait aux mains des brabançons. Les armées étaient désormais plus proche de la capitale de l'Autriche que de celle du Brabant.
Dans l'intervalle, l'Espgane se retirait du conflit français en y gagnant la Gascogne. La France se réduisait à peau de chagrin.
Les armées du régent s'étaient divisées, assiégant à la fois Vienne et la Franche-Comté. Le grand projet du sage régent allait-il se réaliser ?
Non.
La Bavière, malmenée par la guerre, signa la paix avec l'Autriche et paya moins de trente écus d'indemnités. Le Brabant n'y gagnait rien. Le régent retourna tête basse à Bruxelles.
Il apprit sur le chemin du retour que le fougueux duc de Bourbon avait une fois de plus déclaré la guerre à la Bretagne. Le régent revint sur ses pas et assiégea le Nivernais. Des troupes fraîches furent recutées, qui assiégèrent la Gueldre aragonnaise. D'autres furent envoyées faire le siègde Tours.
Le duc de Bourbon avait oublié sa situation financière précaire : il dut déclarer banqueroute. La campagne devenait une partie de plaisir.
Nevers tomba, mais une fois de plus, le Régent fut dupé : la Bretagne argûa des conquêtes brabançonnes pour demander une indemnité de 250 écus, que le duc de Bourbon eut peine à rassembler.
A nouveau, le Régent rentrait à Bruxelles auréolé de la gloire du vainqueur, mais dépossédé de tout gain diplomatique. On disait de lui dans la capitale "qu'il avait travaillé pour le duc de Bretagne". L'expression demeura.
Et en France, comment se passaient les choses ? Mal.
La Povence finissait la guerre en héritant du Lyonnais.
Le duc de Bourbon, à peine dégagé d'une guerre, suivait l'Aragaon dans celle qui venait d'être (à nouveau) déclarée à la France.
Le régent suivait les événements de loin.
On fêta les 110 ans de l'accession au trône de Jacqueline de Bavière. La mâtine portait vaillamment ses 135 ans bien comptés.
Enfin, épuisée, la France cédait de bon coeur l'Auvergne au Bourbonnais.
En mai 1535, il ne demeurait de la France que la Picardie et l'Ile-de-France...

1535-1542 Les jolies colonies de Brabant, merci Régent, merci Régent
40 plus tôt, à la fin du règne de Louis XI, la France s'étendait jusqu'au Rhin et dépassait le Pô... Elle semblait destinée à s'étendre et annexer les grands ducs vassaux. La situation avait bien changé en quatre décennies. François Ier ne pouvait que constater le désastre.
De son côté, le Régent comprit que désormais, la France était une proie facile. La guerre, qu'il avait si longtemps craiente, de peur de voir l'édifice patiemment construit s'écrouler comme un tas de paille, il la projetait à présent. La prochaine cible était désignée, elle demeurait la même : la France, maintenant réduite à une portion congrue.
L'Autriche, certes, grandissait en puissance. La Bavière, certes, devanait dangereuse. L'Angleterre, évidemment, et malgré le fait que Caux ait préféré rejoindre les territoires du duc d'Orléans, restait un souci. Mais il ne fallait pas laisser à la France la possibilité de se reconstruire.
Pour l'instant, en tous cas, il fallait mater l'indiscipliné duc de Bourbon, qui en cette année 1537, à nouveau, déclarait la guerre à la Bretagne.
Les objectifs demeuraient inchangés : la conquête de la Gueldre aragonnaise, et du Nivernais bourbonnais. Les armées bavaroises ayant pris le régent de vitesse, celui-ci se décida, à nouveau, à entreprendre le siège de Tours. Mais, bien protégé par un détachement du Duc de Bourbon, les armées brabançonnes se débandèrent. L'affaire bourbonnaise semblait mal engagée, et le régent concentra ses efforts sur la Gueldre.
L'année 1540 vit la reddition de la Gueldre. Elle vit aussi l'annexion de la Hongrie par l'Autriche, qui devenait décidément de plus en plus puissante.
Hélas, la paix se fit à nouveau contre les attentes du Régent. La Bavière y gagnait le Nivernais. Qui aurait pu imaginer un siècle plus tôt des bavarois construire des forteresses sur la Loire ?
Découragé, le régent eut cependant quelques motifs d'intérêt et d'espoir. Un secrétaire lui mit sous les yeux des cartes étranges, confisquées aux archives royales, quelques années plus tôt, lors du siège de Paris. On y voyait dessinées les côtes de ce nouveau continent dont tous parlaient et que tous les pays (l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal) semblaient connaître. Le nord de ce continent semblait déjà bien occupé par les Anglais. Des petits blasons rouge et blanc semblaient indiquer que vers le sud, de larges îles étaient possessions espagnoles. néanmoins, quelques territoires semblaient libres de toute influence et accessibles : le Régent pointa du doigt deux groupes d'îles : celles nommées "Isle Royale" (qu'on rebaptiserait par la suite "Isle Regentale") et celles nommées "Bermudes" (le Régent eut l'idée d'y installer une manufacture de tissu afin d'y produire de courtes et larges chaussesà porter pour la saison d'été mais le projet n'aboutit pas). Des colons furent dépêchés afin de revendiquer ces territoires comme terres brabançonnes.
1542-1549 L'adieu aux Lys
Mais les dés roulaient à nouveau entre Somme et Seine. Le 25 août 1542 (le jour de l'anniversaire du régent!), la Bavière déclara la guerre à la France. Bien décidé à n'être pas une cinquième fois dupé, le régent se précipita sous les murs de Paris. Il laissait la Picardie à qui en voulait.
La Bretagne en voulait. Una n plus tard, Paris tombée, la Somme conquise, la Picardie devenait bretonne. De la France ne demeurait que Paris. Une trêve durait cinq ans... le vicomte se mit à cocher les jours sur son calendrier...
L'Autriche croissait et s'agrandissait de la Ruthénie et de la Transylvanie. Le danger augmentait à l'est...
En 1547, Henri II, le dernier roi de Fance, montatit sur le trône. Il convia le régent à la cérémonie du sacre. Celui-ci lui répondit qu'une vilaine maladie le clouait au lit jusqu'au 30 juin 1548, mais que le mois de juillet de la même année le verrait à Paris. L'Histoire lui donnera raison.
Le 30 juin 1548, en effet, un héraut brabançon porta la déclaration de guerre du Régent à Henri le Dernier.
Paris fut assiégée. Dix mois plus tard, Paris tomba.
Henri Dernier ratifia la paix : les dernières possessions françaises, à savoir l'Ile-de-France, devenaient bourguignonnes. Lui-même se retira dans un monastère, où il devait finir de façon horrible, un commis aux écritures lui ayant fiché une plume dans l'oeil.
La France n'existait plus.
Le Brabant s'agrandissait d'une riche province, et par la même occasion prenanit le contrôle d'un autre centre de commerce.

Pour l'anecdote, on signala au régent qu'une flotte française, victime d'exhaustion, evenait d'Amérique vers un port de Zélande. Le Régent admira la vaillance des marins français, privés de port depuis trente ans, et dont les bateaux, ballotés en pleine mer, ne coulaient pas.
Malédiction ou sabotage ? lesdits navires anciennement français ne purent atteindre un port et disparurent bien avant d'atteindre la Zélande...
:(
Le duché sortait agrandi de l'épreuve autrichienne. Pendant que la grosse Jacqueline s'épuisait en fêtes ruineuses et insensées, le bon Duc se trouvait face à une épineuse situation : comment parvenir à redresser l'économie moribonde du duché ? Une autre menace survolait de son aile ténébreuse les riantes terres flamandes : la soif de conquête des grandes nations ne pouvait ignorer très longtemps les joyeuses citées branbançonnes, terres de libertés narguant les orgueils impérialistes. L'Autriche mise à genoux, la France se dressait toujours plus grande, son talon de fer menaçant toujours davantage les terres du Nord.
Le Duc occupa les années de paix à restaurer la puissance commerciale du duché. L'inflation grevait lourdement les investissements, et les fonds de la trésorerie parvenaient à peine à financer le placement de marchands. Perdu pour perdu, le Duc laissa (intelligement) filer l'inflation, qui augmenta rapidement, et concentra ses efforts sur la conquête du marché flamand. Son idée principale était toujours liée à celle d'un monopole sur le centre de commerce anversois.
Hélas, les investissements en tous genre, qui se faisaient rapidement aux heures de gloire du début du siècle, étaient désormais ralentis par l'inflation et l'incompétence de la grosse duchesse. Les armées et la marine stagnaient dans leur équipements médiévaux. L'infrastructure progressait à peine, et l'argent manquait pour promouvoir les baillis. Les efforts se focalisaient de toutes façons sur le développement commercial : les bourgeois brugeois firent don de 5 galères à la duchesse. Le Duc les fit couler dans l'heure, estimant que les frais d'entretien de navires inacapables d'affronter l'océan étaient superflus.
Le duché remontait doucement la pente, à la suite de l'inflation qui elle aussi grimpait très rapidement.
L'heure viendrait un jour de mettre au pas de trop puissants voisins.
L'Autriche, engagée dans une guerre contre la Hongrie, la Pologne et la Bohême voyait ses marches de l'Est ravagées. Ses conquêtes occidentales se soulevaient régulièrement, détournant pour le moment l'Empereur d'une revanche brabançonne.
En 1486 eut lieu "l'Affaire de Bretagne" : l'Armor se souleva contre la domination française et rejoignit la Bretagne. Le roi de France coupa court à toute tentative diplomatique et déclara la guerre aux Bretons.
Mal lui en pris.
La France était en effet isolée dans le jeu européen ; ses conquêtes rapides l'avaient fait haïr de bien des nations. Elle dut affronter une alliance solide, composée de l'Espagne, de la Guyenne, du Portugal, du Bourbonnais de Brême et de l'Aragon.
L'occasion s'offrait de rogner les pétales du lys français.
Le Duc s'oocupa de recuter des troupes vaillantes, et attendit que la guerre eût suffisament épuisé l'arrogance française. Et, de fait, la situation de Charles VIII n'était guère brillante : il avait certes annexé la Guyenne (s'attirant davantage les foudres de l'Europe), mais ses provinces étaient ravagées et occupées par les troupes étrangères.
Le Duc jugea la situation en France à sa convenance, et fit parvenir sa déclaration de guerre à Paris. La Bavière lui emboîta le pas. En juillet 1488, les troupes brabançonnes déferlèrent sur l'Artois.
Charles VIII tenta d'obtenir uen victoire diplomatique, et y réussit : la Bretagne acceptait une succession française, cessa les hostilités, et le Duc de Bretagne prêta hommage au Roi de France.
La guerre n'était pas finie pour autant, Ibères et Bourbonnais tenant toujours les principales villes françaises. L'Ecosse entra elle aussi en guerre contre Charles VIII, suivie des Gênois et des Toscans. Les armées pontificales les réjoignirent. La Hollande suivit le mouvement.

L'automne 1489 fut décisif : alors que les troupes françaises mettaient le siège devant Bruxelles, les armées ducales enlevèrent enfin les places-fortes de l'Artois et marchèrent sur Paris. Leurs alliés bavarois combattaient vaillamment autour du Rhin et vinrent soutenir les troupes cantonnées en Ile-de-France. Les parisiens tentèrent plusieurs sorties et furent systématiquement massacrés. Bruxelles, de son côté, tenanit bon.
A l'hiver 1489, la Bavière considéra que la guerre avait assez duré, et obtint son retarit des hostilités en échange de deux provinces rhénanes : Clèves et le Palatinat. L'envol français vers l'Est était brisé.
Bruxelles tenait bon, et Paris tomba. L'orgueilleux Charles VIII rejeta les pourtant modérées prétentions du Duc (l'Artois en gage de paix). Le Duc vit virevolter son armée, qui hélas se fit pitoyablement écraser devant les murs de Bruxelles. Au moins, les Français décimés ne pouvaient plus soutenir le siège.
Finalement, Charles VIII vit la partie perdue : il offrit de lui-même l'Artois et une indemnité (bienvenue) de 100 écus. Encore une fois, le Duc signa rapidement une paix trop généreuse. L'Artois devint brabançon.

1490-1502 : la France amputée
Une cérémonie grandiose se déroula en la cathédrale d'Arras, le 1er juin 1490. Le Duc y était pour l'occasion promu officiellement Régent du Brabant.
Il ne lui fallut cependant pas longtemps pour mesurer l'étendue de la faute stratégique qu'il venait de commettre : l'Artois était certes brabançon, mais restait dans son coeur et dans son âme bien français. Cette province serait désormais le prétexte facile d'un futur Roi de France à une guerre qui risquait à tout moment d'emporter dans son flot sauvage les ambitions brabançonnes. Comme le rapportait un chroniqueur de l'époque :
Ce fut grand dommage que le très éclairé Régent ne s'en fusse pris au Luxembourg, qui point n'était françois et qui point ne pouvait susciter l'ire des Rois de Fance.
Le Régent ne pouvait se satisfaire de cette épée de Damoclès : il ne pouvait y avoir de repos en Brabant tant que la France serait puissante. Ses efforts seraient désormais tournés vers la guerre larvée. Un contemporain, en ce rude hiver 1490 qui voyait les vignes geler sur pied inventa le terme de "guerre froide".
La guerre, justement, qu'en était-il sur le sol français ? Charles VIII avait signé une paix humiliante, et qui avait coûté très cher en écus. Il y gagnait pourtant la Guyenne et l'alliance de la Bretagne, prompte aux volte-faces. Les années de guerre avaient apporté le trouble dans les provinces : la Savoie réclama son indépendance, et l'obtint. La guerre, sitôt éteinte, reprenait.
Le turbulent duc de Bourbon profita d'une situation confuse, et déclara la guerre à la Bretagne. A nouveau, les armées espagnoles et aragonaises déferleraient sur le sol français.
Pendant ce temps, en Brabant, la vie continuait à l'odinaire : emprunts à rembourser, révoltes à mater, offres de service d'un peintre déclinées faute d'argent. L'Autriche, à nouveau, s'engageait dans une guerre hongro-polonaise qui boutait le feu à tout l'Empire.
La France, derechef, pactisa à coups d'indemnités, et tenta de réorganiser ce qui pouvait l'être dans ces terres ravagées. Quelques années de paix contribueraient sans doute à restaurer le prestige des lys.
Mais la Bavière veillait : elle déclarait en août 1495 la guerre à la France. Il était décidément écrit que le règne de Charles VIII serait celui des guerres.
Le Régent du Brabant hésita quelques temps à respecter les termes de l'alliance bavaroise. Une nouvelle guerre ébranlerait le fragile édifice économique, sans cesse mis à bas et sans cesse reconstruit.
Le Régent finit par se jeter dans la guerre. Et les choses tournèrent mal. La France occupa l'Artois. Des armées furent recrutées à Bruxelles, mais ne parvinrent pas à déloger l'occupant. Les mois qui suivirent furent ceux des défaites. La France, sûre de son fait, et attachée à la reconquête de l'Artois, rejetait des propositions de paix aux indemnités pourtant de plus en plus importantes. Le Régent mena alors ses troupes ravager les terres françaises et obtint quelques victoires sans prestige sur des troupes mal préparées.
Une lueur d'espoir vint quand l'Italie s'embrasa, quand Gênes, Sienne, la Toscane entrèrent à leur tour dans le conflit. Mais l'expérience servait les armées françaises, et elle ne relâchaient guère leur pression sur l'Artois. Le Régent tenta une manoeuvre et lança toutes ses forces sur les armées assiégeantes. Les armées brabançonnes se firent défaire lamentablement devant Arras. Au moins, il ne faudrait plus payer les morts.
La solution du conflit ne pouvait venir que de la Bavière : celle-ci tenait les provinces françaises de l'Est et assiégeait Paris. Le Régent s'occupa des affaires courantes du Duché, laissant Arras brûler. Au pire, si les choses tournaient vraiment mal, il rétrocèderait l'Artois à la France.
Il ne dut pas passer par là. En septembre 1498, la Bavière signait une paix éclatante avec le nouveau roi, Louis XII : celui-ci abandonnait ses prétentions sur Cologne, la Lorraine et le Luxembourg. En dix ans, la France perdait ses conquêtes orientales.
Encore une fois, le Régent consacra ses efforts à la reconstruction du duché. Encore une fois, la partie semblait mal engagé pour ses principaux ennemis : la Souabe déclarait son indépendance vis-à-vis de l'Autriche. La Savoie en quittait l'alliance, pour se tourner vers Gênes et s'engagea à ses côtés dans la guerre en France.
L'Europe embrasée permettrait enfin aux marchands brabançons d'atteindre la domination du marché flamand. Hélas, le monopole rêvé était encore loin...
On fit une petite sauterie la même année au palais ducal de Bruxelles : la grosse Jacqueline célébrait ses 75 ans de règne, et tous désespéraient de voir un jour disparaître l'incompétente duchesse...
Les années passèrent dans la tranquilité. L'Autriche reconquérait la province de Bade et la Souabe prêta hommage à l'Empereur. Gênes enfin, en 1502, brisait les ambitions d'expansion française en obtenant en gage de paix le Milanais et l'Emilie.
1503-1535 : Quand un Roi perd la France
Les années de paix avaient rétabli la prospérité. La prospérité permettait désormais de penser à la guerre. Aux yeux du régent, la France avait certes plié, encore fallait-il qu'elle rompît. Pour ce faire, le Brabant avait besoin de nouveaux alliés. Quand la Hongrie attaqua la jeune Croatie devenue indépendante, son alliance se bisa. Le régent se hâta de récupérer à son profit l'amitié de la Bretagne et de la Savoie. Cette alliance entourait désormais la France comme un carcan. Il restait à attendre le moment favorable pour frapper...
De son côté, le Bourbonnais ne restait pas inactif et constituait une alliance avec l'Aragon, la navarre et les Etats du Pape. Un autre étau pressait les génitoires françaises.
Vers la même époque, le Maine, autrefois bourbonnais, devint breton. Le hasard des conflits et des soulèvements avait auparavant dévolu la province de l'Armor au Bourbonnais. Le Régent espérait secrètement que cette situation et cet entrecroisement des deux duchés ne seraient pas la source d'un conflit qui épuiserait les deux alliances antifrançaises.
En 1503, la situation était propice à un nouveau raid en France : le royaume se relevait à peine de perpétuelles années de guerre. Les troupes brabançonnes, à nouveau, assiégèrent Paris.
La même année, les tristes pressentiments du régent s'avérèrent : le Bourbonnais déclarait la guerre à la Bretagne. Deux alliances, dont les intérêts étaient pourtant les mêmes, s'affrontèrent en une lutte fratricide. Le régent, résigné, respecta l'Alliance. La Savoie n'eut pas cette délicatesse et préféra joindre son destin à celui de l'Ecosse et de l'Ulster ("Et pourquoi pas à celui des Iroquois ?" railla secrètement le Régent, pressentant dans une fulgurance géniale que, quelques dizaines d'années plus tard, la fortune des nations se déciderait dans ces lointaines et nouvelles contrées).
La France était ravagée de révoltes, ses armées se recrutaient avec peine. Paris tomba dans l'indifférence. Le Régent fit assaut de bravoure et conquit aisément la Champagne, tenue par quelques rebelles qui furent pendus au fronton de la cathédrale de Reims.
Le lion brabançon passa la frontière et assiégea le Nivernais, province bourbonnaise, qui finit par tomber. Le Régent passa la Noël de 1505 à nevers, fraîchement libérée.
Tout n'allait pas aussi bien dans le Nord, cependant : la Zélande se soulevait, l'Aragon assiégeait la Flandre. Le régent décida cependant de se concentrer sur la guerre en Bourbonnais. A moins, d'un soulèvement, la France ne pouvait guère lui poser de problèmes au nord de la Loire, et il espérait que les cités flamandes tiendraient devant la furie aragonaise et la racaille zélandaise.
La Bourgogne tomba à son tour. Le jour même, le Bourbonnais signait une paix de compromis avec la Bretagne. Les armées brabançonnes refluèrent vers le Nord pour soulager les villes zélandaises de leurs sièges.
La France refusait toujours la paix que le Régent proposait. Elle s'y résolut enfin et la Champagne devint province brabançonne en 1507. Dans l'intervalle, le duc de Bourbon, considérant enfin ses véritables intérêts, déclara la guerre à une France moribonde et en proie aux soulèvements rebelles.
Le Brabant comprenanit désormais la Zélande, la Flandre, l'Artois et la Champagne. La Bavière tenanit d'une main de fer les provinces outre-rhin de Lorraine et du Luxembourg, ainsi que Clèves, Cologne et le Palatinat. Le Bourbonnais était maître du Nivernais et de la Bourgogne. Au nord de la Loire, il ne restait à la France que la Picardie et l'Ile-de-France. Ses dernières provinces au sud étaient ravagées par les guerres de rebellion. Le constat n'était pas si mauvais..
La Provence déclara son indépendance, dans la région du Languedoc. L'Ecosse, désouevrée, déclara la guerre à la France, décidément conspuée dans le concert des nations. La Savoie rompit une nouvelle fois l'alliance, et une nouvelle fois, le Régent lui proposa son amitié. L'Ancienne Alliance était rconstituée.
Soulèvements badois, alsaciens, reconquêtes, guerre à l'Est... l'Autriche avait bien de l'ouvrage.
Mecklembourg, Brême, le Danemark se joignant à l'Ecosse ; l'Aragon et le Bourbonnais assiégeant ses villes ; les factions rebelles continuant leurs exactions... la France elle aussi avait de quoi s'occuper...
Pendant ce temps, à Bruxelles, on avait fêté le centenaire de Jacqueline de Bavière (toujours bon pied bon oeil malgré son grand âge), et on se résolvait à préparer les cérémonies du centenaire de son règne (le plus long de l'histoire européenne).
1510 fut une très bonne année : la Hollande secoua le joug de la Bavière et, avide de liberté, rejoignit le Duché de Brabant. De son côté, la France signait une paix blanche avec la Provence, reconnaissant ainsi son indépendance.

En 1511, banqueroute aidant, l'Angleterre éprouvait de plus en plus de difficulté à maintenir son joug sur ses possessions continentales : l'Orléanais y gagnait son indépendance. Le régent dépâcha au nouveau duc d'Orléans une ambassade chargée de transmettre une proposition d'alliance. Le duc d'Orléans refusa. On se passerait de lui.
La France eut davantage ses faveurs. Mais le traité d'alliance qu'elle signa incluait une déclaration de guerre à l'Angleterre. Louis XII, décidément, ne connaîtrait pas plus la paix que ne l'avait connue Charles VIII.
La fortune samblait bouder les ennemis du Brabant : Orélans accepta de devenir vassal de l'Angleterre, et rompit le traité d'alliance français avant même que l'encre eut le temps d'y sécher. L'Angleterre remporta une deuxième victoie diplomatique en vassalisant la Frise. Il faudrait un jour se méfier de cette île trop ambitieuse sur le continent...
Louis XII, usé par les guerres, s'éteignit, signant avant sa mort le traité de paix qui laissait au Danemark le contrôle du comté de Provence. La France n'avait plus d'accès à la Méditerranée.
François Ier cherchait la paix à tout prix : il paya une indemnité de guerre à Brême, renfloua les caisses du royaume d'Aragon, qui y gagna aussi la Guyenne.
La paix était signée avec quelques belliégrants, mais d'autres survenaient, rapaces cherchant à dépecer une proie facile. Le Régent, occupé aux affaires bourguignonnes eut presque pitié.
Le Bourbonnais quittait l'arène avec les honneurs, et la guerre enrichi du Dauphiné, du Limousin et des Cévennes. Le jour même, la Provence, suivie du Danemark, déclarait à nouveau la guerre à la France. La malédiction de Mars ne semblait pas vouloir quitter les terres françaises...
En 1519, enfin, François Ier eut quelque répit : une paix blanche mettait fin à la guerre contre Orléans et la Provence, qui devenait vassale du Danemark. Ce fut la première trace de l'influence des gros rustauds nordiques sur la Côte-d'Azur.
La tranquillité béate du duché brabançon fut rompue en 1526 quand deux nouvelles coup sur coup parvinrent à Bruxelles : l'Autriche héritait de la Bohême, accroissant son empire de façon drastique ; la Provence déclanchait les hostilités contre la France. La paix de François Ier aura duré cinq ans.
L'année suivante, la Bavière elle aussi s'emporta contre le Royaume des Lys et déclara la guerre. Le Régent suivit. A nouveau, on vit espagnols, portugais, écossais, provençaux, bavarois, brabançons, bretons, savoyards se jeter sur les terres françaises. Le duc d'Orléans ne voulut pas être en reste.
La Bavière avait-elle préjugé de l'inertie autrichienne ? Peut-être : l'Autriche, bien qu'engagée dans la croisade contre les ottomans, lui déclara la guerre. Le régent s'accorda trois mois de réflexion, puis, voyant que les armées autrichiennes ne semblaient guère se précipiter vers l'ouest, etq ue le siège de Paris était bien entamé, accepta d'honorer son alliance.
Le coup de sang de l'Autriche avait dissous son alliance : seule la lointaine Lithuanie lui demeurait fidèle. Le Régent choisit donc de ne pas choisir et guiderait ses armées ou bon lui semblerait : le sort de l'Autriche (comme celui de la Bavière) lui était indifférent, du moment que nulle troupe ne revageât les possessions brabançonnes.
Paris tomba. La France signa des deux mains une paix généreuse qui n'exigeait que quelques centaines d'écus. Le Régent tourna ses regards à l'Est et vit que les forces bavaroises et autrichiennes s'annihilaient mutuellement. Il vit que cela était mal et se décida à y mettre un peu d'ordre.
Les trois mois de l'automne 1528 suffirent à capturer l'Alsace. Bade était la prochaine étape. Le projet du Régent se dessinait peu à peu : conquérir Bade et l'Alsace et les délivrer du joug autrichien en leur rendant leur indépendance, en en faisant des vassaux du Brabant. Pour cela, il faudrait pousser vers Vienne.
Les états financiers ne permettaient pas de folie, mais autorisaient le recrutement d'armées supplémentaires. Que l'inflation soit de 30% ou de 35%, quelle différence ? on la laissa filer.
Bade tomba en janvier 1529. La route de Vienne était ouverte. Un an plus tard, le canton de Schwyz tombait aux mains des brabançons. Les armées étaient désormais plus proche de la capitale de l'Autriche que de celle du Brabant.
Dans l'intervalle, l'Espgane se retirait du conflit français en y gagnant la Gascogne. La France se réduisait à peau de chagrin.
Les armées du régent s'étaient divisées, assiégant à la fois Vienne et la Franche-Comté. Le grand projet du sage régent allait-il se réaliser ?
Non.
La Bavière, malmenée par la guerre, signa la paix avec l'Autriche et paya moins de trente écus d'indemnités. Le Brabant n'y gagnait rien. Le régent retourna tête basse à Bruxelles.
Il apprit sur le chemin du retour que le fougueux duc de Bourbon avait une fois de plus déclaré la guerre à la Bretagne. Le régent revint sur ses pas et assiégea le Nivernais. Des troupes fraîches furent recutées, qui assiégèrent la Gueldre aragonnaise. D'autres furent envoyées faire le siègde Tours.
Le duc de Bourbon avait oublié sa situation financière précaire : il dut déclarer banqueroute. La campagne devenait une partie de plaisir.
Nevers tomba, mais une fois de plus, le Régent fut dupé : la Bretagne argûa des conquêtes brabançonnes pour demander une indemnité de 250 écus, que le duc de Bourbon eut peine à rassembler.
A nouveau, le Régent rentrait à Bruxelles auréolé de la gloire du vainqueur, mais dépossédé de tout gain diplomatique. On disait de lui dans la capitale "qu'il avait travaillé pour le duc de Bretagne". L'expression demeura.
Et en France, comment se passaient les choses ? Mal.
La Povence finissait la guerre en héritant du Lyonnais.
Le duc de Bourbon, à peine dégagé d'une guerre, suivait l'Aragaon dans celle qui venait d'être (à nouveau) déclarée à la France.
Le régent suivait les événements de loin.
On fêta les 110 ans de l'accession au trône de Jacqueline de Bavière. La mâtine portait vaillamment ses 135 ans bien comptés.
Enfin, épuisée, la France cédait de bon coeur l'Auvergne au Bourbonnais.
En mai 1535, il ne demeurait de la France que la Picardie et l'Ile-de-France...

1535-1542 Les jolies colonies de Brabant, merci Régent, merci Régent
40 plus tôt, à la fin du règne de Louis XI, la France s'étendait jusqu'au Rhin et dépassait le Pô... Elle semblait destinée à s'étendre et annexer les grands ducs vassaux. La situation avait bien changé en quatre décennies. François Ier ne pouvait que constater le désastre.
De son côté, le Régent comprit que désormais, la France était une proie facile. La guerre, qu'il avait si longtemps craiente, de peur de voir l'édifice patiemment construit s'écrouler comme un tas de paille, il la projetait à présent. La prochaine cible était désignée, elle demeurait la même : la France, maintenant réduite à une portion congrue.
L'Autriche, certes, grandissait en puissance. La Bavière, certes, devanait dangereuse. L'Angleterre, évidemment, et malgré le fait que Caux ait préféré rejoindre les territoires du duc d'Orléans, restait un souci. Mais il ne fallait pas laisser à la France la possibilité de se reconstruire.
Pour l'instant, en tous cas, il fallait mater l'indiscipliné duc de Bourbon, qui en cette année 1537, à nouveau, déclarait la guerre à la Bretagne.
Les objectifs demeuraient inchangés : la conquête de la Gueldre aragonnaise, et du Nivernais bourbonnais. Les armées bavaroises ayant pris le régent de vitesse, celui-ci se décida, à nouveau, à entreprendre le siège de Tours. Mais, bien protégé par un détachement du Duc de Bourbon, les armées brabançonnes se débandèrent. L'affaire bourbonnaise semblait mal engagée, et le régent concentra ses efforts sur la Gueldre.
L'année 1540 vit la reddition de la Gueldre. Elle vit aussi l'annexion de la Hongrie par l'Autriche, qui devenait décidément de plus en plus puissante.
Hélas, la paix se fit à nouveau contre les attentes du Régent. La Bavière y gagnait le Nivernais. Qui aurait pu imaginer un siècle plus tôt des bavarois construire des forteresses sur la Loire ?
Découragé, le régent eut cependant quelques motifs d'intérêt et d'espoir. Un secrétaire lui mit sous les yeux des cartes étranges, confisquées aux archives royales, quelques années plus tôt, lors du siège de Paris. On y voyait dessinées les côtes de ce nouveau continent dont tous parlaient et que tous les pays (l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal) semblaient connaître. Le nord de ce continent semblait déjà bien occupé par les Anglais. Des petits blasons rouge et blanc semblaient indiquer que vers le sud, de larges îles étaient possessions espagnoles. néanmoins, quelques territoires semblaient libres de toute influence et accessibles : le Régent pointa du doigt deux groupes d'îles : celles nommées "Isle Royale" (qu'on rebaptiserait par la suite "Isle Regentale") et celles nommées "Bermudes" (le Régent eut l'idée d'y installer une manufacture de tissu afin d'y produire de courtes et larges chaussesà porter pour la saison d'été mais le projet n'aboutit pas). Des colons furent dépêchés afin de revendiquer ces territoires comme terres brabançonnes.
1542-1549 L'adieu aux Lys
Mais les dés roulaient à nouveau entre Somme et Seine. Le 25 août 1542 (le jour de l'anniversaire du régent!), la Bavière déclara la guerre à la France. Bien décidé à n'être pas une cinquième fois dupé, le régent se précipita sous les murs de Paris. Il laissait la Picardie à qui en voulait.
La Bretagne en voulait. Una n plus tard, Paris tombée, la Somme conquise, la Picardie devenait bretonne. De la France ne demeurait que Paris. Une trêve durait cinq ans... le vicomte se mit à cocher les jours sur son calendrier...
L'Autriche croissait et s'agrandissait de la Ruthénie et de la Transylvanie. Le danger augmentait à l'est...
En 1547, Henri II, le dernier roi de Fance, montatit sur le trône. Il convia le régent à la cérémonie du sacre. Celui-ci lui répondit qu'une vilaine maladie le clouait au lit jusqu'au 30 juin 1548, mais que le mois de juillet de la même année le verrait à Paris. L'Histoire lui donnera raison.
Le 30 juin 1548, en effet, un héraut brabançon porta la déclaration de guerre du Régent à Henri le Dernier.
Paris fut assiégée. Dix mois plus tard, Paris tomba.
Henri Dernier ratifia la paix : les dernières possessions françaises, à savoir l'Ile-de-France, devenaient bourguignonnes. Lui-même se retira dans un monastère, où il devait finir de façon horrible, un commis aux écritures lui ayant fiché une plume dans l'oeil.
La France n'existait plus.
Le Brabant s'agrandissait d'une riche province, et par la même occasion prenanit le contrôle d'un autre centre de commerce.

Pour l'anecdote, on signala au régent qu'une flotte française, victime d'exhaustion, evenait d'Amérique vers un port de Zélande. Le Régent admira la vaillance des marins français, privés de port depuis trente ans, et dont les bateaux, ballotés en pleine mer, ne coulaient pas.
Malédiction ou sabotage ? lesdits navires anciennement français ne purent atteindre un port et disparurent bien avant d'atteindre la Zélande...
:(
Modifié en dernier par T le Taudis le jeu. déc. 09, 2004 5:44 pm, modifié 5 fois.
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
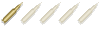
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
La grosse Jacqueline va pulvériser les records de durée de règne : EU2 n'a pas prévu de remplaçant passé le 15è siècle... le problème, c'est qu'elle est "médiocre" pour la diplomatie, la guerre et l'infrastructure :(
Je vais essayer de mettre des images de screenshots, mais le sites d'hébergement ne veut pas de mes beaux formats bmp... :(
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
Aaaah, la Belgique peut enfin assumer le rôle qui devrait être le sien depuis si longtemps: la domination de l'Europe!  Il était temps!
Il était temps!
Chouette aar en tout cas! Un cot dès le début aide beaucoup, mais les voisins sont vraiment dangereux, méchants et cruels
Pour l'abscence de nouveaux monarques, est-ce que l'agceep ne permet pas de résoudre ce problème?
Bonne continuation!
Chouette aar en tout cas! Un cot dès le début aide beaucoup, mais les voisins sont vraiment dangereux, méchants et cruels
Pour l'abscence de nouveaux monarques, est-ce que l'agceep ne permet pas de résoudre ce problème?
Bonne continuation!
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
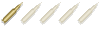
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
1550-1565 : les années de paix
Les années 1550 furent, pour le Régent, celles de la sagesse et de la gestion en bon père de famille. La fin de la dynastie capétienne avait traumatisé les cours européennes, et le Régent pressentait que tant de gloire et de panache accumulés pouvaient un jour se retourner contre lui.
Il décida de faire profil bas et, tandis que les nations européennes se déchiraient, il entreprit de renforcer l'économie et les infrastructures des territoires.
Financièrement, le Brabant sortait la tête de l'eau - ou plutôt, du sang qui déferlait en vagues tressautantes sur l'Europe. Pendant que l'Autriche, occupée à soigner son extension à l'est, que l'Angleterre, engagée dans une guerre coloniale impitoyable, que les Etats du Pape, orientés vers l'hégémonie italienne, voyaient leur économie ravagée par la banqueroute, le Brabant, lui, acquérrait le monopole des marchés flamands, puis français.
L'Angleterre, cependant, demeurait menaçante : elle avait rejeté la tutelle du Pape, et coup sur coup, annexait l'Eire et le duché d'Orléans.
Les troupes anglaises défilèrent à quelques lieues d'Etampes. Le Régent, travaillant son image de monarque sage et pacifique, ne releva pas la provocation. Il engagea un conseiller privé, qui lui suggéra de faire parvenir à Henri Dernier une layette rose brosée d'or, à l'occasion de la naissance de son fils Charles. Ce geste suscita l'admiration de plusieurs pays, ainsi que la réprobation de quelques jaloux. Quelques nobles brabançons, outré par la miséricorde du Régent, s'exilèrent au Bénin (!).
Le Régent passa outre l'affront, s'occupa à calmer les esprits, et reprit son travail de fourmi : les colonies aux Bermudes et à l'Isle Régentale se développaient, les marchands brabançons maintenanient leur monopole, l'économie prospérait.
L'Espagne, cependant, accroissait elle aussi sa puissance. Non contente de revendiquer la moitié du monde, elle plaçait avantageusement ses pions sur l'échiquier européen, s'alliant avec le Bourbonnais et annexant la Provence. Le danger croissait décidément au Sud...
1559-1565 : les bouleversements d'alliances
En 1559, l'alliance militaire du Brabant expira. Des pourparlers visant à une reconduction se tinrent à Jarnac.
Ce fut l'occasion pour l'Espagne d'afficher toute sa vilenie : à force de cajoleries, et sans que le Régent eut le temps de réagir, elle fit entrer la Bavière dans son alliance, et suggérait à la Savoie de se ranger du côté de l'Autriche. La Bretagne, alliée fidèle, ne se laissa pas séduire par les menées espagnoles, et quitta la table des négociations.
Le Régent, lui, hésitait. La Bavière avait montré sa vaillance à de nombreuses reprises, et était nécessaire au Régent pour se garder d'une attaque venant de l'Est. Il fallait désormais choisir un camp, écartelé entre de trop puissants voisins. Le Régent soupira et, ravalant sa fierté, demanda à rejoindre l'alliance espagnole. Philippe II triomphait, mais le Régent avait préservé la précieuse alliance bavaroise, et se trouvait désormais lié aux destins bourbonnais, espagnol et portugais.
Evidemment, c'était laisser la Savoie et l'Helvétie à l'Autriche : celle-ci ne se priva pas, et en fit rapidement ses vassaux.
Le Régent eut sa revanche en 1563 : dès la rupture de l'alliance, il la reconduisit, laissant le Portugal de côté, et se posant en véritable chef des forces alliées. Philippe II dut s'incliner à son tour, et de mauvaise grâce, trinqua avec le Régent. On servit à l'occasion de ce vin mousseux à peine sorti de la nouvelle distillerie établie en Champagne.
Pour l'anecdote, signalons que le Régent avait voulu implanter cette distillerie en Zélande, mais ses conseillers en communication signalèrent que "faire péter les bouchons de zélande en mangeant des moules de Champagne" sonnait un peu bizarrement, et suggérèrent une habile inversion.
Heureux avis : en 1565, des rebelles venus de Frise ravagèrent la Hollande et la Zélande (laissant intacts les bassins de mouléoculture). Une armée dépêchée par le Régent ("la brigade des klettes") dut s'y reprendre à plusieurs fois pour disperser ces bandes rebelles. La Hollande et la Zélande demeurèrent brabançonnes. Les Pays-Bas y gagnèrent fièrement leur indépendance, face à l'Anglois.
Le Régent, trop heureux de contrecarrer les plans anglais, fit parvenir à Groningue une pleine caisse d'or destinée à soutenir la lutte contre l'envahisseur honni.
"Il eut mieux fait de se briser une jambe ce jour-là" rapporta la chronique.
En effet, les Pays-Bas étaient une jeune république très puissante : à peine debout, l'Anglais repoussé, elle développa son commerce, provoquant la fermeture des séculaires foires de Bruges, qui se rapprochant de la frontière, migrèrent à Amsterdam. Les marchands brabançons durent boucler leurs malles et passer dans la province voisine. Ce fut le déclin de Bruges.
Non content de ce coup bas (les marchands néerlandais affluaient déjà dans ce nouveau centre de commerce), Guillaume d'Orange proposa benoîtement au Régent d'unir la destinée des deux pays, et de rejoindre la nouvelle République.
Le Régent fut séduit par le projet : gouverner depuis Bruxelles des territoires s'étendant de la Mer du Nord à la Loire... Guillaume d'Orange lui fit comprendre que ses propres plans étaient le parfait miroir de ceux du Régent : gouverner depuis Groningue des territoires s'étendant de la Loire à la Mer du Nord. Outré, le Régent déclina, au rythme de l'économie brabançonne : il fallut à nouveau tenter d'acquérir en monopole, tout en préservant celui de l'Ile-de-France.
1565 : la France renaît
L'Angleterre n'avait pas de chance avec ses possessions continentales. La même année, l'aventureux Charles Capet (le fils d'Henri Dernier, l'homme à la layette rose brodée d'or) souleva Orléans et Rouen. Il recréa de toutes pièces un royaume de France, bâti sur deux provinces, et se couronna sous le nom de Charles Neuf (pour bien établir la nouveauté de son règne). Les marchands français assaillirent le centre de commerce parisien.
Le Régent fomenta dès lors un plan de longue haleine contre la France : plusieurs régions aux alentours du nouveau royaume étaient susceptibles de se soulever et de rejoindre la couronne des Lys. Puisque les Français n'avaient pas compris que leur dynastie moribonde n'avait rien à faire en Europe, on allait devoir à nouveau le leur prouver...
1565-1575 : les guerres mineures (ou : les amuse-gueules avant le plat)
Le Régent massait des troupes à la frontière française. Mais deux contretemps le retardèrent : la Bavière déclarait la guerre à la Souabe - événement inintéressant et de peu de portée, la Souabe se trouvait seule et sans alliance. Mais surtout, quelques semaines plus tard, la Saxe déclarait la guerre à la Bavière.
La Saxe n'était pas seule : l'Helvétie, la Savoie et l'Autriche, notamment, composaient son alliance. L'Autriche eut le bon goût de déshonorer cette alliance. Mais l'Helvétie et la la Savoie semblaient des proies bien alléchantes. L'affaire de France fut reportée.
1566 vit la fin des ambitions de Guillaume d'Orange : sa jeune République démantelée reconnaissait à nouveau comme maître la puissante Angleterre.
1566 vit également les exploits suisses de la fameuse "Brigade des klettes", déjà connue pour ses défaites face aux paysans zélandais : la Brigade se fit battre à Berne, à Lucerne, à Besançon, à Zurich, à Bâle. Son capitaine finit par ordonner un retrait vers le Piémont, qu'ils se mirent à assiéger. La paix conclue avec la Savoie les vit inutiles : ils se replièrent vers la Champagne. Le Régent abandonna ses chimères helvétiques et se mit à proposer la paix à la Saxe, qui refusa toutes accomodations avec un ricanement.
Enfin, en 1568, la Saxe fit la paix avec la Bavière, en échanges d'indemnités, et de la reconnaissance des prétentions bavaroises sur la Souabe. Quelques jours plus tard, la France signait la paix avec l'Angleterre.
A nouveau, le regard dirigé vers le Sud, le Régent recruta, et financa les recherches concernant ce drôle de mélange de salpêtre et de charbon de bois, déjà utilisé par plusieurs armées voisines.
A nouveau, tout fut prêt pour l'invasion, en 1572. A nouveau, les dieux veillaient sur la France. Alors que le Régent s'apprêtait à envoyer à Charles Neuf la déclaration de guerre en bonne et due forme, la Bretagne s'avisa de déclarer la guerre à l'Ecosse. La Bavière et le Bourbonnais quittaient l'alliance, l'Espagne respectait ses engagements.
A nouveau, un choix crucial s'imposait : la Bavière ou l'Espagne ?
La Bavière était décidément trop nécessaire : le Régent quitta l'alliance, laissant l'Espagne s'amuser seule avec son joujou breton. Les "3B" (Bavière-Brabant-Bourbonnais) s'allièrent pour le meilleur et pour le pire.
Le Régent reprit en main la déclaration de guerre à la France, la signa, mit un timbre sur l'enveloppe. Il allait glisser celle-ci dans la boîte postale quand un héraut l'interrompit : des nobles venaient de s'allier à une puissance étrangère ! "Encore !" soupira le Régent, avant de poursuivre par cette parole historique : "Oui, mais quoi, après ?"
Après, des zérétiques zollandais se révoltèrent. Le Régent fit tourner les troupes d'Ile-de-France vers la Hollande, en poussant un gros, très gros soupir.
Encore une fois, la guerre fut reportée.
En Hollande, la Brigade des klettes ne faillit pas à sa réputation légendaire : il fallut cinq ans aux troupes sans cesse recrutées pour venir à bout de quelques croquants.
1578-1585 : la Campagne de France
Enfin, en 1578, le Régent avait les mains libres. Le temps de réorganiser l'armée et en 1580, enfin, après 15 ans de préparation, le Brabant déclarait la guerre à la France.
D'un côté, les 3B ; de l'autre : France, Aragon et Eire.
La Saxe, à nouveau, mit à mal les plans du Régent : elle déclara la guerre à la Bavière, dont les troupes auraient pu décider du destin de l'Europe du côté d'Orléans.
Mais bien plus que la Saxe, c'est désormais contre le Holstein, Brême, le Brandebourg et surtout l'Angleterre que le Brabant se retrouvait en guerre. On recruta, recruta, recruta.
1581 vit la Normandie et l'Orléanais assiégeées par les troupes brabançonnes. Dans les campagnes du duché, la guerre et les ruptures de mariages royaux avaient semé la consternation et le doute, germes de la révolte.
La Campagne de France devait être rapide. Elle ne le fut pas.
L'Europe elle-même devenait folle : l'Helvétie se trouva protestante, elle rompit son alliance avec l'Autriche. Il ne faut jamais braver un aigle : l'Autriche attaqua ses anciens alliés. L'Angleterre ravageait l'Artois, la Champagne, l'Ile-de-France, menaçant de couper les armées brabançonnes de leur capitale.
Pis : les Anglais brûlèrent l'tablissement brabançon aux Bermudes, prirent le contrôle de l'Isle Régentale.
Munster et l'Aragon assiégeaient la Hollande et la Zélande. Les bandes françaises dispersées ravageaient le pays. Sur ce, la province bourbonnaise du Maine déclara son indépendance, et un ceratin Henri de Navarre y proclama une "république huguenote". Enfin, à la fin de l'année 1581, Munster acceptait l'annexion bavaroise, soulageant du même coup les provinces brabançonnes du Nord.
La Suisse se tira de son conflit autrichien à bon compte, abandonnant sa province des Carpathes (!) à l'Empereur. Le pouvoir de l'Autriche grandissait sans cesse, puisque celle-ci avait vassalisé puis annexé la Bosnie et la Croatie.
1582 vit deux grandes et belles victoires : la bataille de Normandie, où les troupes brabançonnes arrivèrent par la mer, sous une grêle de mousquets français, arrachant leur conquête mètre après mètre ; le siège d'Orléans, où le Régent, traité de catin et blessé à l'épaule, se releva courageusement et conquit la ville.
La paix était faisable.
Mais... la province de Gueldre était toujours aragonnaise, alors qu'il était évident que ces pauvres hères n'aspiraient qu'à retrouver leur liberté et rejoindre le duché de Brabant. Le égent, renonçant à une paix trop facile, brava le danger, les troupes anglaises, les bandes françaises et décida de leur porter secours. Il est à noter qu'il venait d'apprendre que l'Aragon avait fait banqueroute et que ses troupes, mal payées, se débanderaient certainement si l'occasion leur en était donnée.
1583 vit ainsi les opérations se porter vers la Gueldre et le Finistère, tous deux aragonais. Cette même année, la Bavière et l'Autriche firent démonstration de leur talent, guerrier pour l'un en annexant cette drôle de "République Huguenote" ; diplomatique poour l'autre en recueillant l'héritage de la Savoie.
1583 vit également l'imbroglio européen s'emmêler davantage : la Bretagne déclarait la guerre à la Bavière. L'Espagne rejoignit son allié, le Bourbonnais fit face également. Le Brabant devait choisir. Il avait sacrifié plusieurs de ses plans en fonction de la Bavière, indispensable à l'Est. D'un autre côté, la guerre avait déjà épuisé le Brabant, trop faible face à l'Espagne.
Le Régent déshonora l'alliance. Il voulait la paix avant tout.
Pendant que leurs anciens alliés s'entre-étripaient, les armées sifflotantes du Régent capturaient le Finistère et la Gueldre à l'Aagon, qui abandonna volontiers cette province du Nord si malaisément défendable, pour autant qu'elle conservât Brest.
Enfin, la France n'eut d'autre choix que de céder la Normandie.

Réduite à une province, l'ancien duché d'Orléans, elle se retrouvait aussi au carrefour des ambitions des 3B, et dans une moindre mesure, dans le collimateur de l'Espagne et de l'Autriche...
Pendant ce temps, outre-Atlantique...

NE RATEZ PAS DANS LE PROCHAIN EPISODE : des traitrises, des manipulations, de la romance, et plein de filles à poil !!!
Les années 1550 furent, pour le Régent, celles de la sagesse et de la gestion en bon père de famille. La fin de la dynastie capétienne avait traumatisé les cours européennes, et le Régent pressentait que tant de gloire et de panache accumulés pouvaient un jour se retourner contre lui.
Il décida de faire profil bas et, tandis que les nations européennes se déchiraient, il entreprit de renforcer l'économie et les infrastructures des territoires.
Financièrement, le Brabant sortait la tête de l'eau - ou plutôt, du sang qui déferlait en vagues tressautantes sur l'Europe. Pendant que l'Autriche, occupée à soigner son extension à l'est, que l'Angleterre, engagée dans une guerre coloniale impitoyable, que les Etats du Pape, orientés vers l'hégémonie italienne, voyaient leur économie ravagée par la banqueroute, le Brabant, lui, acquérrait le monopole des marchés flamands, puis français.
L'Angleterre, cependant, demeurait menaçante : elle avait rejeté la tutelle du Pape, et coup sur coup, annexait l'Eire et le duché d'Orléans.
Les troupes anglaises défilèrent à quelques lieues d'Etampes. Le Régent, travaillant son image de monarque sage et pacifique, ne releva pas la provocation. Il engagea un conseiller privé, qui lui suggéra de faire parvenir à Henri Dernier une layette rose brosée d'or, à l'occasion de la naissance de son fils Charles. Ce geste suscita l'admiration de plusieurs pays, ainsi que la réprobation de quelques jaloux. Quelques nobles brabançons, outré par la miséricorde du Régent, s'exilèrent au Bénin (!).
Le Régent passa outre l'affront, s'occupa à calmer les esprits, et reprit son travail de fourmi : les colonies aux Bermudes et à l'Isle Régentale se développaient, les marchands brabançons maintenanient leur monopole, l'économie prospérait.
L'Espagne, cependant, accroissait elle aussi sa puissance. Non contente de revendiquer la moitié du monde, elle plaçait avantageusement ses pions sur l'échiquier européen, s'alliant avec le Bourbonnais et annexant la Provence. Le danger croissait décidément au Sud...
1559-1565 : les bouleversements d'alliances
En 1559, l'alliance militaire du Brabant expira. Des pourparlers visant à une reconduction se tinrent à Jarnac.
Ce fut l'occasion pour l'Espagne d'afficher toute sa vilenie : à force de cajoleries, et sans que le Régent eut le temps de réagir, elle fit entrer la Bavière dans son alliance, et suggérait à la Savoie de se ranger du côté de l'Autriche. La Bretagne, alliée fidèle, ne se laissa pas séduire par les menées espagnoles, et quitta la table des négociations.
Le Régent, lui, hésitait. La Bavière avait montré sa vaillance à de nombreuses reprises, et était nécessaire au Régent pour se garder d'une attaque venant de l'Est. Il fallait désormais choisir un camp, écartelé entre de trop puissants voisins. Le Régent soupira et, ravalant sa fierté, demanda à rejoindre l'alliance espagnole. Philippe II triomphait, mais le Régent avait préservé la précieuse alliance bavaroise, et se trouvait désormais lié aux destins bourbonnais, espagnol et portugais.
Evidemment, c'était laisser la Savoie et l'Helvétie à l'Autriche : celle-ci ne se priva pas, et en fit rapidement ses vassaux.
Le Régent eut sa revanche en 1563 : dès la rupture de l'alliance, il la reconduisit, laissant le Portugal de côté, et se posant en véritable chef des forces alliées. Philippe II dut s'incliner à son tour, et de mauvaise grâce, trinqua avec le Régent. On servit à l'occasion de ce vin mousseux à peine sorti de la nouvelle distillerie établie en Champagne.
Pour l'anecdote, signalons que le Régent avait voulu implanter cette distillerie en Zélande, mais ses conseillers en communication signalèrent que "faire péter les bouchons de zélande en mangeant des moules de Champagne" sonnait un peu bizarrement, et suggérèrent une habile inversion.
Heureux avis : en 1565, des rebelles venus de Frise ravagèrent la Hollande et la Zélande (laissant intacts les bassins de mouléoculture). Une armée dépêchée par le Régent ("la brigade des klettes") dut s'y reprendre à plusieurs fois pour disperser ces bandes rebelles. La Hollande et la Zélande demeurèrent brabançonnes. Les Pays-Bas y gagnèrent fièrement leur indépendance, face à l'Anglois.
Le Régent, trop heureux de contrecarrer les plans anglais, fit parvenir à Groningue une pleine caisse d'or destinée à soutenir la lutte contre l'envahisseur honni.
"Il eut mieux fait de se briser une jambe ce jour-là" rapporta la chronique.
En effet, les Pays-Bas étaient une jeune république très puissante : à peine debout, l'Anglais repoussé, elle développa son commerce, provoquant la fermeture des séculaires foires de Bruges, qui se rapprochant de la frontière, migrèrent à Amsterdam. Les marchands brabançons durent boucler leurs malles et passer dans la province voisine. Ce fut le déclin de Bruges.
Non content de ce coup bas (les marchands néerlandais affluaient déjà dans ce nouveau centre de commerce), Guillaume d'Orange proposa benoîtement au Régent d'unir la destinée des deux pays, et de rejoindre la nouvelle République.
Le Régent fut séduit par le projet : gouverner depuis Bruxelles des territoires s'étendant de la Mer du Nord à la Loire... Guillaume d'Orange lui fit comprendre que ses propres plans étaient le parfait miroir de ceux du Régent : gouverner depuis Groningue des territoires s'étendant de la Loire à la Mer du Nord. Outré, le Régent déclina, au rythme de l'économie brabançonne : il fallut à nouveau tenter d'acquérir en monopole, tout en préservant celui de l'Ile-de-France.
1565 : la France renaît
L'Angleterre n'avait pas de chance avec ses possessions continentales. La même année, l'aventureux Charles Capet (le fils d'Henri Dernier, l'homme à la layette rose brodée d'or) souleva Orléans et Rouen. Il recréa de toutes pièces un royaume de France, bâti sur deux provinces, et se couronna sous le nom de Charles Neuf (pour bien établir la nouveauté de son règne). Les marchands français assaillirent le centre de commerce parisien.
Le Régent fomenta dès lors un plan de longue haleine contre la France : plusieurs régions aux alentours du nouveau royaume étaient susceptibles de se soulever et de rejoindre la couronne des Lys. Puisque les Français n'avaient pas compris que leur dynastie moribonde n'avait rien à faire en Europe, on allait devoir à nouveau le leur prouver...
1565-1575 : les guerres mineures (ou : les amuse-gueules avant le plat)
Le Régent massait des troupes à la frontière française. Mais deux contretemps le retardèrent : la Bavière déclarait la guerre à la Souabe - événement inintéressant et de peu de portée, la Souabe se trouvait seule et sans alliance. Mais surtout, quelques semaines plus tard, la Saxe déclarait la guerre à la Bavière.
La Saxe n'était pas seule : l'Helvétie, la Savoie et l'Autriche, notamment, composaient son alliance. L'Autriche eut le bon goût de déshonorer cette alliance. Mais l'Helvétie et la la Savoie semblaient des proies bien alléchantes. L'affaire de France fut reportée.
1566 vit la fin des ambitions de Guillaume d'Orange : sa jeune République démantelée reconnaissait à nouveau comme maître la puissante Angleterre.
1566 vit également les exploits suisses de la fameuse "Brigade des klettes", déjà connue pour ses défaites face aux paysans zélandais : la Brigade se fit battre à Berne, à Lucerne, à Besançon, à Zurich, à Bâle. Son capitaine finit par ordonner un retrait vers le Piémont, qu'ils se mirent à assiéger. La paix conclue avec la Savoie les vit inutiles : ils se replièrent vers la Champagne. Le Régent abandonna ses chimères helvétiques et se mit à proposer la paix à la Saxe, qui refusa toutes accomodations avec un ricanement.
Enfin, en 1568, la Saxe fit la paix avec la Bavière, en échanges d'indemnités, et de la reconnaissance des prétentions bavaroises sur la Souabe. Quelques jours plus tard, la France signait la paix avec l'Angleterre.
A nouveau, le regard dirigé vers le Sud, le Régent recruta, et financa les recherches concernant ce drôle de mélange de salpêtre et de charbon de bois, déjà utilisé par plusieurs armées voisines.
A nouveau, tout fut prêt pour l'invasion, en 1572. A nouveau, les dieux veillaient sur la France. Alors que le Régent s'apprêtait à envoyer à Charles Neuf la déclaration de guerre en bonne et due forme, la Bretagne s'avisa de déclarer la guerre à l'Ecosse. La Bavière et le Bourbonnais quittaient l'alliance, l'Espagne respectait ses engagements.
A nouveau, un choix crucial s'imposait : la Bavière ou l'Espagne ?
La Bavière était décidément trop nécessaire : le Régent quitta l'alliance, laissant l'Espagne s'amuser seule avec son joujou breton. Les "3B" (Bavière-Brabant-Bourbonnais) s'allièrent pour le meilleur et pour le pire.
Le Régent reprit en main la déclaration de guerre à la France, la signa, mit un timbre sur l'enveloppe. Il allait glisser celle-ci dans la boîte postale quand un héraut l'interrompit : des nobles venaient de s'allier à une puissance étrangère ! "Encore !" soupira le Régent, avant de poursuivre par cette parole historique : "Oui, mais quoi, après ?"
Après, des zérétiques zollandais se révoltèrent. Le Régent fit tourner les troupes d'Ile-de-France vers la Hollande, en poussant un gros, très gros soupir.
Encore une fois, la guerre fut reportée.
En Hollande, la Brigade des klettes ne faillit pas à sa réputation légendaire : il fallut cinq ans aux troupes sans cesse recrutées pour venir à bout de quelques croquants.
1578-1585 : la Campagne de France
Enfin, en 1578, le Régent avait les mains libres. Le temps de réorganiser l'armée et en 1580, enfin, après 15 ans de préparation, le Brabant déclarait la guerre à la France.
D'un côté, les 3B ; de l'autre : France, Aragon et Eire.
La Saxe, à nouveau, mit à mal les plans du Régent : elle déclara la guerre à la Bavière, dont les troupes auraient pu décider du destin de l'Europe du côté d'Orléans.
Mais bien plus que la Saxe, c'est désormais contre le Holstein, Brême, le Brandebourg et surtout l'Angleterre que le Brabant se retrouvait en guerre. On recruta, recruta, recruta.
1581 vit la Normandie et l'Orléanais assiégeées par les troupes brabançonnes. Dans les campagnes du duché, la guerre et les ruptures de mariages royaux avaient semé la consternation et le doute, germes de la révolte.
La Campagne de France devait être rapide. Elle ne le fut pas.
L'Europe elle-même devenait folle : l'Helvétie se trouva protestante, elle rompit son alliance avec l'Autriche. Il ne faut jamais braver un aigle : l'Autriche attaqua ses anciens alliés. L'Angleterre ravageait l'Artois, la Champagne, l'Ile-de-France, menaçant de couper les armées brabançonnes de leur capitale.
Pis : les Anglais brûlèrent l'tablissement brabançon aux Bermudes, prirent le contrôle de l'Isle Régentale.
Munster et l'Aragon assiégeaient la Hollande et la Zélande. Les bandes françaises dispersées ravageaient le pays. Sur ce, la province bourbonnaise du Maine déclara son indépendance, et un ceratin Henri de Navarre y proclama une "république huguenote". Enfin, à la fin de l'année 1581, Munster acceptait l'annexion bavaroise, soulageant du même coup les provinces brabançonnes du Nord.
La Suisse se tira de son conflit autrichien à bon compte, abandonnant sa province des Carpathes (!) à l'Empereur. Le pouvoir de l'Autriche grandissait sans cesse, puisque celle-ci avait vassalisé puis annexé la Bosnie et la Croatie.
1582 vit deux grandes et belles victoires : la bataille de Normandie, où les troupes brabançonnes arrivèrent par la mer, sous une grêle de mousquets français, arrachant leur conquête mètre après mètre ; le siège d'Orléans, où le Régent, traité de catin et blessé à l'épaule, se releva courageusement et conquit la ville.
La paix était faisable.
Mais... la province de Gueldre était toujours aragonnaise, alors qu'il était évident que ces pauvres hères n'aspiraient qu'à retrouver leur liberté et rejoindre le duché de Brabant. Le égent, renonçant à une paix trop facile, brava le danger, les troupes anglaises, les bandes françaises et décida de leur porter secours. Il est à noter qu'il venait d'apprendre que l'Aragon avait fait banqueroute et que ses troupes, mal payées, se débanderaient certainement si l'occasion leur en était donnée.
1583 vit ainsi les opérations se porter vers la Gueldre et le Finistère, tous deux aragonais. Cette même année, la Bavière et l'Autriche firent démonstration de leur talent, guerrier pour l'un en annexant cette drôle de "République Huguenote" ; diplomatique poour l'autre en recueillant l'héritage de la Savoie.
1583 vit également l'imbroglio européen s'emmêler davantage : la Bretagne déclarait la guerre à la Bavière. L'Espagne rejoignit son allié, le Bourbonnais fit face également. Le Brabant devait choisir. Il avait sacrifié plusieurs de ses plans en fonction de la Bavière, indispensable à l'Est. D'un autre côté, la guerre avait déjà épuisé le Brabant, trop faible face à l'Espagne.
Le Régent déshonora l'alliance. Il voulait la paix avant tout.
Pendant que leurs anciens alliés s'entre-étripaient, les armées sifflotantes du Régent capturaient le Finistère et la Gueldre à l'Aagon, qui abandonna volontiers cette province du Nord si malaisément défendable, pour autant qu'elle conservât Brest.
Enfin, la France n'eut d'autre choix que de céder la Normandie.

Réduite à une province, l'ancien duché d'Orléans, elle se retrouvait aussi au carrefour des ambitions des 3B, et dans une moindre mesure, dans le collimateur de l'Espagne et de l'Autriche...
Pendant ce temps, outre-Atlantique...

NE RATEZ PAS DANS LE PROCHAIN EPISODE : des traitrises, des manipulations, de la romance, et plein de filles à poil !!!
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
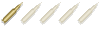
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
1585-1587 : la montée en puissance espagnole
Le Brabant, sagement retiré de toute alliance, s'occupa à panser les plaies de la guerre. Les bandes de pillards s'en donnaient à coeur joie dans les provinces avoisinantes et saccageaint les possessions anglaises, bavaroises et le royaume de France (d'opérette).
En 1587, l'Espagne concédait la paix à la Bavière en échange du Nivernais. Un nouveau voisin direct, très dangereux, très puissant, inquiétait le Régent. Celui-ci se dit que l'Espagne, tournée vers les richesses océanes, n'avait aucun intérêt à se développer vers le Nord de l'Europe... L'Histoire lui donnera tort...
Mais n'anticipons pas...

1587-1589 : les années folles
Il suffit à cinq années à l'Histoire pour se précipiter et brouiller les cartes politiques. Ce XVIè siècle finissant, qui voit les progrès des Arts, des Armes et des Lois, voit aussi les évenements s'accélérer, des trônes perdus et reconquis, sur fond de révoltes, d'hérésie et de pactes étranges.
Alors que le catholiscisme semblait triompher, l'Autriche et l'Aragon suivant le pas de la contre-réforme, Henri de Navarre, l'éphémère dirigeant des Huguenots dans le Maine, reprit son idée de république huguenote, toujours aux dépends du Bourbonnais, mais cette fois en soulevant la province du Dauphiné et en la ralliant à son panache blanc.
Cet événement souleva l'émoi dans les cours catholiques, d'autant qu'Henri de Navarre, entendant mener une croisade protestante, déclara la guerre au Bourbonnais.
La Bavière, désorientée, se retira de l'alliance. Le Régent fut tout heureux de récupérer les grâces de son ancien allié. Il démontra que toute velléité de contrôler un jour l'Helvétie ne l'avait pas abandonné, puisqu'il parvint à persuader celle-ci d'intégrer la nouvelle alliance.
Le Bourbonnais, lui, se jetait dans les bras de l'Autriche. La guerre d'Henri de Navarre semblait mal engagée.
Le Régent le vit, et tenta une hardiesse : plairaît-il au Navarrais d'être le quatrième larron de son alliance ? Le Navarrais jaugea les forces et préféra se tourner vers l'Espagne et la Bretagne.
1589 : "l'oiseau-lyre au pot pour tout le monde le dimanche"
Henri de Navarre projetait un coup de grande ampleur : le trône de France était vacant, et lui-même, capitaine de la République huguenote, pouvait faire valoir ses droits au sceptre des lys. Son plan était de joindre sous sa bannière la monarchie et la république, et de refonder un royaume aux ambitions extraordinaires. L'Europe pour lui n'était pas assez vaste, le Dauphiné et l'Orléanais, séparés et trop isolés. A la même époque, les Amériques offraient des perspectives nouvelles d'exploration et d'expansion. Henri de Navarre, torturé entre son héritage de huguenot républicain, et ses prétentions monarchiques, entre Grenoble et Orléans, décida d'une étape nouvelle dans l'Histoire du monde : si l'Europe, comme l'avait déclaré le Régent, n'avait plus besoin de la dynastie française moribonde, la dynsatie française remise à neuf irait s'établir dans les nouvelles Amériques.
Henri de Navarre devint ainsi Henri IV de France, et installa sa capitale dans les Antilles, au milieu de nouvelles terres à conquérir, dans la bien nommée Fort-de-France, sur l'île de la Martinique.
Désormais, Henri IV, premier roi chrétien d'outre-mer, aurait ses possessions aux Amériques et ses colonies en Europe. La vieille Europe n'avait jamais vu cela.
Le pari valait bien une messe : Henri IV l'écouta dans la petite église de Fort de France, le 1er août 1589.
L'année suivante, les Orléanias, révoltés par le procédé, déclarèrent leur indépendance : un autre Henri, quatrième lui aussi, devint le nouveau duc d'Orléans. La France ne gardait plus en Europe que le Dauphiné.
L'Angleterre se montrait toujours plus rapace, annexant la Saxe et le Brandebourg, étendant son territoire à l'Est jusque Poznan. Le Bourbonnais, lui, allié à l'Autriche et à la France, déclarait à la guerre à Orléans.
L'Europe sombrait dans la folie...


Le Brabant, sagement retiré de toute alliance, s'occupa à panser les plaies de la guerre. Les bandes de pillards s'en donnaient à coeur joie dans les provinces avoisinantes et saccageaint les possessions anglaises, bavaroises et le royaume de France (d'opérette).
En 1587, l'Espagne concédait la paix à la Bavière en échange du Nivernais. Un nouveau voisin direct, très dangereux, très puissant, inquiétait le Régent. Celui-ci se dit que l'Espagne, tournée vers les richesses océanes, n'avait aucun intérêt à se développer vers le Nord de l'Europe... L'Histoire lui donnera tort...
Mais n'anticipons pas...

1587-1589 : les années folles
Il suffit à cinq années à l'Histoire pour se précipiter et brouiller les cartes politiques. Ce XVIè siècle finissant, qui voit les progrès des Arts, des Armes et des Lois, voit aussi les évenements s'accélérer, des trônes perdus et reconquis, sur fond de révoltes, d'hérésie et de pactes étranges.
Alors que le catholiscisme semblait triompher, l'Autriche et l'Aragon suivant le pas de la contre-réforme, Henri de Navarre, l'éphémère dirigeant des Huguenots dans le Maine, reprit son idée de république huguenote, toujours aux dépends du Bourbonnais, mais cette fois en soulevant la province du Dauphiné et en la ralliant à son panache blanc.
Cet événement souleva l'émoi dans les cours catholiques, d'autant qu'Henri de Navarre, entendant mener une croisade protestante, déclara la guerre au Bourbonnais.
La Bavière, désorientée, se retira de l'alliance. Le Régent fut tout heureux de récupérer les grâces de son ancien allié. Il démontra que toute velléité de contrôler un jour l'Helvétie ne l'avait pas abandonné, puisqu'il parvint à persuader celle-ci d'intégrer la nouvelle alliance.
Le Bourbonnais, lui, se jetait dans les bras de l'Autriche. La guerre d'Henri de Navarre semblait mal engagée.
Le Régent le vit, et tenta une hardiesse : plairaît-il au Navarrais d'être le quatrième larron de son alliance ? Le Navarrais jaugea les forces et préféra se tourner vers l'Espagne et la Bretagne.
1589 : "l'oiseau-lyre au pot pour tout le monde le dimanche"
Henri de Navarre projetait un coup de grande ampleur : le trône de France était vacant, et lui-même, capitaine de la République huguenote, pouvait faire valoir ses droits au sceptre des lys. Son plan était de joindre sous sa bannière la monarchie et la république, et de refonder un royaume aux ambitions extraordinaires. L'Europe pour lui n'était pas assez vaste, le Dauphiné et l'Orléanais, séparés et trop isolés. A la même époque, les Amériques offraient des perspectives nouvelles d'exploration et d'expansion. Henri de Navarre, torturé entre son héritage de huguenot républicain, et ses prétentions monarchiques, entre Grenoble et Orléans, décida d'une étape nouvelle dans l'Histoire du monde : si l'Europe, comme l'avait déclaré le Régent, n'avait plus besoin de la dynastie française moribonde, la dynsatie française remise à neuf irait s'établir dans les nouvelles Amériques.
Henri de Navarre devint ainsi Henri IV de France, et installa sa capitale dans les Antilles, au milieu de nouvelles terres à conquérir, dans la bien nommée Fort-de-France, sur l'île de la Martinique.
Désormais, Henri IV, premier roi chrétien d'outre-mer, aurait ses possessions aux Amériques et ses colonies en Europe. La vieille Europe n'avait jamais vu cela.
Le pari valait bien une messe : Henri IV l'écouta dans la petite église de Fort de France, le 1er août 1589.
L'année suivante, les Orléanias, révoltés par le procédé, déclarèrent leur indépendance : un autre Henri, quatrième lui aussi, devint le nouveau duc d'Orléans. La France ne gardait plus en Europe que le Dauphiné.
L'Angleterre se montrait toujours plus rapace, annexant la Saxe et le Brandebourg, étendant son territoire à l'Est jusque Poznan. Le Bourbonnais, lui, allié à l'Autriche et à la France, déclarait à la guerre à Orléans.
L'Europe sombrait dans la folie...


Modifié en dernier par T le Taudis le mer. déc. 15, 2004 1:12 am, modifié 1 fois.
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
-
athax
- Terreur du Forum
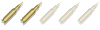
- Messages : 699
- Enregistré le : mar. août 17, 2004 8:34 pm
- Meilleur jeu 2008 : Medieval II Total war Kingdoms
- Meilleur jeu 2009 : Europa Universalis 2
Très très bon AAR. Un peu utopique (comment diable des bandes de Belges auraient-ils pu détruire le royaume de France)
Tu as quoi comme niveau d'infra naval et terrestre par rapport aux "grands" (espagne,angleterre,Autriche) ?
En tout cas,tu te débrouilles bien ... toujours gouverné par ta doyente du monde ta Belgique ?
Tu as quoi comme niveau d'infra naval et terrestre par rapport aux "grands" (espagne,angleterre,Autriche) ?
En tout cas,tu te débrouilles bien ... toujours gouverné par ta doyente du monde ta Belgique ?
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
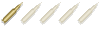
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
Mais le royaume de France n'est pas détruit (il est un juste un peu plus à l'ouest)  Et en fait, il a subi la punition du superbourrin haï par tous (mais c'est vrai que c'est effarant de comparer son état entre 1490 et 1590).
Et en fait, il a subi la punition du superbourrin haï par tous (mais c'est vrai que c'est effarant de comparer son état entre 1490 et 1590).
Alors, les niveaux :
Brabant :
Commerce : 41 - Infra : 29 - Terrestre : 8 - Naval : 5
Espagne :
Commerce : 25 - Infra : 16 - Terrestre : 11 - Naval : 5
Angleterre :
Commerce : 34 - Infra : 27 - Terrestre : 6 - Naval : 5
Autriche :
Comemrce : 24 - Infra : 21 - Terrestre : 11 - Naval : 2
Bavière :
Commerce : 42 - Infra : 19 - Terrestre : 10 - Naval : 2
France :
Commerce : 37 - Infra : 23 - Terrestre : 10 - Naval : 6
Danemark :
Commerce : 49 - Infra : 32 - Terrestre : 11 - Naval : 9
(lui, je sais pas comment il a fait)
Mon inflation est à 50, les autres tournent autour de 45 (la Russie 127!).
Mon badboy est de 6,9/43
En fait, comme souvent, j'ai investi beaucoup dès le début en commerce puis en infra, en réduisant les dépenses au minimum, quitte à finir les années avec une trésorerie vide dès octobre. Mon inflation a été de 0 durant de longues années, ce qui a permis de voir les investissements monter très vite (le naval était toujours minimum, par exemple, et je suis au même niveau que les autres pays "à vocation maritime", comme l'Espagne ou l'Angleterre).
Je crois que les petits pays sont avantagés pour ça, puisque dans les parties avec la Bourgogne ou la France, alors que je suis à 7 ou 8 en terrestre, les petits états du Rhin sont régulièrement à 10 ou 12.
Puis, lors de l'attaque (perfide) autrichienne, j'ai dû emprunter beaucoup (2 banqueroutes en même pas 5 ans), et je crois que j'ai dû en faire une troisième par la suite.
J'ai tout investi en terrestre avant d'attaquer la France, parce que je voyais que mes armées commençaitent à avoir du mal (la brigade des klettes).
Ce qui est marrant, c'est que à la fin, en 1820, lors du tableau récapitualtif, le 2ème pays en terme de points était "Rebel Scum"... ça doit être rigolo de jouer les rebelles (en plus je suppose qu'il n'y a jamais de rebellion)
Quant à Jacqueline (soupir), oui, elle est toujours là, et tiendra le coup jusqu'à la fin (500 ans de règne). Si au moins, elle avait 5 partout en compétences... pfff... :(
Alors, les niveaux :
Brabant :
Commerce : 41 - Infra : 29 - Terrestre : 8 - Naval : 5
Espagne :
Commerce : 25 - Infra : 16 - Terrestre : 11 - Naval : 5
Angleterre :
Commerce : 34 - Infra : 27 - Terrestre : 6 - Naval : 5
Autriche :
Comemrce : 24 - Infra : 21 - Terrestre : 11 - Naval : 2
Bavière :
Commerce : 42 - Infra : 19 - Terrestre : 10 - Naval : 2
France :
Commerce : 37 - Infra : 23 - Terrestre : 10 - Naval : 6
Danemark :
Commerce : 49 - Infra : 32 - Terrestre : 11 - Naval : 9
(lui, je sais pas comment il a fait)
Mon inflation est à 50, les autres tournent autour de 45 (la Russie 127!).
Mon badboy est de 6,9/43
En fait, comme souvent, j'ai investi beaucoup dès le début en commerce puis en infra, en réduisant les dépenses au minimum, quitte à finir les années avec une trésorerie vide dès octobre. Mon inflation a été de 0 durant de longues années, ce qui a permis de voir les investissements monter très vite (le naval était toujours minimum, par exemple, et je suis au même niveau que les autres pays "à vocation maritime", comme l'Espagne ou l'Angleterre).
Je crois que les petits pays sont avantagés pour ça, puisque dans les parties avec la Bourgogne ou la France, alors que je suis à 7 ou 8 en terrestre, les petits états du Rhin sont régulièrement à 10 ou 12.
Puis, lors de l'attaque (perfide) autrichienne, j'ai dû emprunter beaucoup (2 banqueroutes en même pas 5 ans), et je crois que j'ai dû en faire une troisième par la suite.
J'ai tout investi en terrestre avant d'attaquer la France, parce que je voyais que mes armées commençaitent à avoir du mal (la brigade des klettes).
Ce qui est marrant, c'est que à la fin, en 1820, lors du tableau récapitualtif, le 2ème pays en terme de points était "Rebel Scum"... ça doit être rigolo de jouer les rebelles (en plus je suppose qu'il n'y a jamais de rebellion)
Quant à Jacqueline (soupir), oui, elle est toujours là, et tiendra le coup jusqu'à la fin (500 ans de règne). Si au moins, elle avait 5 partout en compétences... pfff... :(
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
-
T le Taudis
- Aspirant spammeur
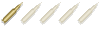
- Messages : 330
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2004 9:54 am
- Localisation : Bruxelles XL
1592-1600 : la politique de l'Autriche ( ou : j'avance, je recule, comment veux-tu, comment veux-tu...)
En cette même année 1592, le Régent, emporté lui aussi par la folie du monde et la griserie des victoires, se sentit suffisamment fort pour tenter de rogner les ailes du trop puissant voisin autrichien : considérant l'alliance Bourbonnais-Autriche-France occupée à une guerre contre Orléans, et ses armées étant disponibles et prêtes, il déclara la guerre à l'Autriche.
Cette manoeuvre avait un double but : ruiner deux puissances grandissantes (l'Autriche et la Bavière) en les faisant se battre l'une contre l'autre ; et tenter de grappiler quelques terres au Bourbonnais, s'étendant un peu trop au goût du Régent.
La stratégie allait s'opérer suivant deux axes : un corps d'armée se chargerait de battre les armées bourbonnaises regroupées devant Orléans (et tenter de garantir ainsi l'indépendance du duché) ; un autre se pénétrerait les terres autrichiennes et tenterait de conquérir l'Alsace et Bade. Les projets du Régent pour sa frontière est demeuraient les mêmes : annexer pour rendre ensuite l'indépendance, rogner les territoires autrichiens tout en créant deux états-vassaux-tampons.
Hélas, les armées brabançonnes se firent battre à Orléans et durent battre en retraite. Les nouvelles sur le front autrichien étaient meilleures : l'Empereur, présumant de sa force, avait déclaré la guerre aux Ottomans. Ses troupes faisaient défaut à l'Ouest, et Bade fut promptement assiégée, la Bavière se chargeant de l'Alsace.
Une contre-offensive permit aux Brabançons de délivrer Orléans, puis d'assiéger la Bourgogne. Plusieurs fois attaquées, les troupes tinrent bon, tant à Bade que devant Dijon.
Le Brabant faisait-il peur ? Brême et son allié polonais lui déclarèrent la guerre. Peu chalait au Régent : ces pays étaient trop éloignés pour réellement l'inquiéter. Ce qui lui fut plus objet de tourment fut l'infidélité de ses alliés bavarois et helvètes, qui reculèrent devant ce nouveau conflit.
La fin de l'année vit Bade tomber, les troupes du régent assiéger l'Armor, et hélas, l'Helvétie disparaître, étouffée sous la déferlante autrichienne.
1593 vit de nouveaux succès : Dijon tomba, l'Auvergne fut assiégée. L'Autriche, elle, s'employait à trouver de nouveaux alliés : les Chevaliers de hodes, Venise vinrent déployer leur bannière à ses côtés.
Attaquées sur plusieurs fronts, les troupes du Régent accumulaient les victoires sur des armées certes recrutées à la hâte. Le égent avait cependant cessé son offensive vers l'Est, craignant de voir son corps d'armée piégé dans la nasse autrichienne. Et surtout, Orléans était à nouveau assiégée, mais par des troupes autrichiennes : le Régent imagina qu'une paix en échange de l'Orléanais tout frais autrichien ne serait pas pour lui déplaire.
Ainsi, les troupes brabançonnes assiégèrent Berne (l'Helvétie serait-elle donc bien un jour brabançonne ?) . De même, sitôt Orléans tombée et annexée par l'Autriche, le Régent mis le siège devant la ville, escomptant sur une victoire rapide. Les objectifs avaient changé : conquérir l'Orléanais et, si possible, le canton de Berne.
Les bourbonnais, eux, ne s'avouaient pas vaincu : leurs troupes reprirent aisément Dijon, mal défendue. Les Autrichiens étaient sur le point de faire tomber la Normandie : le Régent, comprenant qu'on se dirigeait vers une guerre d'usure, dépâcha des troupes afin d'assiéger la Savoie. Les provinces conquises, ou même les sièges entamés, pouvaient être autant de monnaie utile dans l'escarcelle du Régent lors du grand troc final.
La Normandie tomba. Bien pis, à la fin de l'année, la Bavière, lassée, se retira de la guerre contre la somme dérisoire de 30 écus ("Les 30 écus de Judas", fulmina le Régent). Le Brabant était désormais bien seul.
1594 vit la fortune varier au gré des armes : Bade était assiégée par l'Autriche, la Normandie par le Brabant. Orléans tomba. A la fin de l'année, Bade et la Normandie retrouvaient leurs propriétaires respectifs. La Pologne et la France se manifestèrent en assiégant la Gueldre. Ils furent vite repoussés. Cependant, aucun des belligérants ne souhaitaient les généreuses paix du Régent. Et dans le chef de ce dernier, il était hors de question de se désengager du conflit sans y gagner le contrôle d'une province.
1595 permit aux troupes brabançonnes de s'illustrer dans quelques combats, et de faire tomber la province du Maine. Mais les événements n'avançaient guère. Tout le plan de percée vers l'Autriche était à rétablir : l'entreprise parut trop grande au Régent, et il revit ses ambitions à la baisse. Qu'on lui abandonnât l'Orléanias, et une quelconque province bourbonnaise, et il serait heureux. Mais ses adversaires se montraient intraitables et refusaient de céder.
La situation semblait inextricable.
En juin, l'Espagne annonçait qu'elle renonçait à son accès militaire sur les possessions bourbonnaises : cela ne pouvait signaler qu'une chose - la guerre le mois suivant.
Le Régent tenta de forcer les pourparlers, mais l'obstination était plénipotentiare du camp adverse : les propositions les plus raisonnables furent impitoyablement rejetées. En désespoir de cause, le Régent fit envoyer quelques babioles à la Cour d'Espagne - celle-ci assurait en retour au Régent sa neutralité.
1595-1600 : l'Espagne tombe le masque ! (ou : qu'allait-il faire en cette galère ?)
Les serments espagnols durent ce que durent les étés : en septembre, les ignobles hispaniques firent parvenir au régent leur déclaration de guerre. Ils entraînaient avec eux la Bretagne. Des troupes se construisaient déjà en Nivernais et en Picardie.
En désespoir de cause, le Régent se tourna vers son ultime recours, ses anciens alliés de l'Est. Il s'en ouvrit à la grosse Jacqueline de Bavière :
" - Majesté, pour vaincre et survivre, il nous faut des bavarois. Sans cela, nous sommes perdus."
La ventripotente duchesse gagea ses propres bijoux, et le lendemain, 10 000 bavarois se trouvaient réunis dans la grande salle du palais ducal. Assise à une table, la grosse Jacqueline se frottait les mains et se léchait les babines. Le Régent, entrant dans la pièce, eut un moment de désespoir : que pouvait-on bien faire avec 10 000 petits gâteaux à la framboise ? Laissant la grosse à ses agapes, il fit parvenir au duc de Bavière un traité d'alliance, et attendit anxieusement.
La réponse lui parvint rapidement : la Bavière se rangeait - à nouveau - aux côtés du Brabant, et s'engageait à ses côtés dans toutes les guerres en cours (contre l'Autriche, le Bourbonnais, la France, Venise, Brême, Mecklenbourg, la Pologne, l'Espagne et la Bretagne).
Mais l'alliance des fidèles bavarois suffirait-elle cette fois-ci ?
Les Bourbonnais assiégeaint Orléans, les Autrichiens tentaient de reprendre Berne, les Français (toujours aussi bons marins) débarquaient des hordes martiniquaises, ravageant les Flandres et assiégeant le Maine et la Hollande.
Le Régent joua son va-tout : il attaqua l'Espagne avant que celle-ci ne soit tout-à-fait prête, et assiégea le Nivernais et le Lyonnais. Ses troupes reculèrent à Nevers, tinrent bon à Lyon.
Sur ces entrefaites, l'Autriche fit la paix aux Ottomans. L'Empereur avait les mains libres à l'Est.
Dieu semblait-il se ranger dans les ennemis du Brabant ? Non point. Son courroux, au contraire, frappa l'Espagne d'une peste endémique, ce qui permettrait peut-être aux armées brabançonnes de souffler un peu.
Les révoltes commençaient à éclater de part et d'autre des frontières. La situation semblait au plus bas. Il ne fallait pas compter sur les talents diplomatiques de la grosse Jacqueline.
Le Berri était tombé, les armées régentales se dirigeaint maintenant vers les Cévennes. Le Bourbonnais cependant, s'obstinant, rejetait les offres de paix les plus raisonnables.
L'Espagne conquit la Champagne, trop rapidement. Elle se tourna vers l'Ile-de-France. Lyon ne cédait pas. La Normandie subit à son tour les affres d'un siège, à nouveau mené par les forces autrichiennes.
La menace du démantèlement des territoires brabançons pesait de plus en plus. L'économie souffrait. Le sort des armes était sur le point de se renverser. Le Régent le compris. Il abandonna son espoir de conquêtes éclatantes sur le Bourbonnais, et se contenta du Maine comme gage de paix. Au moins, il libérait ses armées disponibles sur les territoires bourbonnais, et leur assignnait de nouvelles consignes : refluer vers le Nord pour contecarrer les sièges ennemis un à un.
Un événement lointain décida peut-être du cours des choses : Suzdal, allié de l'Autriche, déclara la guerre à la Russie. L'Autriche déshonora son alliance pour se ranger au contraire aux côtés de la Russie. Indirectement, elle se retrouvait ainsi en guerre contre le Bourbonnais !
Ses troupes soulagèrent en partie le sol brabançon de leuir présence, non sans avoir conquis à nouveau la Normandie. Le Régent repris son ancienne contre-attaque : ses troupes quittèrent Lyon, devant laquelle elles s'épuisaient inutilement et se concentrèrent en Savoie.
Soudaienement, la Provence déclara son indépendance vis-à-vis de l'Autriche. Sa fraîche alliance se débanda. L'Empereur restait cependant sourd à toute négociation.
Dans cette guerre désormais diplomatique, le Régent marqua un point : la Bretagne se retirait du conflit, trop heureuse de payer 40 écus pour quitter cette guerre absurde.
Le mois où Paris tomba aux mains des espagnols, la Champagne était reconquise. Les positions avaient tourné, mais l'avantage espagnol demeurait net. Le régent doutait désormais qu'une paix avec l'Autriche lui laisse le champ libre pour vaincre l'Espagne : celle-ci semblait décidément trop forte. De plus, la Hollande et la Zélande étaient ravagées par la racaille paysanne. Au moins, les armées d'occupation avaient de quoi s'occuper.
L'Espagne marqua un point décisif en faisant la paix avec la Bavière : celle-ci y perdait la Lorraine.
L'Autriche ne voulut pas être en reste : elle contraignit la Bavière à la paix en échange du Wurzburg.
L'Espagne continuait sa progression, même outre-atlantique : l'Isle Régentale tomba entre ses mains. Le Régent proposa la paix en échange de la seule colonie brabançonne, et d'une sérieuse indemnité : l'arrogante Espagne refusait, et réclamait l'Ile-de-France. Céder Paris, c'était bien sûr perdre la face, mais aussi se priver d'un important centre de commerce : le Régent refusa.
Le mois de mai 1598 fut joli : makgré les défaites systématiques infligées par les Espagnols, Paris tomba, et Lyon fut assiégée. La Savoie, elle aussi finit par se rendre. Cette conquête suffit à faire la paix avec l'Autriche, en échange de l'Orléanais.
Restait l'Espagne.
L'Espagne était coriace : les brabançons perdaient chaque engagement militaire, et devait sans cesse reculer : Lyon n'était plus assiégée, les armées reculaient vers le Nord, où des paysans hostiles et rebelles les attendaient.
Ces paysans étaient en fait, non pas de braves hollandais ou de courageux zéalndais, mais de terribles Frisons, en révolte contre l'Angleterre. Celle-ci, en quelques années, avait perdu ses possessions en terre d'Empire, à l'exception de l'Oldenbourg et de la province de Saxe.
A leur tour, les Frisons rejetèrent la tutelle anglaise et proclamèrent leur indépendance : les Pays-Bas renaissaient.
La nouvelle eût pu être réjouissante, si la Hollande, tenue par les rebelles Frisons, n'avait pas rejoint la Nouvelle République. Le Brabant perdait ainsi une province sans rien pouvoir y faire.
Les armées espagnoles prient Orléans ; la paix, déjà difficile, semblait désormais impossible sans concessions. Le Régent accepta enfin une solution qui lui permit de sauver l'honneur, et proposa la paix contre la cession de la Gueldre. Il estimait ainsi que cette province, dans les mains espagnoles, ne tarderait pas à se soulever et rejoindre les Pays-Bas.
L'Espagne accepta, et le jour même de la trêve, rétrocéda la Gueldre aux Pays-Bas.
La paix était conclue, enfin. Le bilan était mauvais : le Brabat avait certes gagné deux provinces, mais il en avait perdu deux autres. L'Espagne et l'Autriche avaient augmenté leur puissance, l'Espagne croissant vers le Nord, l'Autriche vers l'Est. La Bavière était amputée, l'Helvétie définitivement absorbée.

Une consolation : la Provence, qui se composait du comté de Provence et du Dauphiné révolté, avait cédé celui-ci à l'Autriche en échange de la paix. La France disparaissait ainsi de l'échiquier européen, du fait de son trop puissant allié...
Le Régent avait de quoi méditer sur les conséquences funestes de la guerre : cette issue en demi-teinte le fit tenir deux serments :
- un jour l'Espagne paierait
- la guerre ne se ferait plus que suite à une longue préparation, suivant un plan établi de longue date
... DANS LE PROCHAIN EPISODE : de la CONQUETE FACILE, de l'expansion TERRITORIALE et (peut-être) la REVANCHE contre l'ESPAGNE (et toujours plus de filles à poil) !!!
En cette même année 1592, le Régent, emporté lui aussi par la folie du monde et la griserie des victoires, se sentit suffisamment fort pour tenter de rogner les ailes du trop puissant voisin autrichien : considérant l'alliance Bourbonnais-Autriche-France occupée à une guerre contre Orléans, et ses armées étant disponibles et prêtes, il déclara la guerre à l'Autriche.
Cette manoeuvre avait un double but : ruiner deux puissances grandissantes (l'Autriche et la Bavière) en les faisant se battre l'une contre l'autre ; et tenter de grappiler quelques terres au Bourbonnais, s'étendant un peu trop au goût du Régent.
La stratégie allait s'opérer suivant deux axes : un corps d'armée se chargerait de battre les armées bourbonnaises regroupées devant Orléans (et tenter de garantir ainsi l'indépendance du duché) ; un autre se pénétrerait les terres autrichiennes et tenterait de conquérir l'Alsace et Bade. Les projets du Régent pour sa frontière est demeuraient les mêmes : annexer pour rendre ensuite l'indépendance, rogner les territoires autrichiens tout en créant deux états-vassaux-tampons.
Hélas, les armées brabançonnes se firent battre à Orléans et durent battre en retraite. Les nouvelles sur le front autrichien étaient meilleures : l'Empereur, présumant de sa force, avait déclaré la guerre aux Ottomans. Ses troupes faisaient défaut à l'Ouest, et Bade fut promptement assiégée, la Bavière se chargeant de l'Alsace.
Une contre-offensive permit aux Brabançons de délivrer Orléans, puis d'assiéger la Bourgogne. Plusieurs fois attaquées, les troupes tinrent bon, tant à Bade que devant Dijon.
Le Brabant faisait-il peur ? Brême et son allié polonais lui déclarèrent la guerre. Peu chalait au Régent : ces pays étaient trop éloignés pour réellement l'inquiéter. Ce qui lui fut plus objet de tourment fut l'infidélité de ses alliés bavarois et helvètes, qui reculèrent devant ce nouveau conflit.
La fin de l'année vit Bade tomber, les troupes du régent assiéger l'Armor, et hélas, l'Helvétie disparaître, étouffée sous la déferlante autrichienne.
1593 vit de nouveaux succès : Dijon tomba, l'Auvergne fut assiégée. L'Autriche, elle, s'employait à trouver de nouveaux alliés : les Chevaliers de hodes, Venise vinrent déployer leur bannière à ses côtés.
Attaquées sur plusieurs fronts, les troupes du Régent accumulaient les victoires sur des armées certes recrutées à la hâte. Le égent avait cependant cessé son offensive vers l'Est, craignant de voir son corps d'armée piégé dans la nasse autrichienne. Et surtout, Orléans était à nouveau assiégée, mais par des troupes autrichiennes : le Régent imagina qu'une paix en échange de l'Orléanais tout frais autrichien ne serait pas pour lui déplaire.
Ainsi, les troupes brabançonnes assiégèrent Berne (l'Helvétie serait-elle donc bien un jour brabançonne ?) . De même, sitôt Orléans tombée et annexée par l'Autriche, le Régent mis le siège devant la ville, escomptant sur une victoire rapide. Les objectifs avaient changé : conquérir l'Orléanais et, si possible, le canton de Berne.
Les bourbonnais, eux, ne s'avouaient pas vaincu : leurs troupes reprirent aisément Dijon, mal défendue. Les Autrichiens étaient sur le point de faire tomber la Normandie : le Régent, comprenant qu'on se dirigeait vers une guerre d'usure, dépâcha des troupes afin d'assiéger la Savoie. Les provinces conquises, ou même les sièges entamés, pouvaient être autant de monnaie utile dans l'escarcelle du Régent lors du grand troc final.
La Normandie tomba. Bien pis, à la fin de l'année, la Bavière, lassée, se retira de la guerre contre la somme dérisoire de 30 écus ("Les 30 écus de Judas", fulmina le Régent). Le Brabant était désormais bien seul.
1594 vit la fortune varier au gré des armes : Bade était assiégée par l'Autriche, la Normandie par le Brabant. Orléans tomba. A la fin de l'année, Bade et la Normandie retrouvaient leurs propriétaires respectifs. La Pologne et la France se manifestèrent en assiégant la Gueldre. Ils furent vite repoussés. Cependant, aucun des belligérants ne souhaitaient les généreuses paix du Régent. Et dans le chef de ce dernier, il était hors de question de se désengager du conflit sans y gagner le contrôle d'une province.
1595 permit aux troupes brabançonnes de s'illustrer dans quelques combats, et de faire tomber la province du Maine. Mais les événements n'avançaient guère. Tout le plan de percée vers l'Autriche était à rétablir : l'entreprise parut trop grande au Régent, et il revit ses ambitions à la baisse. Qu'on lui abandonnât l'Orléanias, et une quelconque province bourbonnaise, et il serait heureux. Mais ses adversaires se montraient intraitables et refusaient de céder.
La situation semblait inextricable.
En juin, l'Espagne annonçait qu'elle renonçait à son accès militaire sur les possessions bourbonnaises : cela ne pouvait signaler qu'une chose - la guerre le mois suivant.
Le Régent tenta de forcer les pourparlers, mais l'obstination était plénipotentiare du camp adverse : les propositions les plus raisonnables furent impitoyablement rejetées. En désespoir de cause, le Régent fit envoyer quelques babioles à la Cour d'Espagne - celle-ci assurait en retour au Régent sa neutralité.
1595-1600 : l'Espagne tombe le masque ! (ou : qu'allait-il faire en cette galère ?)
Les serments espagnols durent ce que durent les étés : en septembre, les ignobles hispaniques firent parvenir au régent leur déclaration de guerre. Ils entraînaient avec eux la Bretagne. Des troupes se construisaient déjà en Nivernais et en Picardie.
En désespoir de cause, le Régent se tourna vers son ultime recours, ses anciens alliés de l'Est. Il s'en ouvrit à la grosse Jacqueline de Bavière :
" - Majesté, pour vaincre et survivre, il nous faut des bavarois. Sans cela, nous sommes perdus."
La ventripotente duchesse gagea ses propres bijoux, et le lendemain, 10 000 bavarois se trouvaient réunis dans la grande salle du palais ducal. Assise à une table, la grosse Jacqueline se frottait les mains et se léchait les babines. Le Régent, entrant dans la pièce, eut un moment de désespoir : que pouvait-on bien faire avec 10 000 petits gâteaux à la framboise ? Laissant la grosse à ses agapes, il fit parvenir au duc de Bavière un traité d'alliance, et attendit anxieusement.
La réponse lui parvint rapidement : la Bavière se rangeait - à nouveau - aux côtés du Brabant, et s'engageait à ses côtés dans toutes les guerres en cours (contre l'Autriche, le Bourbonnais, la France, Venise, Brême, Mecklenbourg, la Pologne, l'Espagne et la Bretagne).
Mais l'alliance des fidèles bavarois suffirait-elle cette fois-ci ?
Les Bourbonnais assiégeaint Orléans, les Autrichiens tentaient de reprendre Berne, les Français (toujours aussi bons marins) débarquaient des hordes martiniquaises, ravageant les Flandres et assiégeant le Maine et la Hollande.
Le Régent joua son va-tout : il attaqua l'Espagne avant que celle-ci ne soit tout-à-fait prête, et assiégea le Nivernais et le Lyonnais. Ses troupes reculèrent à Nevers, tinrent bon à Lyon.
Sur ces entrefaites, l'Autriche fit la paix aux Ottomans. L'Empereur avait les mains libres à l'Est.
Dieu semblait-il se ranger dans les ennemis du Brabant ? Non point. Son courroux, au contraire, frappa l'Espagne d'une peste endémique, ce qui permettrait peut-être aux armées brabançonnes de souffler un peu.
Les révoltes commençaient à éclater de part et d'autre des frontières. La situation semblait au plus bas. Il ne fallait pas compter sur les talents diplomatiques de la grosse Jacqueline.
Le Berri était tombé, les armées régentales se dirigeaint maintenant vers les Cévennes. Le Bourbonnais cependant, s'obstinant, rejetait les offres de paix les plus raisonnables.
L'Espagne conquit la Champagne, trop rapidement. Elle se tourna vers l'Ile-de-France. Lyon ne cédait pas. La Normandie subit à son tour les affres d'un siège, à nouveau mené par les forces autrichiennes.
La menace du démantèlement des territoires brabançons pesait de plus en plus. L'économie souffrait. Le sort des armes était sur le point de se renverser. Le Régent le compris. Il abandonna son espoir de conquêtes éclatantes sur le Bourbonnais, et se contenta du Maine comme gage de paix. Au moins, il libérait ses armées disponibles sur les territoires bourbonnais, et leur assignnait de nouvelles consignes : refluer vers le Nord pour contecarrer les sièges ennemis un à un.
Un événement lointain décida peut-être du cours des choses : Suzdal, allié de l'Autriche, déclara la guerre à la Russie. L'Autriche déshonora son alliance pour se ranger au contraire aux côtés de la Russie. Indirectement, elle se retrouvait ainsi en guerre contre le Bourbonnais !
Ses troupes soulagèrent en partie le sol brabançon de leuir présence, non sans avoir conquis à nouveau la Normandie. Le Régent repris son ancienne contre-attaque : ses troupes quittèrent Lyon, devant laquelle elles s'épuisaient inutilement et se concentrèrent en Savoie.
Soudaienement, la Provence déclara son indépendance vis-à-vis de l'Autriche. Sa fraîche alliance se débanda. L'Empereur restait cependant sourd à toute négociation.
Dans cette guerre désormais diplomatique, le Régent marqua un point : la Bretagne se retirait du conflit, trop heureuse de payer 40 écus pour quitter cette guerre absurde.
Le mois où Paris tomba aux mains des espagnols, la Champagne était reconquise. Les positions avaient tourné, mais l'avantage espagnol demeurait net. Le régent doutait désormais qu'une paix avec l'Autriche lui laisse le champ libre pour vaincre l'Espagne : celle-ci semblait décidément trop forte. De plus, la Hollande et la Zélande étaient ravagées par la racaille paysanne. Au moins, les armées d'occupation avaient de quoi s'occuper.
L'Espagne marqua un point décisif en faisant la paix avec la Bavière : celle-ci y perdait la Lorraine.
L'Autriche ne voulut pas être en reste : elle contraignit la Bavière à la paix en échange du Wurzburg.
L'Espagne continuait sa progression, même outre-atlantique : l'Isle Régentale tomba entre ses mains. Le Régent proposa la paix en échange de la seule colonie brabançonne, et d'une sérieuse indemnité : l'arrogante Espagne refusait, et réclamait l'Ile-de-France. Céder Paris, c'était bien sûr perdre la face, mais aussi se priver d'un important centre de commerce : le Régent refusa.
Le mois de mai 1598 fut joli : makgré les défaites systématiques infligées par les Espagnols, Paris tomba, et Lyon fut assiégée. La Savoie, elle aussi finit par se rendre. Cette conquête suffit à faire la paix avec l'Autriche, en échange de l'Orléanais.
Restait l'Espagne.
L'Espagne était coriace : les brabançons perdaient chaque engagement militaire, et devait sans cesse reculer : Lyon n'était plus assiégée, les armées reculaient vers le Nord, où des paysans hostiles et rebelles les attendaient.
Ces paysans étaient en fait, non pas de braves hollandais ou de courageux zéalndais, mais de terribles Frisons, en révolte contre l'Angleterre. Celle-ci, en quelques années, avait perdu ses possessions en terre d'Empire, à l'exception de l'Oldenbourg et de la province de Saxe.
A leur tour, les Frisons rejetèrent la tutelle anglaise et proclamèrent leur indépendance : les Pays-Bas renaissaient.
La nouvelle eût pu être réjouissante, si la Hollande, tenue par les rebelles Frisons, n'avait pas rejoint la Nouvelle République. Le Brabant perdait ainsi une province sans rien pouvoir y faire.
Les armées espagnoles prient Orléans ; la paix, déjà difficile, semblait désormais impossible sans concessions. Le Régent accepta enfin une solution qui lui permit de sauver l'honneur, et proposa la paix contre la cession de la Gueldre. Il estimait ainsi que cette province, dans les mains espagnoles, ne tarderait pas à se soulever et rejoindre les Pays-Bas.
L'Espagne accepta, et le jour même de la trêve, rétrocéda la Gueldre aux Pays-Bas.
La paix était conclue, enfin. Le bilan était mauvais : le Brabat avait certes gagné deux provinces, mais il en avait perdu deux autres. L'Espagne et l'Autriche avaient augmenté leur puissance, l'Espagne croissant vers le Nord, l'Autriche vers l'Est. La Bavière était amputée, l'Helvétie définitivement absorbée.

Une consolation : la Provence, qui se composait du comté de Provence et du Dauphiné révolté, avait cédé celui-ci à l'Autriche en échange de la paix. La France disparaissait ainsi de l'échiquier européen, du fait de son trop puissant allié...
Le Régent avait de quoi méditer sur les conséquences funestes de la guerre : cette issue en demi-teinte le fit tenir deux serments :
- un jour l'Espagne paierait
- la guerre ne se ferait plus que suite à une longue préparation, suivant un plan établi de longue date
... DANS LE PROCHAIN EPISODE : de la CONQUETE FACILE, de l'expansion TERRITORIALE et (peut-être) la REVANCHE contre l'ESPAGNE (et toujours plus de filles à poil) !!!
"Hein que j'étais jeune un jour ?" (BAFFFFFFFFE!)
[quote="T le Taudis]
... DANS LE PROCHAIN EPISODE : de la CONQUETE FACILE, de l'expansion TERRITORIALE et (peut-être) la REVANCHE contre l'ESPAGNE (et toujours plus de filles à poil) !!![/quote]
Amis Qgistes, ne vous laissez plus duper! Tout comme moi, vous avez pu constater que l'on nous ment et qu'une partie, toujours la même d'ailleurs, de cet alléchant programme est toujours oubliée!
Boycontons cet AAR! Euh non, il est trop bien et rétablit enfin la Belgique dans toute la gloire qui devrait être sienne depuis toujours...
Des suggestions alors? Ok, désolé, je
... DANS LE PROCHAIN EPISODE : de la CONQUETE FACILE, de l'expansion TERRITORIALE et (peut-être) la REVANCHE contre l'ESPAGNE (et toujours plus de filles à poil) !!![/quote]
Amis Qgistes, ne vous laissez plus duper! Tout comme moi, vous avez pu constater que l'on nous ment et qu'une partie, toujours la même d'ailleurs, de cet alléchant programme est toujours oubliée!
Boycontons cet AAR! Euh non, il est trop bien et rétablit enfin la Belgique dans toute la gloire qui devrait être sienne depuis toujours...
Des suggestions alors? Ok, désolé, je